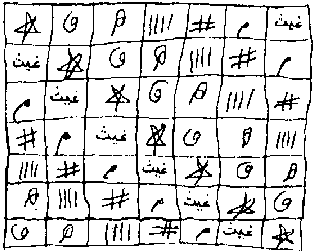Le barrage de Talo toujours
discuté
Au mois de janvier, le Ministère
de l’Agriculture et la BAD ont invité une délégation de Cultural Survival à
visiter Bamako, Bla et Djenné, pour essayer une nouvelle fois de concilier les
points de vue sur le barrage de Talo. Cette délégation était composée de Larry
Childs et de William Fisher, l’un des auteurs du rapport Clark. La visite de la
délégation à Djenné a été l’occasion de nouvelles promesses : que
désormais toutes les parties prenantes (c’est-à-dire notamment Cultural
Survival, mais aussi l’association des ressortissants de Djenné à Bamako)
seraient associées à toutes les étapes du processus, qu’une étude de l’impact
du projet de barrage jusqu’à Mopti serait entreprise, que toutes les parties
prenantes seraient consultées sur la rédaction des termes de référence de cette
étude d’impact, toutes les questions posées par le développement intégré de la
région seraient abordées, etc.
Toutes ces promesses ont été
enregistrées et transcrites par écrit. Depuis le départ de la mission, on a
appris que les termes de référence (qui définissent le contenu des nouvelles
études) ont été établis d’un commun accord entre le ministère de l’agriculture
et la BAD et signés dès le 15 février, avant qu’aucune des autres parties
prenantes n’ait eu le temps de réagir à la première version. On a appris aussi
que c’est le même bureau d’étude qui a été choisi pour ces études complémentaires,
bien que ses travaux antérieurs aient été jugés très insuffisants, et bien en
particulier que l’étude d’impact socio-économique soit purement et simplement
inacceptable. On a encore appris que la durée retenue pour ces études n’était
que de deux mois : en clair, on devait craindre qu’on se contente de produire
de nouveaux documents pour tranquilliser l’opinion.
Les dirigeants de Cultural
Survival ont essayé d’insister, en obtenant la signature par la BAD d’un engagement selon lequel les observations des
experts de Cultural Survival seront transmises aux experts chargés des études
complémentaires qui les prendront en compte.
Ainsi
le 7 avril, le Directeur National de l’Aménagement et de l’Equipement Rural
s’est adressé par écrit au Groupement d’Ingénieurs-Conseil AGREER – Haskoning –
GID-SA H.N’D, en leur adressant les termes de référence et en précisant « Cultural survival est d’accord avec cette version des termes de référence (TDR)
à conditions que l’ensemble de ces observations soient considérés comme annexes
desdits TDR.. Aussi je vous demande de bien vouloir finaliser les études
complémentaires sur la base de ces TDR et en prenant en compte le plus possible
les observations de Cultural Survival. » La lecture de ces documents montre que l’étude d’impact
est limitée aux aspects hydrauliques, ignorant donc l’impact socio-économique :
aucune justification de l’intérêt économique de l’ouvrage ne sera donc jamais fournie.
Par ailleurs, la durée de l’étude reste limitée à trois mois, ce que tous les
experts compétents ont jugé notoirement insuffisant.
Cependant,
le Gouvernement a accentué la pression en faveur de la réalisation du projet.
En effet, les 22 et 23 avril, le Premier Ministre, M. Ahmed Mohamed Ag Hamani, trois
ministres (agriculture, administration territoriale, et plan) et une délégation
de plus de cent personnes, étaient dans la zone, pour lancer des travaux de surcreusement du canal d’irrigation des
plaines du Pondori, et pour mettre en place à Djenné un comité de bons offices pour
la réconciliation et le développement. A cette occasion, le Premier Ministre a
notamment déclaré : « Je viens
ici vous apporter les salutations chaleureuses du Président de la République,
le Président Amadou Toumani Touré, qui m’a dépêché auprès de vous, à la tête de
cette importante délégation, ce qui prouve qu’il attache une importance
singulière au projet Moyen-Bani et suit avec un grand intérêt la réalisation
des ouvrages destinés à l’amélioration des conditions de vie des populations.
Il me charge de vous dire merci pour votre adhésion totale à ce projet de
développement que nous sommes heureux de voir, ainsi, démarrer.» Chacun comprend donc que les
discussions sont terminées, et on annonce que le chantier du barrage de Talo
sera ouvert dès octobre prochain. Un journaliste du Ministère de l’information a
d’ailleurs entendu de la bouche du chef du gouvernement une phrase qui ne
figure pas dans nos enregistrements, et qu’il rapport ainsi : « Aujourd’hui, il n’est pas question de céder
aux intentions malveillantes de quelques individus qui s’opposent aux intérêts
de la communauté pour des raisons non avouées » (L’Essor, 27 avril 2004, p. 3)
Quant à
la commission de bons offices pour la réconciliation et le développement,
installée en grande pompe à l’occasion de cette visite, on ne sait rien de ce
que seront ses compétences, ses pouvoirs, ses moyens. Elle est ainsi composée :
le Président en est l’ancien ministre, Lamine Keita, déjà médiateur dans ce
dossier depuis des années ; les membres de la commission sont le Président
de l’Assemblée Régionale de Mopti, le Président de l’Assemblée régionale de
Ségou, le Président du Conseil de cercle de Djenné, le Président du Conseil de
cercle de San, le Président du Conseil de cercle de Bla, le représentant du conseil
régional des jeunes de Mopti, le représentant du conseil régional des jeunes de
Ségou, la représentante des femmes de Djenné, la représentante des femmes de
Bla, le représentant des producteurs de Djenné, le représentant de
l’association des producteurs de San, la représentante des femmes de San, le
représentant de l’association des ressortissants de Djenné à Bamako, le
représentant de l’association des producteurs de Bla, le représentant de
l’association des ressortissants de Bla à Bamako, le représentant de
l’association des ressortissants de San à Bamako, le représentant de l’ONG
Care-Mali, le représentant de l’ONG World Vision, le représentant du CCA ONG,
la représentante de la CAFO, la représentante de l’APE, le représentant du Haut
Conseil Islamique, le représentant de l’Eglise catholique, le représentant de
l’association des groupements des églises protestantes au Mali, le représentant
du conseil national des jeunes, et enfin le représentant de l’APECAM.
Cela dit, l’atelier de validation
des études complémentaires, qui s’est tenu à Bamako du 11 au 13 mai, a estimé
que les conditions définies par les experts les plus critiques à l’égard du
projet initial étaient désormais satisfaites. En particulier le représentant de
Cultural Survival a donné son accord publiquement. Et donc les travaux
commenceront effectivement début octobre.
Chantier de la route
Djenné-Mougna-Saye
Le 30 janvier 2004, le Ministre
des transports et de l’urbanisme, Monsieur Ousmane Issoufi Maïga, a visité le
chantier de la route qui doit relier Djenné à Ségou par Mougna et Saye. Bien
que le bureau de contrôle technique BETEC ait affirmé que le niveau
d’avancement des travaux était de 50 %, et que l’achèvement des travaux était
prévu pour novembre 2004, le Ministre et sa suite ont été amenés à constater,
après la visite de terrain, que le chantier accuse un retard de 7 mois, et que
certaines entreprises qui se sont engagées dans ce chantier ne disposent pas du
matériel nécessaire pour tenir leurs engagements. Le Ministre a ensuite
rencontré les différents partenaires du projet, dans la salle de conférence du
BETEC à Djenné : le groupement d’entreprises, le BETEC, l’administration
des travaux publics, les Préfet de Djenné et les élus communaux. Le Ministre,
après avoir présenté l’objet de sa mission dans les termes suivants :
« se rendre compte si l’argent du contribuable malien est utilisé ici pour
des fins utiles », a fustigé le comportement des intervenants, qu’il rend
responsables de l’état du chantier à la date de sa visite. Il a fermement
invité l’administration des travaux publics à lui faire parvenir, dans un délai
limité, un état des lieux précis, un planning et un inventaire du matériel en place, avec un engagement de
chaque entreprise concernée quant au respect de la date de fin des travaux.
Reconstruction du marché de Djenné
La mairie a obtenu un financement
de l’Agence Nationale pour l’Investissement des Collectivités Territoriales
pour reconstruire le marché de Djenné. Ce financement représente 80 % du coût,
et la mairie a apporté le complément. L’opération a principalement pour but de
créer des boutiques fermées, munies de portes en fer, donnant sur les rues qui
entourent le marché. La construction
Un atelier d’évaluation
du projet de réhabilitation de maisons typiques de l’architecture de Djenné, financé
par les Pays-Bas pendant 7 ans, s’est tenu à Djenné les 14 et 15 janvier 2004
sous la présidence du Ministre de la Culture. A cette occasion a été présenté
le livre de R. Bedaux, B. Diaby et P. Maas « L’architecture de Djenné,
la pérennité d’un patrimoine mondial » éditions Snoeck, ISBN 90-5349-420-0.
Globalement, le projet s’achève après avoir réhabilité une centaine de maisons
(sur 170 prévues initialement) et sans que les dispositions relatives à la
pérennisation des acquis aient été prises. Nous reviendrons sur ce dossier
dans un prochain numéro.
En janvier, une mission de la
Fondation Aga Khan est venue à Djenné pour examiner de plus près les besoins en
matière de conservation du patrimoine.
Courrier des lecteurs
Pitié pour
moi ! Pitié pour nous !
Je suis une
maison de Djenné, la cité mystérieuse dont l’architecture a ébloui le monde
entier. Peut-être est-ce pour cette raison que la cité qui m’abrite a été
classée Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Je suis
construite en banco, de terre pétrie
d’eau. Mes malheurs arrivent avec la belle saison, la saison qui donne la vie,
la saison à laquelle tous les propriétaires de maisons sont accrochés pour
survivre, la saison des pluies.
Ah, les
pluies, je vis dans la crainte de les voir arriver !
Pleut-il abondamment ? L’eau
m’infiltre, et je commence à suinter de partout, surtout si les
moyens de mon propriétaire ne lui ont pas permis de me crépir. Et quand, par
malheur, c’est la nuit, le sommeil est perturbé et tout le monde, les voisins
immédiats et lointains, tout le monde est effrayé : car le bilan d’une
saison des pluies, ici, c’est un certain nombre de maisons écroulées, des
dégâts considérables !
N’avez-vous pas appris que cette
année 2003 notre terrible saison des pluies a éprouvé Tombouctou, ville jumelle
de Djenné ! Et pourtant, ces villes historiques, ces fiertés du Mali, ne
méritent pas d’être abandonnées à leur sort ! L’Etat doit vraiment
s’investir pour leur éviter « un recul permanent », provoqué par ce
cycle régulier d’effondrement et de reconstruction !
Si nous, maisons de Djenné, nous
avions été consultées, on n’aurait jamais classé notre chère cité « Patrimoine »,
surtout si patrimoine voulait réellement dire nous laisser définitivement dans
le banco ! Et nous voulons savoir si la conservation d’un patrimoine,
serait-il mondial, doit condamner nos propriétaires à l’extrême pauvreté !
Je rappelle qu’une maison de
Djenné se construit en saison sèche. Celui qui, faute de moyens, n’achève pas
sa construction avant le début de la prochaine saison des pluies, est assuré de
perdre la moitié de ses investissements. Si, par malheur, deux ou trois saisons
devaient passer, alors le travail devrait reprendre à zéro, car les pluies, à
force de lécher les murs, les auraient complètement détruits.
La maison finie, alors commencent
les soucis pour nos propriétaires, car une maison de Djenné ne survit que par
un entretien régulier, annuel, faute de quoi, à l’arrivée de la saison des
pluies, plus de quiétude ! Et Dieu sait que cet entretien est très dur pour des populations qui se battent
quotidiennement pour survivre !
Il doit
vraiment être bon pour une maison d’être construite pour dix, voire vingt ans,
surtout si les pluies, au lieu de la détruire, fortifient ses murs ! Et
surtout quand le propriétaire est pauvre, et quand la tâche d’assurer sa
subsistance et celle de sa famille est pour lui des plus acrobatiques !
Nous sommes
sûres, nous, maisons de Djenné, que si on permettait à nos pauvres
propriétaires de nous construire en dur, en respectant bien sûr le style, notre
ville serait plus jolie et nos propriétaires moins pauvres. Le centre de santé
en est la preuve, et une référence.
Dieu merci,
la terrible saison s’en est allée ! Fini donc pour nous le calvaire !
Vive la saison sèche ! Et souhaitons que la prochaine saison des pluies
soit moins dure !
Ibrahima Abdoulaye Landoure
Djenné,
prends garde de te perdre !
Je suis
enseignante en éducation artistique dans un lycée professionnel de Grenoble. Passionnée
d’histoire de l’art et des civilisations, je passe tout mon temps libre en voyages à travers le monde. C’est
pourtant assez récemment, en 1990, que j’ai découvert l’Afrique, où j’ai été
attirée par cette fabuleuse architecture de terre que décrit Sergio Domian dans
son livre « Architecture soudanaise ».
C’est donc
en 1990 seulement que j’ai découvert Djenné, mais aussi Kouakourou et Kolenze.
Je ne suis jamais retournée dans cette dernière localité, car dès la première
visite j’ai été scandalisée par l’état dans lequel on avait laissé le saho –maison
des jeunes– du quartier Somono (dit aussi maison de Kadia) : effondré,
détruit aux deux tiers ! Comme si l’inculture était telle que personne
n’était capable de se rendre compte du caractère exceptionnel de cette
architecture et de la culture qu’elle sert !
Au
contraire, je suis revenue plusieurs fois à Djenné, fascinée par cette ville,
par sa mosquée, certes, mais aussi par l’ensemble de la ville, avec ses rues
entières de façades imposantes et pourtant si fragiles, au charme unique au
monde. Là encore, à chaque visite, je suis amenée à me demander comment il est
possible que les gens de Djenné manquent à ce point de confiance en eux, en
leur culture, en l’héritage qu’ils ont reçu de leurs pères, pour négliger
d’entretenir cet héritage exceptionnel, comment il est possible que ceux
d’entre eux qui ont voyagé ne voient pas que leur ville est unique, comment il
est possible qu’ils soient à ce point désorientés pour n’avoir envie que de
copier ce qui se fait de plus banal, de plus médiocre partout dans les pays pauvres !
Car je dois
vous le dire, les transformations que j’ai constatées dans la ville de Djenné
depuis 1990 me scandalisent et m’inquiètent au plus haut point ! Quel
besoin y avait-il d’ajouter des rangs de torons sur les façades de la
mosquée ? Quel besoin d’y fixer des tubes néon ? Si c’est pour éclairer le
monument, les professionnels savent faire bien mieux ! Quel besoin d’y installer
des haut-parleurs ? Ne prie-t-on pas dans Djenné depuis des siècles sans
haut-parleurs ? S’agit-il de défendre la foi en criant plus fort ?
Et
encore : les compétences en matière de bâtiment ont-elles disparu de
Djenné ? Les maçons savent-ils encore construire en djenne ferey ? Savent-ils encore entretenir les bâtiments en
banco ? Les habitants de Djenné sont-ils encore capables de défendre leur
patrimoine ou bien ont-ils déjà abandonné la partie parce qu’ils veulent
ressembler à tout le monde ?
Je suis en
train de constituer un dossier de photographies pour montrer les dégradations
qu’a subies la ville, et destiné à sensibiliser les personnes que je vais
contacter. Il faut se mobiliser en faveur de Djenné, Djenné est en grand danger
de se perdre, Djenné se laisse aller !
Evelyne Bertrand <b.evelyne@9online.fr>
Quelques réponses
à ces lecteurs courroucés :
- aide de
l'UNESCO : c'est simple, cette aide est nulle ; le centre du patrimoine mondial
(voir son site, sa publication...) ne s'occupe que d'organiser des conférences,
ateliers, réunions, et de favoriser l'extension de la liste, et notamment son
extension au patrimoine non matériel, qui est à la mode depuis quelques années
; mais aider les pays à protéger les sites, non, il y a longtemps que l'UNESCO
ne fait strictement rien à ce sujet ; même la menace de reclasser un site
dans la catégorie "patrimoine mondial en danger" n'entraîne aucune
forme d'action concrète pour lutter contre ce danger ;
- autres formes d'aide étrangère :
le projet hollandais
a été de loin la principale, depuis 1996 ; en marge de ce projet architectural,
les Hollandais ont attaqué le problème de l'évacuation des eaux usées, proposé
et expérimenté une solution, qui a été perfectionnée localement (notamment par le
maçon Boubacar Kouroumanse, dit Bayere, et un jeune ingénieur américain travaillant
au service local de l’assainissement, Nathan Forsythe, localement baptisé
Dramane Cissé) ; cette expérimentation a permis d’obtenir un financement
allemand (KfW) pour équiper 1200 maisons ; ce sera le principal chantier des
toute prochaines années ;
- les caniveaux qui ont été aménagés
dans certaines rues depuis quelques années représentent une solution évidemment
partielle, mais aussi un très net progrès technique (certains tronçons des rues
redevenaient fréquentables), et social : les réalisations de ce genre sont
toujours parties de la base, de notables ou de petits groupes de propriétaires
voisins) ; mais il y a désormais plus de 600 abonnés à l'eau dans la ville, il
n'y en avait que quelques dizaines il y a dix ans ; cette solution n’est
pas à la taille du problème;
- il faut signaler encore, en
matière d’assainissement, le projet pharaonique préparé par un bureau d'études
malien, selon le principe "plus c'est cher, plus je gagne",
aboutissant à un devis de 6 milliards FCFA (voir dans "DJENNE PATRIMOINE Informations"
n° 14, printemps 2003, un résumé de ce projet, et deux appréciations critiques)
; mais la mairie a adopté le projet les yeux fermés (sans que personne n’ait lu
les documents, sans que personne ne soit allé voir à Mopti,
où la solution proposée a été réalisée tout récemment : la validation du
projet a été faite en deux heures, les élus n’ont fait qu’entériner la
proposition présentée par le ministère), et a réussi à organiser en janvier
dernier une réunion préparatoire de bailleurs potentiels sur le financement
- maçons sachant construire en djenne ferey : notre association a réuni
quelques maçons en 1999 (voir DJENNE PATRIMOINE Informations, n° 8, janvier
2000), dont Bere Yonou (qui est toujours vivant, il était à Washington pour le
Folkslife festival en juin 2003) pour leur poser la question ; la réponse est claire
et nette : plus aucun maçon vivant aujourd'hui, même parmi les plus vieux, n'a
lui-même construit une maison avec des djenne
ferey" ; plusieurs savent faire les briques, plusieurs ont vu faire,
certains ont travaillé sur des chantiers, mais aucun ne peut prendre la
responsabilité de construire une maison selon cette technique ; il est bien
dommage que les Hollandais ne s’en soient pas préoccupés il y a trente ans,
lorsqu’ils commençaient leur travaux ; c’est d’autant plus dommage que
cette technique était, apparemment, unique au monde ! Notre association a
organisé un petit chantier-école début 2003, en faisant construire par Boubacar
Kouroumanse un bolon (une entrée de
concession) en djenne ferey ; il
faudra attendre pour voir comment cette construction simple vieillit, mais il
faudrait faire beaucoup plus pour retrouver la technique, et notamment pour
construire en étage ; ce n'est sans doute pas impossible, mais... Le savoir
concernant la construction en terre, avec des toubabou ferey, existe bel et bien, il est transmis, mais on ne
peut plus construire une maison en djenne
ferey actuellement à Djenné ;
- le livre cité plus haut contient
un chapitre de Trevor Marchand où il est question de la corporation des bari ; on y lit en substance que la
crise économique des années 1973 à 1986 aurait détruit la profession et que le
projet hollandais l'aurait relevée ; cette analyse est un peu trop
simple : la coopérative de maçons créée par le régime de Modibo Keita, et
à la tête de laquelle on a mis un bon militant US-RDA en chassant le chef de la
corporation traditionnelle (bari ton)
a joué un rôle très pernicieux ; c'est évidemment cette coopérative qui a
bénéficié de tous les chantiers publics de l'époque, donc la corporation était
réduite à rien, et la discipline professionnelle a été ouvertement remplacée
par le copinage de parti....
- il existe des artisans très
capables dans plusieurs corps de métier de la construction (les maçons, les
menuisiers…), mais pas dans tous (par exemple plomberie, électricité,
carreleur...) ; mais tous les artisans ont des problèmes avec la qualité, avec
la finition, parce que les clients ne sont pas exigeants, ils jouent au pauvre,
ils font des économies de bouts de chandelles, ils préfèrent acheter une
nouvelle TV ou une mercedes que de montrer qu'ils ont construit une maison
magnifique ; et ceux qui ont des moyens (car il y en a, et ils construisent des
maisons à Djenné, tel marabout, tel député, tel avocat, tel importateur...)
manquent de la culture du patrimoine qui leur aurait permis d'éviter des fautes
énormes ;
- l'adhésion de la population à la
restauration –et même au simple entretien courant– du patrimoine architectural
de Djenné n’est pas ce qu’elle pourrait être (voir par exemple l'article de
Rowlands
dans le livre cité plus haut ; voir les observations de Marie-Laure
Villesuzanne dans DJENNE PATRIMOINE Informations n° 12, janvier 2002). Certes,
les maisons de Djenné font le plus souvent partie de successions restées dans
l’indivision, et appartiennent donc à des dizaines de personnes, dont aucune ne
veut faire de frais au bénéfice des autres. Mais en outre, les habitants de
Djenné sont mis depuis tant d'années dans la position des "pauvres",
des "assistés", de ceux qui obéissent à un « commandant », qu'ils
ont finalement adopté cette position, qu’ils la trouvent après tout assez
confortable, et qu'ils ne comptent plus sur eux-mêmes pour résoudre leurs
problèmes. Les administrations bamakoises et les intervenants extérieurs, même
s'ils sont bien intentionnés, ont tous leur part de responsabilité : tant
de gens viennent avec des projets qu’il suffit d’attendre, il y en aura bien un
qui nous profitera !
- la complainte de la maison de
Djenné illustre bien, hélas, la faible adhésion des habitants de la ville (et
d’abord de ses intellectuels) à l’idée de protéger le patrimoine
architectural de la ville ; le banco est un matériau fragile, c’est
vrai ; le recrépissage s’impose tous les deux ans, et même chaque année
pour les façades exposées à l’est, c’est vrai ; les habitants de Djenné se
plaignent de cette contrainte et du coût du crépissage pour expliquer la
dégradation de leur patrimoine, ou pour justifier les revêtements en briques
cuites, et le recours au ciment ; personne cependant n’est capable de dire
ce que coûtent ces solutions alternatives ; elles sont à la mode, c’est
toute leur justification, pour ceux qui veulent montrer qu’ils sont à la
mode ; et donc personne ne semble
voir que l’école a défiguré le centre de Djenné par ses murs de ciment
recouverts de briques cuites ; personne ne semble voir que l’hôpital est
un pastiche grotesque dont ni le dessin, ni les formes, ni la couleur ne
ressemblent aux façades de Djenné telles qu’ont peut les admirer dans les rues
anciennes ; tous ceux qui sont attachés au patrimoine architectural de
Djenné voudront conserver ses formes, ses proportions, ses couleurs, et même
ses matériaux, tant qu’un matériau plus durable et aussi peu cher ne sera pas
disponible ; l’idée de « construire en dur, en respectant bien sûr le
style » est aujourd’hui utopique !
- la maison en banco, dans sa
complainte, semble ignorer que les maçons savent protéger leur chantier pendant
la saison des pluies, s’il n’est pas terminé ; elle semble ignorer que
beaucoup de maisons écroulées ont été construites sur les berges ; elle
veut oublier que les maisons sont mal entretenues non pas à cause de la
pauvreté des propriétaires, mais d’abord à cause de l’indivision entre de
nombreux héritiers ; elle associe le banco à la pauvreté, alors que le
banco est le matériau de construction le plus économique, tant au moment de
l’édification du bâtiment que pour son entretien ; le propriétaire qui dit
avoir le souci quotidien d’assurer sa subsistance et celle de sa famille
devrait pourtant en être plus conscient que quiconque !
- les
aménagements apportés à la mosquée inquiètent effectivement de nombreux
djennenkés et amis de Djenné ; quel besoin y avait-il vraiment
d’installer cent ventilateurs à l’intérieur ? Ne prie-t-on pas dans cette
mosquée depuis toujours sans avoir besoin de ventilateurs ? Non, la vraie
question est celle-ci : les dépenses somptuaires des riches musulmans ou
des ambassades étrangères ne pourraient-elles pas trouver des emplois plus
judicieux ? A quoi pensent les lettrés, les oulémas, les imams, à quoi
pensent les élus, à quoi pensent les cadres de l’administration malienne
en poste à Djenné ? N’y a-t-il désormais plus qu’une culture religieuse, celle
de qui paie bien ?
- le laisser aller en matière
d’urbanisme est tout aussi inquiétant : comment les élus, le maire, les
commandants, les préfets, les sous-préfets ont-ils pu tolérer qu’on installe
l’électricité et le téléphone à Djenné comme on ne le fait plus dans aucune bourgade
ordinaire d’un pays développé ? Comment ont-ils pu tolérer ces poteaux
partout, ces fils partout, ces installations faites par des bricoleurs qui
n’ont aucune formation professionnelle, aucune idée de ce qu’est un bien
familial, encore moins un patrimoine collectif ? Ces élus, ces cadres de
la Nation, n’ont-ils donc aucun pouvoir, ou n’ont-ils donc aucune culture,
aucune conscience de ce qu’est le patrimoine culturel que la nation doit
transmettre à ses enfants ? Et tous ceux qui parlent de patrimoine mondial :
au gouvernorat de la région, au ministère de la culture, à la Mission
culturelle, à l’UNESCO, dans les services culturels des ambassades, que
font-ils exactement ? Il faut les interpeller, les mettre au pied du
mur ! Que fait l’UNESCO ? Que font les bailleurs de fonds ? Que
fait le Ministère de la culture ? Que fait la Mission Culturelle ?
Assez de paroles ! Des actes !
- les autorités responsables de la
ville ont peu de moyens (humains et matériels) pour affronter ces problèmes ;
le maire reste en compétition avec le préfet (qui autorise la création de
cabines téléphoniques en tôles ; qui confie la gestion de bâtiments publics à
des gérants privés ; qui, juste avant la création des communes, a laissé édifier
des constructions empiétant sur la voie publique) ; de son côté, le maire dit
trop souvent "à Djenné, nous sommes tous parents, il est difficile
d'imposer quelque chose à quelqu'un" ; en outre les textes qu'il devrait
appliquer sont totalement irréalistes (voir DJENNE PATRIMOINE Informations n°
14 sur les bases juridiques de la protection du paysage urbain...) ; enfin, les
services publics sont les premiers à donner le mauvais exemple, il suffit de
penser à la construction de l'école, à celle de l'hôpital, aux fils électriques
et du téléphone...) ; et les édiles eux-mêmes n'ont pas les idées claires
sur la question ;
- la ville
a instauré une taxe touristique ; on a montré son importance dans un article de
notre bulletin (voir DJENNE PATRIMOINE Informations n° 10 janvier 2001 et n° 11
juillet 2001) ; mais l'Office malien du tourisme et les agences de voyages
tempêtent et trouvent des appuis dans les ministères ! A un moment, après avoir
reçu plusieurs missions chargées (par qui ?) d'expliquer que ces taxes étaient
illégales, la mairie était tentée de supprimer cette taxe pour faire taire les
critiques de l'administration bamakoise. Mais ces missions et ces critiques visaient
essentiellement à vider l'autonomie des communes de tout contenu, et à
restaurer le pouvoir des services nationaux. La décentralisation est une idée
toute neuve au Mali !
Séminaire sous-régional sur les plans de gestion des
sites du Patrimoine Mondial
Le Président de DJENNE PATRIMOINE a participé à ce séminaire
organisé à Tombouctou par le Ministère de la Culture et l’UNRESCO, du 19 au 25
février 2004. Il y a en particulier été question de la restauration de la
medina (ancienne ville) de Tombouctou, qui devrait être prise en charge par
l’Italie.
Exposition des photographies de Sebastian Schutyser
Comme on l’a vu en première page
de ce bulletin, DJENNE PATRIMOINE a exposé, en décembre 2003 et janvier 2004
dix photos de Sebastian Schutyser devant la mosquée de Djenné, dix autres étant
tournées vers la mosquée et visibles seulement de sa terrasse. Cette exposition
a pu être réalisée grâce au concours de l’Ambassade du Royaume de Belgique au
mali et grâce à l’appui de la mairie de Djenné.
Ces photographies de mosquées
rurales du Delta intérieur du Niger avaient été exposées en novembre 2003 à
Bamako, dans le jardin de la mosquée Al Aqsa, grâce à l’Ambassade de Belgique.
Elles ont été très appréciées par tous ceux qui sont conscients de la valeur
inestimable de ce patrimoine typiquement malien, expression originale, et
unique au monde, des débuts de la foi islamique au Mali et de son renouveau en
diverses périodes historiques.
A Djenné, les grandes foules qui
fréquentent le marché en cette période de l’année où les récoltes
–exceptionnellement importantes cette année- sont terminées, se sont surtout
attachées à découvrir si la mosquée de leur village était représentée. Toutes
ne l’étaient pas, bien entendu. Celles qui avaient été sélectionnées étaient (de
gauche à droite sur la photo) celles de Tambéni, Togoé, Mindie, Bougouni,
Wango, Diombougou, Goudiouguel, Soumanbozo, Barkanielbi, Mayataké.
Pour ceux qui veulent découvrir
plus complètement ce patrimoine méconnu du Mali, signalons que Sebastian
Schutyser a publié un livre entièrement consacré à rendre compte de son
inventaire photographique de ces mosquées en terre du delta intérieur du Niger.
Ce livre s’intitule « Banco », il est publié aux éditions des 5
Continents. Il contient 65 photographies
pleine page et en miniature la totalité des 696 mosquées rurales inventoriées
par l’auteur dans le Delta intérieur.
Sebastian Schutyser est né en
1968 à Bruges. Il a passé son enfance au Zaïre (le Congo actuel). Après une
licence en sciences politiques à l’université de Gand, il a entrepris dans la
même ville des études de photographie à l’Académie Royale des Beaux-Arts.
En 1996 il traverse le Mali en vélo, réalisant une série de portraits en
couleur. Grâce à ce travail, il est lauréat du prix de la Fondation Belge pour
la Vocation. Dès 1998 Sebastian Schutyser consacre une grande partie de sa vie
professionnelle à un inventaire photographique des mosquées en terre du delta
intérieur du fleuve Niger. Après avoir obtenu le prix des amis de l’UNESCO
(dans le cadre du 13e prix national ‘Photographie ouverte’), le Aga Khan Trust
for Culture lui accorde son appui pour ce travail en cours. Ses photographies
sont présentées à Bruxelles (Musée Royal d’Afrique de Tervuren , 2000), à
Paris (Maison Européenne de la Photographie, 2002), et récemment à Frankfurt (Deutsches
Architektur Museum, 2003). La présence de ces images aux Rencontres de la
Photographie Africaine à Bamako (2003), où le livre sera également présenté,
est pour Sebastian Schutyser le couronnement ultime de son travail. C’est aussi
sa contribution à la valorisation de ce patrimoine culturel formidable au milieu
même du Mali.
Prix & bourses
Lauréat de la Fondation Belge de la Vocation (1996).
Lauréat du 12e Prix National Photographie Ouverte (1998).
Lauréat du 13e Prix National Photographie Ouverte, Prix des Amis de l'Unesco
(2000)
Bourse de la Fondation Aga Khan
pour le projet ‘Mud Mosques’ (2001).
Bourse ‘Documentaire Fotografie Opdrachten Vlaanderen’ pour le projet ‘Blauw’
(2001).
Prix de la Fondation Belge de la
Vocation, 2004
Expositions
1997 : Exposition de groupe, Gravensteen, Gand (Belgique)
1998 : ‘Mali Portraits’, Galerie De Lege Ruimte, Gand
(Belgique)
1998 : ‘12e Prix National de Photographie
Ouverte’, Musée de la Photographie, Charleroi (Belgique)
1998 : ‘Mali Portraits’, Centre
Culturel de Leopoldsburg (Belgique)
1999 : Exposition de groupe, Galerie De Lege Ruimte, Gand (Belgique)
2000 : ‘Mud Mosques’, Musée Royal d’Afrique Centrale, Tervuren
(Belgique)
2000 : ‘13e Prix
National de Photographie Ouverte’, Musée de la Photographie, Charleroi (Belgique)
2000 : ‘Africa Inside (Noorderlicht
foto festival 2000)’, Fries Museum,Leeuwarden (Pays-Bas)
2000 : ‘Pulo Debo’, Galerie
De Lege Ruimte, Gand (Belgique)
2000 : ‘Mali Portraits’,
Stadsschouwburg, Bruges (Belgique)
2001 : ‘Mali Portraits’, Cultureel
Centrum, Evergem (Belgique)
2002 : ‘Mosquées en
terre du Mali’, Maison Européenne de la Photographie, Paris (France)
2003 : ‘Lehmmoscheen in Mali’, Deutsches Architektur
Museum, Frankfurt (Allemagne)
2003 : ‘Mosquées en terre du
Mali’, Festival Couleur Cafe, Bruxelles (Belgique)
2003 : ‘Mosquées en terre du
Mali’, Cour du beffroi, Bruges (Belgique)
2003 : ‘Mosquées en terre du Mali’, Rencontres de la Photographie
Africaine, Bamako (Mali)
Publications
‘Van Dyck 1999, een terugblik’ , 1999, Antwerpen Open, ISBN 90-5846-037-1, (Pays-Bas).
‘Africa Inside’, 2000, Stichting Fotografie Noorderlicht, ISBN
90-76703-05-1, (Pays-Bas).
‘Eigen Volk’, 2001, Roularta Books, ISBN 90-5466-480-0, (Pays-Bas).
‘Les
Mosquées en terre du Mali’, 2002, Maison Européenne de la Photographie,
ISBN 2-914423-12-7, (France).
‘Bruges’, 2002, Mercatorfonds, ISBN 90-6153-500-X, (France). (existe
aussi en anglais et en néerlandais).
‘Blauw’, 2002, ‘Documentaire Fotografie Opdrachten Vlaanderen’, ISBN
90-77249-01-X, (Pays-Bas, Angleterre).
‘Lehmmoscheen in Mali’, 2003,
Junius Verlag, ISBN 3-88506-520-7, (D)
‘Banco, Mosquées en terre du delta intérieur du fleuve Niger’, 2003, 5
Continents Editions, ISBN 88-7439-054-8, (France). (existe aussi en anglais et
en italien).
N.B. Sebastian Schutyser avait
autorisé DJENNE PATRIMOINE à joindre au numéro 12 de DJENNE PATRIMOINE Informations
(janvier 2002) une magnifique photo de la mosquée de Diombougou. Qu’il en soit
une nouvelle fois remercié !
| |
 |
 |
|
|
| |
Deux photographies
de Sebastian Schutyser, avec son aimable autorisation |
|
|
___________________________________________________________
DOCUMENT 1
Chanter
le Prophète à Djenné :
comment la musique fait surgir la
cité musulmane
Gilles HOLDER &
Emmanuelle OLIVIER
Djenné, cité deux fois millénaire, convoitée par tous les
grands empires au cours de la longue histoire de l’Afrique de l’ouest, demeurée
riche et prospère tant que les grandes routes commerciales trans-africaines
étaient terrestres, est aujourd’hui une petite ville secondaire d’environ 15
000 habitants. Engagée dans le processus démocratique malien, Djenné prend acte
de la décentralisation de l’État et de la création de communes sur l’ensemble
du territoire national pour réinvestir les multiples identités urbaines qui
l’ont façonnée au fil du temps, tout en maintenant son statut de cité sainte de
l’islam qu’elle manifeste depuis plus de sept cents ans.
De l’extérieur, Djenné se donne à voir dans une unité qui
semble tout droit sortie d’un passé immuable, une ville dense et compacte qui
se caractérise par son architecture de terre baptisée “ soudanaise ”,
dont le chef-d’œuvre serait sa grande mosquée ; autant d’éléments qui ont
conduit l’UNESCO à inscrire “ les villes anciennes de Djenné ” – ce
qui signale déjà une pluralité – sur la liste du patrimoine mondial en 1988.
Mais de l’intérieur, Djenné apparaît au contraire dans sa dimension plurielle,
son hétérogénéité sociale, son plurilinguisme et son organisation politique
polycentrée qui révèlent
un espace urbain fait de quartiers articulés en deux moitiés dites
respectivement “ En ville ” (koyra kuna) et “ En
brousse ” (ganji kuna).
De cette ville contrastée, à la fois imaginée et vécue,
entière et fracturée, passée et contemporaine, les gens de Djenné n’ont de
cesse de faire coïncider l’endroit avec l’envers, la cité réelle avec la cité
musulmane, à travers
une série d’actes politiques qui passent notamment par la préservation
et la re-création d’un répertoire musical remarquable appelé localement maduhu.
Ce qui suit n’est qu’une simple esquisse où l’on veut
simplement décrire les modalités selon lesquelles la cité musulmane apparaît
aujourd’hui à Djenné, en l’occurrence comme une cité idéale, hors du temps, qui
émerge précisément à travers la performance de ces chants maduhu. La
ville opère là une sorte de réorganisation temporaire, mais répétée et chaque
fois nécessaire, de la cité réelle, en jouant de toutes ses dimensions
temporelles, spatiales, linguistiques et artistiques. Ce processus doit être
compris comme un effort toujours actuel et foncièrement original pour redéfinir
la place de Djenné dans l’espace (le Mali, l’Afrique, le monde musulman et le
monde tout court) et le temps (de l’histoire précoloniale à aujourd’hui, en
passant par la colonisation). Mais il s’accompagne aussi d’un réaménagement de
chacun de ses lieux et de ses hiérarchies internes et d’une redéfinition
ponctuelle de la place de chaque individu dans la constitution même de la cité.
Le maduhu comme métaphore musicale de la cité
musulmane
Dans la langue songhay de Djenné,
le terme maduhu désigne à la fois le genre de la poésie panégyrique (de
l’arabe madih ou madh) et les poèmes eux-mêmes (madiha).
Présents dans quasiment tout le monde musulman, ces poèmes en forme de louanges
s’adressent à l’origine au Prophète, mais ils sont également exécutés pour les
souverains, les grands dignitaires ou les savants musulmans.
Quels que soient l’auteur et l’époque, ces louanges sont soumises à des règles
prosodiques et poétiques qui ont donné lieu à de nombreux écrits théoriques,
dont les plus anciens remontent à la fin du IXe siècle, la grande
époque de l’identité musulmane, et sont donc postérieurs au Prophète de quelque
deux cents ans.
À Djenné, les maduhu s’inspirent de l’hagiographie
religieuse du Prophète, mais aussi de celle des saints et des maîtres
coraniques de la cité musulmane, tout en coexistant avec différents répertoires
musicaux non religieux, comme les “ chant de louanges ” (cèè-kaati
don), qui célèbrent les grands hommes de la cité réelle. Mais contrairement
au Coran et à d’autres textes religieux simplement “ récités ” (cow),
les maduhu sont chantés a cappella (don), ce qui les
distingue par ailleurs des chants profanes, soutenus quant à eux par des
instruments rythmiques ou mélodiques souvent accompagnés par la danse. En outre,
les maduhu sont des textes religieux écrits en arabe qui ne sont chantés
que par des hommes jeunes, élèves et maîtres coraniques, tandis que les chants
profanes s’inscrivent dans l’oralité, exécutés par des hommes et des femmes de
tout âge dans les diverses langues vernaculaires.
Cette distinction de registres entre chants sacrés et chants
profanes révèle d’emblée une opposition entre l’unicité de la cité musulmane et
la pluralité linguistique et identitaire de la cité réelle.
Lorsque les chants profanes mettent en scène et expriment pleinement
l’hétérogénéité sociale de la ville à travers une variété linguistique et
culturelle dont témoigne chaque quartier, les maduhu réalisent au
contraire l’intégration de tous les gens de Djenné au sein d’une communauté
musulmane idéale.
Le répertoire du maduhu de Djenné comprend notamment
d’anciens poèmes, locaux ou non, conservés par les vieilles familles
maraboutiques de la ville, mais dont l’origine a le plus souvent été perdue.
Lorsqu’ils sont exhumés et remis au goût du jour, on dit alors littéralement
qu’on les “ a fait sortir ” (fata-ndi) ; cela signifie
que leur possesseur, qui s’affiche là comme un membre d’une des prestigieuses
familles censées détenir une partie du patrimoine historique et religieux de Djenné,
les a désormais rendus publics. Mais ce répertoire compte également des poèmes
qui ont été “ créés ”, au sens d’une simple “ fabrication ”
ou d’une “ transformation ” (hinsa), puisque la
“ création ” pure (taka) est le fait de Dieu seul. Pour autant,
que le chanteur retravaille des textes anciens ou qu’il en produise de
nouveaux, le processus est toujours le même : à l’instar de la cité
musulmane, prise comme utopie jamais totalement réalisée, comme promesse jamais
complètement advenue, le maduhu est un matériau par essence en devenir,
une sorte de chant idéal, qui ne vaut que le temps de sa réalisation et dont la
vocation est d’être sans cesse transmis, recomposé et remis à la fois au
et en public.
Lorsqu’on “ fait sortir ” ou lorsqu’on
“ fabrique ” un poème, on compose ou varie une mélodie qui sera
réservée dans un premier temps à l’entourage familial et à la sphère de
sociabilité restreinte. Si le maduhu emporte l’adhésion de ce public
choisi, il pourra être diffusé à une plus large échelle, en particulier lors
des veillées religieuses du mois qui marque l’anniversaire de la naissance du
Prophète, le Maouloud ; ce sera là l’ultime étape avant qu’il ne soit
rendu public au sens strict du terme. Dès lors, l’auteur cède ses droits sur le
texte et le chant à quiconque voudra. Mais tandis que le texte est diffusé par
le biais de copies généralement manuscrites, le chant proprement dit, qui n’est
pas écrit, demeure quant à lui transmis de bouche à oreille.
Toutefois, comme on l’imagine sans peine, au-delà de la
dimension religieuse, de l’acte pieux en lui-même, chanter publiquement un
nouveau maduhu est aussi, pour le chanteur et sa famille, une manière de
se placer sur le devant de la scène. En effet, ces chants de louanges
réaffirment (ou réhabilitent) par la même occasion le pouvoir des grandes
familles maraboutiques de la ville, pouvoir qui se fonde sur un savoir à la
fois religieux, poétique et musical et qui, parce qu’il est capable de susciter
provisoirement la cité musulmane dans cet espace artistique et ce temps de fête
religieuse, va jusqu’à se substituer au pouvoir politique de la cité réelle.
Les maduhu et la redéfinition des espaces privés et
publics
Les maduhu sont exécutés dans des circonstances
privées ou publiques qui, à l’occasion de processions rassemblant une foule
plus ou moins importante, permettent une recomposition temporaire des espaces
urbains. La circoncision, le mariage, l’achèvement de la lecture du Coran par
un élève, le retour de pèlerinage à La Mecque sont autant de circonstances
privées qui entraînent la mise en place d’itinéraires processionnels
s’élargissant corrélativement aux espaces investis, de la maison au quartier,
puis à la moitié de la ville et enfin à la ville entière. Parallèlement à cette
occupation de l’espace, les maduhu révèlent des sphères de sociabilité,
qui vont des membres de la famille aux habitants du quartier, puis à ceux de la
moitié “ Ville ” ou “ Brousse ”, et enfin à la population
urbaine tout entière ; plus l’itinéraire de procession s’étend, plus le
nombre de participants s’accroît.
À cet égard, le cas le plus significatif est sans doute le
retour de pèlerinage. En effet, c’est là l’occasion pour quiconque de se
joindre à la procession qui se forme à l’entrée de la ville pour se rendre à la
mosquée, puis de là au domicile du pèlerin. Or, quel que soit le nombre de
participants, cette procession demeure, strictement parlant, un acte de piété
d’ordre privé, l’achèvement d’une initiative familiale, mais aussi
individuelle. Si le pèlerinage s’effectue souvent en groupe, s’il relève d’une
obligation et s’il se situe dans un moment particulier du calendrier musulman –
le douzième mois de l’année (Dhu al-Hijja en arabe ou jingar-beer
handu, litt. “ le mois de la grande fête ” en songhay) –, tout le
monde ne l’effectue pas en même temps et nombreux sont les croyants qui ne
pourront jamais accomplir un tel devoir.
Certes, comme beaucoup d’actes de la vie privée en islam –
catégorie qui ne recouvre pas tout à fait le même champ que dans la tradition
juridique occidentale, où les deux sphères privée et publique sont plus
nettement distinguées –, cette initiative n’exclut pas une certaine publicité,
d’autant qu’elle utilise l’espace collectif, en l’occurrence la rue principale
qui traverse la ville de part en part, et qu’elle passe par ce lieu unique,
central et unificateur qu’est la grande mosquée. Mais si elle revêt une
dimension publique et recentre la cité réelle morcelée en quartiers autour de
la grande mosquée, cette initiative demeure en partie dans la sphère
privée ; et c’est du reste à l’intérieur du vestibule du pèlerin que
s’achèveront procession et exécution du maduhu. En outre, tout en étant
un événement religieux, solennel et célébré publiquement, le retour du
pèlerinage ne mobilise pas l’ensemble de la cité comme le font les trois fêtes
annuelles obligatoires que sont la “ Naissance du Prophète ” (Mawli
al-Nabi ou Mawulud en arabe ; almudu en songhay),
la fin du “ mois de jeûne ” (ramadan en arabe ; hawu-mèè
handu, litt. “ mois de la bouche fermée ” en songhay) et le
“ sacrifice du mouton ” (‘Id ad-Adha,‘Id al-Kebir ou Tabaski
en arabe ; cuusi en songhay). Revenir du pèlerinage n’engendre pas
pour la cité tout entière l’obligation sociale et religieuse de fêter
l’évènement ; c’est l’affaire de chacun de se joindre ou non à la
procession et à la prière.
La Mecque, Médine,
Djenné : le temps et l’espace de la cité musulmane
Que la circonstance soit privée ou publique, chaque
procession religieuse est l’occasion d’exécuter un maduhu particulier
intitulé assalatow (de l’arabe as-Salat, “ la
Prière ”). La singularité musicale de ce chant tient au fait que les
strophes en sont entonnées par un soliste auquel répond un chœur chantant le
refrain, alors que les autres maduhu sont quant à eux exécutés soit par
un soliste soit par un chœur. La structure spécifique qui est ici adoptée pour
accompagner une procession témoigne en fait d’un double processus
d’individualisation et de mutualisation instaurant une nouvelle articulation
entre le privé et public – un continuum clairement souligné par
l’itinéraire qui conduit de la rue à la maison – conforme à la cité musulmane.
Contrairement à la cité réelle, dans laquelle le pouvoir et le droit délimitent
des espaces différenciés et inégalement accessibles à chacun, l’espace privé se
confond ici avec l’espace public, ce qui permet de redéfinir temporairement les
limites sociales, économiques et politiques de la cité réelle à l’aune d’une
cité idéale dont le modèle est Médine.
La tradition veut en effet que ce chant assalatow ait
été exécuté pour la première fois par les habitants de Médine pour accueillir
le Prophète lorsqu’il fut contraint de quitter La Mecque. Aussi, en
s’inscrivant dans la commémoration de cet événement fondateur de l’islam, toute
procession religieuse privée ou publique qui se déroule à Djenné est-elle
accompagnée de ce chant. On y rejoue symboliquement l’Hégire, l’émigration du
Prophète de La Mecque à Médine marquant le temps I de l’islam, un temps à la
fois historique et calendaire, dont les moments forts sont précisément le
Maouloud, le Ramadan, la Tabaski et, bien sûr, le pèlerinage à La Mecque.
En reliant ces deux cités paradigmatiques que sont Médine et
La Mecque, le maduhu produit ipso facto, c’est-à-dire instaure de
façon immédiate, une nouvelle organisation politique, sociale et religieuse qui
s’inscrit à la fois dans le temps de l’Hégire et dans l’espace de la cité
musulmane. Et c’est comme performance, au sens littéral de mise en forme,
que ce chant fait alors de Djenné, certes de façon temporaire, mais répétée,
une cité musulmane. Mieux encore : en réalisant une synthèse de l’histoire
– le temps de l’islam – et du mythe – la cité idéale –, le chant assalatow
permet de faire correspondre la Djenné réelle à l’étymologie religieuse de son
nom : aljènnè, c’est-à-dire “ Le Paradis ”.
Chanter pour faire surgir la cité musulmane de la cité
réelle
La cité musulmane se réalise ici par une opération
symbolique collective qui mobilise quatre dimensions : temporelle
(instauration du temps rituel et festif), spatiale (redéfinition de la
géographie et des itinéraires urbains), linguistique (usage spécifique de
l’arabe littéraire) et artistique (performation de chants consacrés). La
projection de la cité musulmane dans le monde tangible est une réorganisation
de la ville qui se traduit par une redéfinition de l’historicité, de la
temporalité, des lieux et des hiérarchies, pour aboutir à une mise en
perspective inédite de la cité dans sa globalité.
Or, c’est précisément le chant assalatow qui produit
ce phénomène, en un temps de festivités lié aux cérémonies privées ou au
calendrier musulman. Pour autant, d’un point de vue symbolique, ce chant n’est
pas la condition sine qua non du temps festif, mais plutôt celle de
l’Hégire ; seul ce dernier permet à la cité musulmane de se substituer à
la cité réelle en s’inscrivant dans une temporalité ouverte, ce que Reinhart
Koselleck appelle un “ horizon d’attentes ”.
Susciter Médine à Djenné, que ce soit lors du retour d’un pèlerinage ou lors du
transfert du marié de la maison familiale à la chambre nuptiale, est en effet
un “ champ d’expérience ”,
un moment à la fois individuel et collectif où le possible devient réalisable,
qui permet à la cité de réactualiser périodiquement son devenir.
De cette nouvelle temporalité, Djenné redéfinit
parallèlement son espace, et d’abord son espace global, qu’elle re-centre
autour de la grande mosquée et de son corollaire qu’est la “ place de
prière collective ” (sarkilla). Mais au-delà de cette unité de
lieu, la cité musulmane investit aussi les espaces multiples qui sont
habituellement réservés à la vie sociale, économique ou politique (places,
rues, vestibules, etc.), au fil des itinéraires processionnels et des lieux
d’assemblée auxquels elle attribue d’autres usages et des fonctions religieuses
inédites. Dès lors, en se vivant comme une nouvelle Médine, Djenné produit non
seulement le modèle de la “ cité sainte ” (al-Madîna al-Moqaddasa
en arabe), mais aussi celui de la ville par excellence : al-Madîna.
La réalisation tient ici à cet idéal urbain (opposé à rural) et religieux
(opposé à profane) que représente Médine dans l’imaginaire musulman.
Dès lors que le temps et l’espace de la cité musulmane sont
symboliquement instaurés, Djenné produit un nouvel ordre politique et social,
où les hiérarchies de la cité réelle sont remplacées par celles de
l’islam ; elles passent de l’égide d’une souveraineté temporelle (sultaan
en arabe ; kokoy en songhay) à celle d’une souveraineté religieuse
(le Prophète ou son représentant qu’est le calife, khalîfa en
arabe ; almam en songhay).
Mais cette substitution qui se fonde sur l’espace-temps instauré temporairement
par la cité musulmane ne saurait toutefois faire abstraction du temps et de
l’espace plus permanents de la cité réelle.
Du reste, si, dans la cité religieuse, l’imam, qui est un
calife du point de vue du droit public musulman, doit logiquement prendre la
place du chef de la ville, à Djenné, non seulement ces deux personnages
accusent la même singularité, mais par effet de conséquence, le chef de la
ville est aussi potentiellement imam. Tous deux détiennent en effet la même baraka
qui caractérise ceux que Dieu a désignés pour conduire la cité laïque comme la
cité religieuse. Et
précisément : lors de leur entrée en fonction, l’un comme l’autre
reçoivent le même grand turban blanc et la même bénédiction, tandis que leur
nomination est accompagnée du même chant assalatow.
Au-delà, la réversibilité des hiérarchies suprêmes est aussi
le signe qu’elles ne sont pas issues d’une logique sociale, économique ou même
politique, mais essentiellement d’une volonté divine. Or, de ce point de vue,
la cité musulmane introduit l’idée que chacun peut potentiellement occuper ces
fonctions éminentes. Dès lors, si la performance du chant assalatow
provoque une transformation ontologique de l’individu louangé, il suffit de
l’exécuter pour devenir à son tour imam ou chef de la ville. Et de fait,
lorsqu’un fidèle rentre de La Mecque ou, plus proche du quotidien des habitants
de la cité, lorsqu’un homme se marie, il est béni, reçoit un turban blanc et
porte le temps des cérémonies le titre symbolique de “ Souverain ” (asutan,
de l’arabe as-sultaan),
tandis que la foule assemblée lui chante assalatow. Ainsi, le temps de
cette performance musicale qui instaure la cité musulmane, le circoncis,
l’élève coranique, le marié ou le pèlerin deviennent de facto le
souverain de la ville. Or, pour symbolique que soit cette opération, elle n’en
provoque pas moins une fusion des sphères privée et publique, mais aussi
politique, révélant la singularité de l’individu religieux au sein de la
communauté des croyants.
Conclusion
Le temps du maduhu est celui de la cité musulmane,
une cité idéale qui se réalise de façon temporaire mais répétée par de
multiples opérations touchant à la fois aux catégories du privé et du public,
du collectif et de l’individuel, de la spatialité, de l’historicité et de la
temporalité, pour permettre à la cité réelle de trouver (ou retrouver) et
d’éprouver une unité politique qui se dissout d’ordinaire dans son quotidien
urbain.
Mais au-delà du seul fait religieux, le maduhu permet
aussi à Djenné de dire au monde qu’elle est la ville, l’une des trois
Médine du Mali (avec Tombouctou et Dia). À chaque fois qu’elle louange le
Prophète et qu’elle se pare sous les traits de Médine, elle réalise un acte
politique au sens plein du terme. Car chanter des maduhu ne fait pas
seulement de Djenné une cité musulmane idéale et intemporelle ; sans y
paraître, la ville ne s’adresse-t-elle pas aussi à l’État, dont la décentralisation
ne prendrait pas assez en compte sa spécificité de cité sainte, et à l’UNESCO,
dont la patrimonialisation au nom d’une humanité définie juridiquement (plutôt
que religieusement) inquiète. Si Djenné chante des maduhu depuis des
siècles pour s’identifier à la Médine du Prophète, elle chante aussi pour
affirmer avec force son statut urbain et sa contemporanéité.
Bibliographie
Al Faruqi, L., 1985,
“ Mawlid and malid: genres of Islamic religious musical art from the
Sultanate of ‘Uman ”, Paper presented at the International Symposium on
‘Umani Folklore, October, pp. 6-16.
Al-Mâwardî, 1992, Statuts gouvernementaux (Al-Ahkâm as-sultâniyya),
Paris, Sycomore, [rédigé au XIe siècle].
Gardet,
L., 1985, “ Islam –
La cité musulmane ”, in Encyclopædia Universalis.
Heath,
J., 1998, Dictionnaire
songhay – anglais – français. Tome II : Djenné chiini, Paris, L’Harmattan.
Holder, G., 2004, “ La Cité comme
statut politique. Places publiques, pratiques d’assemblée et citoyenneté au
Mali ”, in G. Holder & A.-M. Peatrik (s. dir.), Cité-État et
statut politique de la ville en Afrique et ailleurs, Journal des
Africanistes 74 (1-2), 31 p. [sous presse].
Jamous, R., 1981, Honneur et Baraka. Les
structures sociales traditionnelles dans le Rif, Paris/New York,
MSH-Cambridge University Press.
Koselleck, R., 1990, Le futur passé.
Paris, Éditions de l’EHESS.
Meredith-Owens, G., 1960, “ ‘Arud ”, in
H. A. R. Gibb, J. H. Kramers, É Lévi-Provençal, B. Lewis, C. Pellat & J.
Schacht (éds.), Encyclopédie de l’Islam, tome I, Paris/Leiden,
Maisonneuve & Larose/E. J. Brill, pp. 688-698.
Monts, L. P.,
1998, “ Islam in Liberia ”, in R. Stome (éd.), The Garland
Encyclopedia of World Music, New York and London, Garland Publishing, pp.
327-349.
Olivier, E., 2004, “ La petite musique
de la ville. Musique et construction de la citadinité à Djenné (Mali) ”, in
G. Holder & A.-M. Peatrik (s. dir.), Cité-État et statut politique de la
ville en Afrique et ailleurs, Journal des Africanistes 74 (1-2), 26
p. [sous presse].
Simon, A., 1980, “ Dikr und
Madih. Gesänge und Zeremonien Islamisches Brauchtum im Sudan ”,
Berlin, Museum Collection, MC10.
— 1998, “ Music in Sudan ”, in R. Stome (éd.), The
Garland Encyclopedia of World Music, New York and London, Garland
Publishing, pp. 549-573.
Topp Fargion, J., 2002,
“ The Music of Zenj: Arab-African crossovers in the music of
Zanzibar ”, Journal des Africanistes 72 (2), pp. 203-221.
Wickens, G. M.,
1986, “ Madih, Madh ”, in C. E. Bosworth, E. van Donzel, B.
Lewis & C. Pellat (éds.), Encyclopédie de l’Islam, t. V, Paris/Leiden,
Maisonneuve & Larose/E. J. Brill, pp. 959-968.
_____________________________________________________
Document 2
1.
Dans le Tarikh es-Soudan, chronique de l’Afrique de
l’Ouest datant du dix septième siècle, l’historien de Tombouctou, Abderrahaman
es-Sa'di, décrit une grave famine qui frappa cette ville en 1617 : "A tout
instant la situation devenait de plus en plus critique et chaque jour amenait
des événements plus graves que les précédents. Cette année-là la pluie fit
défaut. Les gens se mirent à faire des prières rituelles (al-istisqâ')
pour obtenir la chute des eaux du ciel, et ne cessèrent de les continuer pendant
environ quatorze jours sans que la sérénité du ciel fût un seul moment troublée.
A la fin cependant il tomba quelques gouttes de pluie." (Es-Sadi
1964:338)
En plus de la
prière rituelle (salât) qui doit être pratiquée cinq fois par jour, et
de la prière pour un défunt, l’Islam orthodoxe connaît trois autres prières,
dont le rituel est stipulé dans la Loi islamique : une prière pendant une
éclipse de lune, une autre en cas d’éclipse de soleil et une troisième pour
implorer la pluie en cas de sécheresse persistante (salât al-istisqâ').
On admet que ces trois prières particulières sont basées sur des rituels
magiques arabiques pré-islamiques. Il existe une tradition qui relate comment
Mahomet accomplissait un jour le salât al-istisqâ'. Le Prophète aurait
attaché tant de valeur à la prière pour la pluie qu’il apparut, après sa mort,
dans un rêve à quelqu’un en lui ordonnant de demander au Calife Omar de faire
la prière pour la pluie, afin de mettre fin à une longue période de sécheresse
(voir : Fahd 1978 : 270).
C’est surtout
dans ce dernier geste qu’on retrouve l’expression d’un caractère magique et
symbolique ou bien, comme on le nomme dans l’ancienne littérature, un caractère
sympathique. Le fait de renverser le manteau symbolise le basculement du temps.
Les commentateurs arabes, cités par Doutté (1909 : 592), traduisent la
signification de cet acte par : montrer avec insistance à Dieu que les
fidèles désirent « voir ‘tourner’ l’état de stérilité qui menace l’état
d’abondance. »
En 1986 je me suis entretenu à Djenné avec un marabout sur
le salât al-istisqâ'.
A cette époque la dernière grande période de sécheresse avait laissé ses traces
dans cette ville sahélienne. Le Sahel : les images du début des années
quatre-vingt nous sont encore trop connues ! La savane sèche au sud du
Sahara, appelée autrefois par les commerçants caravaniers arabes sâhil,
c’est-à-dire ‘côte’ du désert, nous rappelle, quand on parle de ‘pluie’, encore
une multitude de choses.
A Djenné ce marabout, un des nombreux enseignants du Coran
et spécialistes religieux que la ville héberge, me racontait comment en 1983
les habitants ont prié, à plusieurs reprises, pour implorer la clémence de
Dieu. « Pendant longtemps il ne pleuvait pas. Les hommes réclamaient de
l’eau. Les animaux, les plantes et les champs en demandaient aussi. Dans un
moment si difficile, on ne pouvait qu’implorer Dieu pour qu’il donne de l’eau
pour l’homme, l’animal et la plante. On demande alors à Dieu la pluie. »
C’est ainsi que à plusieurs reprises, en 1983,
des prières salât al-istisqâ’ ont été organisées sur la grande place de
prière en plein air, au bord occidental de la ville. Dans ces prières l’imam
demandait à Dieu d’avoir pitié de ses fidèles et de leur envoyer Sa bonté. Le
marabout ne m’a pas dit si les prières avaient été exaucées. Le souvenir des
années 1983 et 1984 était encore vivant dans les esprits.
Après deux
années de pluviométrie relativement bonnes et des récoltes assez raisonnables,
les premières pluies de juin et juillet de l’année 1987 tardaient de nouveau à
venir dans une grande partie du Mali. Les habitants de Djenné qui avaient déjà
ensemencé leurs champs, attendaient en vain la pluie et voyaient les jeunes
pousses se racornir. La peur d’une répétition de la situation du début des
années quatre-vingt les envahissait. Le temps était de nouveau au centre des
conversations de la journée. A la mi-juillet, après la prière de vendredi, un
appel fut lancé au nom de l’imam et du ‘chef de village’ pour organiser des
réunions afin d’obtenir la pluie. Contrairement aux habitudes des grandes
périodes de sécheresse du début des années quatre-vingt, en 1987 on ne pratiqua
pas cette fois-ci le salât al-istisqâ'. Certes, cette prière, faisant partie de l’Islam
orthodoxe, n’est utilisée qu’en temps de grande sécheresse. Le moment
n’était-il pas encore arrivé pour cela ? Le temps d’attente ne
justifiait-il pas encore l’organisation du salât
al-istisqâ' ? Il est important de savoir ici que,
pendant les mois de juillet et d’août 1987, un bon nombre d’autres activités
furent organisées pour implorer la pluie. C’est à ces activités que je
voudrais, dans cette contribution, m’intéresser. Un accent particulier est mis
ici sur le rôle des marabouts.
Dans les
descriptions qui suivent, il apparaît que ces autres activités diverses qui ont
eu lieu en 1987 dans la ville de Djenné en vue de l’obtention de la pluie, à la différence de la salât al-istisqâ',
ne font pas partie de l’Islam formel ; c’est à dire qu’elles ne sont pas
stipulées dans la Loi islamique (l’ensemble des prescriptions
juridico-religieuses qui doivent régir la communauté des croyants et qui repose
sur le Coran et la sunna). Elles appartiendraient au domaine des
croyances et pratiques qui peuvent être classées sous le dénominateur de
l’Islam « local ».
2.
Comme
on l’a déjà souligné, cette contribution met un accent particulier sur le rôle
des marabouts. A propos des marabouts en Afrique du Nord, où d’ailleurs le
terme est plus synonyme de ‘saint’, Doutté écrit au début du siècle dernier
qu’une des plus importantes de leurs fonctions est « de faire tomber
l’eau » (1909 :590). Le récit de la conversion du roi du Mala, petit
Etat dans le Mandé, pendant le onzième siècle, montre bien quel rôle important
ces marabouts, faiseurs de pluie, ont pu jouer dans l’islamisation de l’Afrique
de l’Ouest. « Le petit royaume de Mala, au-delà du haut
Sénégal, était affecté par la sécheresse année après année. Toutes les prières
et les sacrifices des prêtres du lieu étaient restés vains. Alors un Musulman
promit que, si le Roi se convertissait à l’Islam, il prierait pour lui porter
secours. Comme le souverain fut d’accord, le Musulman lui apprit ‘à réciter
certains passages faciles du Coran et l’instruisit dans les obligations
religieuses que personne ne peut être pardonné d’ignorer’. Le vendredi qui
suivit, après que le Roi se fut purifié, les deux s’en allèrent vers une
colline proche. Toute la nuit, le Musulman pria, imité par le Roi. ‘L’aube
commençait juste à poindre qu’Allah envoya une pluie abondante. Le Roi ordonna
qu’on brise les idoles, il chassa ses sorciers, et il se fit Musulman avec sa
famille et toute la noblesse. Mais le commun resta païen’ (Levtzion,
1979 :210 ; les citations sont de Al Bakrï « Description de
l’Afrique septentrionale », 1913)
Quand
en juillet 1987 les pluies ne venaient pas, quelques marabouts
de Djenné me disaient que, individuellement, ils faisaient ‘quelque chose’ pour
obtenir de la pluie, quelque chose avec le nom de Dieu. Du peu qu’ils ont voulu
me révéler à ce propos, il était évident pour moi que ces marabouts
pratiquaient une forme de maraboutage, identique ou fort semblable à celle que
je décrirai ci-dessous.
Quand
un marabout va demander de la pluie –bana narey en Songhaï ;
littéralement : ‘demander la pluie’– il commence par transcrire le tableau
ci-dessous sur sa tablette à écrire. Le tableau contient six signes différents.
Ces six signes magiques font partie des sab`a hawâtim (les sept signes)
qui, ensemble, forment ‘le nom suprême’ de Dieu (al-ism al-a`zam) :
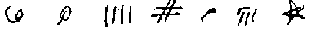
Le
signe qui manque sur chaque ligne est remplacé par le mot arabe ghait (pluie).
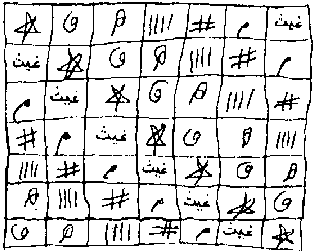
Le
tableau et son mode d’emploi pour « implorer la pluie » m’ont été
remis par un jeune marabout –originaire des environs de Djenné– et ont servi
d’exemple au centre de nos conversations sur l’usage du nom suprême de Dieu
dans le maraboutage. Le signe du ‘nom
suprême’ qui manque dans le tableau et qui est remplacé par le mot ‘pluie’
correspond au jour pendant lequel le rituel est exécuté. Dans l’exemple donné cela correspond au deuxième signe, à gauche
de l’étoile, c’est-à-dire le lundi. En écrivant le ‘souhait’ à sa juste place
dans les cellules du tableau, le marabout établit et fortifie le lien entre le
jour pendant lequel le rituel magique est exécuté et le résultat souhaité. Une
fois que le marabout a fini d’écrire le tableau sur sa planchette, il la place
au soleil sur le toit de sa maison. Ensuite il s’installe à l’intérieur de la
maison, prend son chapelet (tashiba) et débute les mille cinq cent dix
récitations du ‘nom suprême’ de Dieu. Ce nombre de récitations est déterminé
par la valeur numérique du mot ghait.
Dans
la magie islamique –analogue à la kabbale– chaque lettre de l’alphabet arabe a
sa propre valeur numérique. Les trois lettres qui forment le mot ‘pluie’ (ghait)
ont la valeur numérique de 1510 : ghayn = 1000, yâ’ = 10 et thâ’
= 500. Alors, le marabout doit réciter mille cinq cent dix fois le nom suprême
de Dieu pour implorer la pluie.
Les
sept signes qui ensemble forment ‘le nom suprême’ de Dieu, comme le soulignait
le marabout, sont importants dans beaucoup de formes de maraboutage. Chaque
amulette qu’il écrit commence par ces signes. Ces sept signes existent depuis
le temps du Prophète. Quand les anciens marabouts discutaient du nom suprême de
Dieu, Ali –le cousin et beau-fils du Prophète– leur donna les sept signes et
leur enseigna comment ils doivent être prononcés. Dans la littérature les sab`a
hawatim sont associés au roi Salomon.
C’étaient ses sceaux. Le pentagramme ornait sa bague. Avec les sept signes,
Salomon, roi sage et magicien, à qui l’Islam attribue toute connaissance de la
magie blanche, a un jour exorcisé un mauvais esprit. Dans une collection
médiévale de poèmes et aphorismes attribués à Ali, on peut cependant lire que
ce fut le beau-fils du Prophète qui interpréta les sept signes comme le ‘nom
suprême’ de Dieu. Ces écrits rapportent comment Ali a trouvé ces sept signes,
gravés dans un rocher, et comment il les a décrits dans un poème. (Voir :
Winkler 1930 ; 65-66).
Le
marabout racontait que les directives pour l’exécution du rituel magique,
mentionné ci-dessus, afin d’obtenir les pluies, sont prescrites dans les
livres. Effectivement, le guide pour composer le tableau avec les sept signes
et pour utiliser le ‘nom suprême’ de Dieu, tout cela peut être trouvé dans les
livres arabes et dans les écrits qui traitent de magie (sihr). Le
tableau avec les signes peut également être utilisé à d’autres fins, par
exemple pour ‘attacher’ une femme, pour guérir un malade ou pour avoir du succès
dans les affaires. Le principe est simple. Le ‘souhait’ doit être écrit dans la
cellule du signe qui correspond au jour pendant lequel le tableau est écrit et
les récitations sont exécutées. A partir de ce mot on calcule sa valeur
numérique, et ainsi il peut alors être déterminé combien de fois ‘le nom
suprême’ doit être récité.
Cependant
il arrive que l’on doive faire plus pour obtenir le résultat souhaité. En
demandant la pluie, le marabout ne doit pas se limiter aux seules actions
traitées ici. Car on doit toujours tenir compte du fait qu’il existe d’autres
marabouts ayant de moins bonnes intentions et qui pourraient se servir de leurs
pouvoirs pour s’opposer à la venue des pluies. Tout marabout a appris de son
maître comment une telle opposition éventuelle peut être contrariée et
désarmée. Aussi, avant de commencer les récitations du ‘nom suprême’ de Dieu,
le marabout met sur le toit de sa maison, derrière une gargouille, un petit tas
de sable. Il place une pierre par dessus. Sur la pierre ou bien sur un papier
sur elle se trouve écrit le tableau avec les signes. Le marabout, assis
derrière la pierre, verse de l’eau sur le sable, aussi longtemps qu’il faudra
pour que tout le sable soit emporté et que la pierre se pose sur le toit en
argile. C’est cette action qui doit empêcher que d’autres ne retiennent la
pluie. Son caractère symbolique n’est pas difficile à saisir. L’eau qui évacue
le sable à travers la gargouille, représente les pluies souhaitées, qui quand
elles tombent sur le toit, enlèvent la partie supérieure de l’enduit argileux
du toit, seront évacuées à travers les gargouilles et s’abattront comme des
petites chutes d’eau dans la rue. La pierre sur laquelle se trouve le tableau
magique - bien posée sur le toit et non immergée dans l’eau – indique l’espace
où devrait tomber la pluie. En outre, la pierre peut éventuellement être vue
comme symbole de la terre durcie par la longue période de sécheresse. Doutté
(1909 : 587-588) décrit les rites de pluie très répandus en Afrique du
Nord où des sacs pleins de pierres sont immergés dans un fleuve.
Après
que le maître du marabout lui a appris comment il doit se servir de la pierre
et de l’eau, il lui a, en plus, remis un nombre de versets spéciaux du Coran.
Il pourra se servir de ces citations du Coran ‘pour guider les nuages’.
Aussitôt que le marabout voit approcher des nuages de pluie suite à ses
incantations, il doit aller dehors et, en récitant silencieusement les versets
du Coran, attirer ces nuages vers lui. Il empêchera ainsi qu’un marabout, pour le
contrarier éventuellement, ne disperse les nuages sombres qui contiennent les
pluies longuement attendues.
3.
En
plus d’une prière individuelle, les marabouts peuvent également prier
collectivement pour la pluie. Bien que des rituels pareils ne soient pas
strictement réservés aux marabouts, ces derniers forment cependant bien souvent
le plus grand groupe parmi les participants. Comme déjà dit, un appel fut lancé
vers la mi-juillet 1987 dans la mosquée de Djenné, au nom de l’imam et du ‘chef
de village’, pour tenir des rassemblements de prières pour la pluie. Après cet
appel, pendant trois jours de suite, un grand nombre de marabouts et certains
vieillards se rassemblaient le matin, vers neuf heures dans la mosquée pour
lire le Dalâ'il al-Khairât. Ce long poème en honneur du Prophète était
lu sept fois. Les pages de ce poème étaient distribuées aux lecteurs. Chacun
lisait simultanément sa part. Les fidèles amenaient gracieusement des dons à la
mosquée, la plupart du temps une ou plusieurs pièces d’argent, qui étaient
distribuées aux lecteurs à la fin de la prière.
Après ces rassemblements dans la
mosquée, le Dalâ’il fut récité, pendant la même semaine, dans un grand
nombre d’écoles coraniques. Chaque marabout le lisait dans sa propre école,
ensemble avec ses assistants, les membres de sa famille et ses ex-élèves. Les
pages étaient distribuées entre les lecteurs. Dans certaines écoles le poème
était intégralement lu trois fois, dans d’autres une fois. Après
cette lecture une longue série de bénédictions (gara) était prononcée
pour que Dieu protège la vile et ses habitants, leur donne la prospérité et des
pluies abondantes.
Le
Dalâ'il al-Khairât est un chant de louange au Prophète Mohammed écrit au
quinzième siècle par le Berbère Muhammad Abû `Abdallâh al-Jazûlî (décédé en
1465). C’est un recueil de prières pour le Prophète qui contient, entre autres,
une litanie de ses noms et une description de son tombeau. Comme partout
ailleurs dans le monde musulman, ce livre jouit d’un usage fréquent à Djenné.
Il est lu à l’occasion de rassemblements mortuaires. On peut le réciter
individuellement et, en honorant ainsi le Prophète, obtenir le salut personnel.
Certains mots de cette prière pourraient même, comme certaines citations du
Coran, être utilisés dans la magie. Le Dalâ’il est, en plus de son
pouvoir d’obtenir la pluie, également récité par des marabouts dans la mosquée
en temps de malheur. On le lit pour ‘honorer le Prophète, pour conjurer le mal
et attirer le bien’. Ainsi le Dalâ’il fut lu en décembre 1985 par les marabouts
de Djenné pendant la guerre frontalière entre le Mali et le Burkina Faso, pour
que cesse rapidement le conflit. Cette fois-ci la demande de tenir des
rassemblements émanait des autorités maliennes. Six mois plus tard les
marabouts se rassemblaient pour lire le Dalâ’il afin de faire face à une
invasion de sauterelles.
Un
marabout me disait un jour que le Dalâ'il al-Khairât est ‘un livre
important’, et il m’illustrait son importance ainsi : « Il y a longtemps quelques
marabouts savants discutaient entre eux : De fait quel est le livre le
plus important ? Pour se départager, ils décidèrent de laisser,
durant toute une nuit dans une chambre fermée, un certain nombre de livres
entassés de façon arbitraire. Parmi ces livres se trouvaient aussi bien le Coran
que le Dalâ’il. Quand ils ont réouvert la porte de la chambre le
lendemain, ils ont trouvé le Coran à côté du tas avec le Dalâ’il
dessus. »
4.
Les marabouts et les autres hommes
pieux récitaient le Dalâ'il al-Khairât dans la mosquée et dans les écoles
coraniques pour implorer la venue de la pluie, tandis que les femmes et les
enfants sortaient dans la rue pour demander la pluie. Durant trois matinées un
cortège d’enfants marchait en chantant à travers la ville. Un grand groupe
d’environ cent garçons et filles marchait derrière une quinzaine de femmes et
un homme qui étaient eux, précédés par trois vieilles femmes. Ces femmes
avaient chacune un bâton en main. Les bâtons ont appartenu par le passé à trois
saints qui sont enterrés à Djenné. Les vieilles femmes étaient leurs
descendantes. L’homme était, par sa lignée maternelle, apparenté à deux de ces
trois saints.
Trois cent trente trois saints (walidyu)
sont enterrés à Djenné.
Bien que les tombeaux des saints soient, à une ou deux exceptions près, à peine
reconnaissables en tant que tels, –donc pas comme dans le Maghreb où ils
forment le centre d’un vaste culte et de pèlerinages–, l’intermédiation des saints est
quand même recherchée dans certains cas. Et c’est ainsi également quand les
pluies tardent à venir.
Marty écrit, quand il parle des
différents tombeaux à Djenné : "En 1913-1914, année de la famine, on
vit de grandes processions de femmes autour des tombeaux ; beaucoup, mariées
ou jeunes filles, s'étaient attaché les bras derrière le dos pour marquer leur
impuissance. Elles se couchaient sur les tombeaux, et criaient en se roulant:
'Grand marabout, donne-nous la pluie; que par ton intercession Allah nous
ramène la prospérité.'" (1920:245)
L’année
1987 n’a pas connu de telles scènes. Le cortège de femmes et d’enfants, précédé
par les trois porteuses de bâtons et l’homme, traversait la ville en chantant.
L’homme entonnait, en arabe, et tout le groupe répétait. La profession de foi (shahâda)
–‘il n’y a d’autre divinité que Dieu, et Mohammed est Son Envoyé’– était
souvent répétée, alternée avec, également en arabe : « Dis : Lui,
c’est le Dieu Un, le Dieu Eternel, qui n’a pas engendré, qui n’a pas d’égal.»
(sourate 112) Le cortège, en s’arrêtant de temps en temps, passait auprès des
lieux où les saints sont enterrés et auprès du tombeau de la vierge qui, selon
la légende, aurait été emmurée vivante dans les murailles de Djenné lors de sa
fondation. En chantant, le cortège s’arrêtait un moment près de quelques
tombeaux à l’intérieur de la ville. Il s’agit des anciens cimetières auxquels
les colons français s’étaient opposés à l’époque, et qui se trouvent maintenant
abandonnés. Ensuite le cortège s’arrêtait auprès de deux tombeaux monumentaux
situés sur la terrasse de la mosquée, puis quelques instants près de quelques
tombeaux à peine reconnaissables dans la plaine à côté de la ville. Parfois les
vieilles femmes avaient des difficultés à identifier l’endroit exact. Quelques
tessons et pierres un peu plus rapprochés marquaient le tombeau d’un saint. En
chantant les femmes et les enfants allaient ainsi de tombeau en tombeau et
priaient Dieu, par l’intermédiaire des saints enterrés dans la ville, de
conjurer le manque de pluie.
5.
La
lecture du Dalâ’il et la visite des tombeaux des saints eurent lieu dans
la troisième semaine du mois de juillet. Vers la fin du mois il plut légèrement
à deux reprises, et une troisième fois la pluie fut plus abondante. Trop peu
cependant pour la période de l’année et pas suffisamment pour les champs.
Malgré tout ce qui avait été fait comme prière, le résultat n’était pas à
hauteur des souhaits. Ce piètre résultat fut imputé, au dire des rumeurs, à la
désunion qui régnait dans la ville.
Mais,
selon un des marabouts, la cause en était imputable au fait que tous les
habitants de Djenné ne se joignaient pas à l’effort pour ‘demander la pluie’.
Il y en avait même qui ne participaient pas à la lecture dans la mosquée.
D’après lui, certains habitants trouveraient intérêt à ce que les pluies
tardent à venir. Ils contestaient la nomination du nouveau chef de village et
ils souhaitaient que son temps soit dur pour lui. Si tous les habitants de
Djenné avaient été unis et avaient vécu ensemble bien en harmonie, un seul
marabout aurait été capable de faire venir la pluie sur la ville.
Un
autre marabout, cynique et aigri sur la conduite de ses concitoyens, disait ne
rien entreprendre pour obtenir de la pluie. Il abandonnait tout à Dieu. Tout le
temps on avait prié à la mosquée pour implorer la venue de la pluie, mais
toujours sans succès. Autrefois, quand les marabouts se rendaient à la mosquée
pour demander la pluie, leurs prières étaient vite exaucées. Ce n’est plus le
cas maintenant : quand on se rend avec cette même intention à la mosquée,
il arrive même que les plus petits nuages disparaissent du ciel. Actuellement,
le maraboutage a cédé la place à l’arrogance. Dans le temps de son père, qui
était un ancien imam célèbre et craint par tout le monde à cause de sa
connaissance du maraboutage, la situation était tout autre.
6.
Début
août, un vieux, cordonnier de profession, invita quelques amis marabouts et
vieux chez lui à la maison pour lire le Coran afin d’implorer la venue de la
pluie. Il fallait approximativement une heure de temps pour que tout le Coran
soit récité. Chaque lecteur était désigné pour en lire une partie et ensuite
ils lisaient simultanément leur partie. Certains ‘hizb’ au début du
Coran furent lus deux fois. A
la fin de cette lecture du Coran un des marabouts présents prononçait une
longue litanie de bénédictions. Le marabout marmonnait en grande vitesse le gara
en demandant Dieu la prospérité pour la ville et ses habitants. A chaque
refrain tous les participants répondaient amin. « Que Dieu nous donne l’eau
bénie du ciel, de l’eau bénie sur les champs. Que Dieu nous donne une bonne
saison de pluie. Qu’Il nous protège; Dieu et son Envoyé honoré. Que Dieu
protège notre ville et s’occupe de ses travaux, de ses études, de son
agriculture, de sa pêche, de son commerce, de sa couture, de son tissage, de
son filage. Que dans tout ce que tout le monde fait ou entreprend, quoi que ce
soit, il n’y ait de tristesse ni pour
lui-même, ni pour un autre. Que Dieu puisse lui accorder tout cela ».
Pour finir ce rassemblement, l’hôte
offrait à l’assistance un repas en commun. Le vieillard qui organisait ces
réunions me disait qu’il lui arrivait de voir certaines choses en rêve. Déjà,
quand il était jeune, ses rêves avaient un sens prémonitoire. Au début de la
grande sécheresse, il y a quelques années, il avait vu dans un rêve que ‘l’eau
ne viendra pas’. Et c’est également ainsi qu’il avait vu que l’année 1987
serait une année difficile. Les pluies ne viendraient pas facilement et le
fleuve monterait difficilement. Mais on ne devait pas désespérer, au contraire
il fallait persévérer dans la prière pour la pluie, donner des aumônes (sara),
comme il le faisait : distribuer des dattes aux lecteurs du Coran et
organiser un repas après la lecture. Une fois il avait même spécialement égorgé
une chèvre pour la circonstance. Dans un rêve il avait vu comment une certaine
partie du Coran était lue ; c’est cette partie qui fut récitée deux fois
pendant les réunions.
Dans la période du début août jusqu’à
début septembre, le Coran fut lu à quatre reprises au domicile de ce vieillard.
Et chaque fois, il pleuvait abondamment le soir ou bien le lendemain. Pour lui
et ses invités, le lien était évident. Les marabouts qui n’avaient pas
participé à la lecture, qui n’y avaient pas été invités, n’en disaient pas
grand chose. Si on veut tenir de pareilles réunions, on doit le faire. S’il
pleut, il pleut pour tout le monde.
Le vieillard me disait
au début du mois de septembre que, vu le résultat positif des quatre séances de
lecture du Coran, beaucoup de monde lui demandait de continuer cette lecture du
Coran à son domicile. Mais il me disait que cela lui coûtait cher. Et qu’il
n’avait pas les moyens d’organiser chaque fois un repas pour tant de monde. Il
n’y avait que peu de gens qui lui donnaient un coup de main. Un jour quelqu’un
lui avait amené un grand panier plein de riz. Une autre fois il avait reçu une
petite somme d’argent. C’était tout. On ne l’aidait pas. Il y avait même des
gens qui parlaient mal de lui. Mais il faisait cela pour tout le monde.
Lui-même il ne pratiquait même pas l’agriculture et il ne profitait donc pas
directement des pluies. Mais tout le monde était content quand il pleuvait. La
dernière fois que le Coran fut récité chez lui, il était même si ému, qu’il ne
pouvait que pleurer, tout le temps. Quand la pluie vint le lendemain, il soupira
Alhamdulillah, "Que Dieu soit loué".
7.
Les pluies de 1987
étaient arrivées tardivement à Djenné. Pas très abondantes, cependant
suffisamment pour des récoltes quelque peu raisonnables. Le début de la saison
des pluies n’augurait cependant pas d’un tel résultat. Le fait que les pluies
tardent à venir faisait peur aux habitants de la ville. Serait-ce une nouvelle
période de sécheresse ? La situation serait-elle aussi grave que celle de
la première moitié des années quatre-vingt ? Seul Dieu connaît la réponse,
m’assurait-on régulièrement. En juillet et août 1987 on implora Dieu à
plusieurs reprises de ‘faire descendre la pluie sur ses fidèles à Djenné’.
Ainsi les marabouts se réunirent pour lire le Dalâ'il al-Khairât,
quelques-uns s’isolèrent pour implorer Dieu par son nom suprême, les femmes
visitèrent les tombeaux des saints et le Coran fut récité.
C’est en 1983 qu’on avait célébré à
Djenné pour la dernière fois un salât al-istisqâ'. Pendant cette période
de grande sécheresse, les habitants se sont réunis à plusieurs reprises sur la
grande place de prière au bord de la ville pour pratiquer cette prière
orthodoxe pour la pluie. Quatre années plus tard le salât al-istisqâ'
n’eut pas lieu. En premier recours, on adopta en 1987 les pratiques qui,
contrairement au salât al-istisqâ’, ne font pas directement partie de
l’Islam orthodoxe ou formel, mais qui peuvent relever de l’Islam local, ou
bien, si on veut, de l’Islam « populaire ».
Références
Bel,
A. 1927. 'Istiskâ''. Dans : Enzyklopaedie des Islam. Leiden : E.J.Brill.
Vol.II. : 601-602.
Diakité,
D. 1999. L’islam à Djenné. Dans : Djenné,d’hier à demain. (dir.) J. Brunet-Jailly. Bamako :
Editions Donniya.
Doutté, E. 1909. Magie et religion
dans l'Afrique du Nord. Alger: Adolphe Jordan.
Fahd,
T. 1978. 'Istiskâ''. Dans : Encyclopaedia of Islam (new edition). Leiden
: E.J.Brill. Vol.IV : 269-270
Graefe,
E. & D.B. Macdonnald 1965.'Djadwal'. Dans : Encyclopaedia of Islam
(new edition). Leiden :
E.J.Brill. Vol.II :370.
Kriss,
R. & H. Kriss-Heinrich 1962. Volksglaube im Bereich des Islam (Band
II: Amulette, Zauberformeln und
Beschwörungen). Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
Levtzion,
N. 1979. 'Patterns of Islamization in West Africa'. Dans : Conversion to
Islam. (ed.) N. Levtzion. New York : Holmes & Meier Publishers.
Marty,
P. 1920. Etudes sur
l'Islam et les Tribus du Soudan. (Tome II) Paris: Ernest Leroux
Es-Sa'di,
Abderrahaman-ben-Abdallah-ben-'Imran-ben-'Amir. 1964. Tarikh es-Soudan. trans. O.Houdas. Reprint Paris :
Adrien-Maisonneuve.
Trimingham, J.S. 1959. Islam
in West Africa. Oxford : University Press.
Winkler,
H.A. 1930. Siegel und Charaktere in der mohammedanischen Zauberei. Berlin:
Walter de Gruyter & Co.