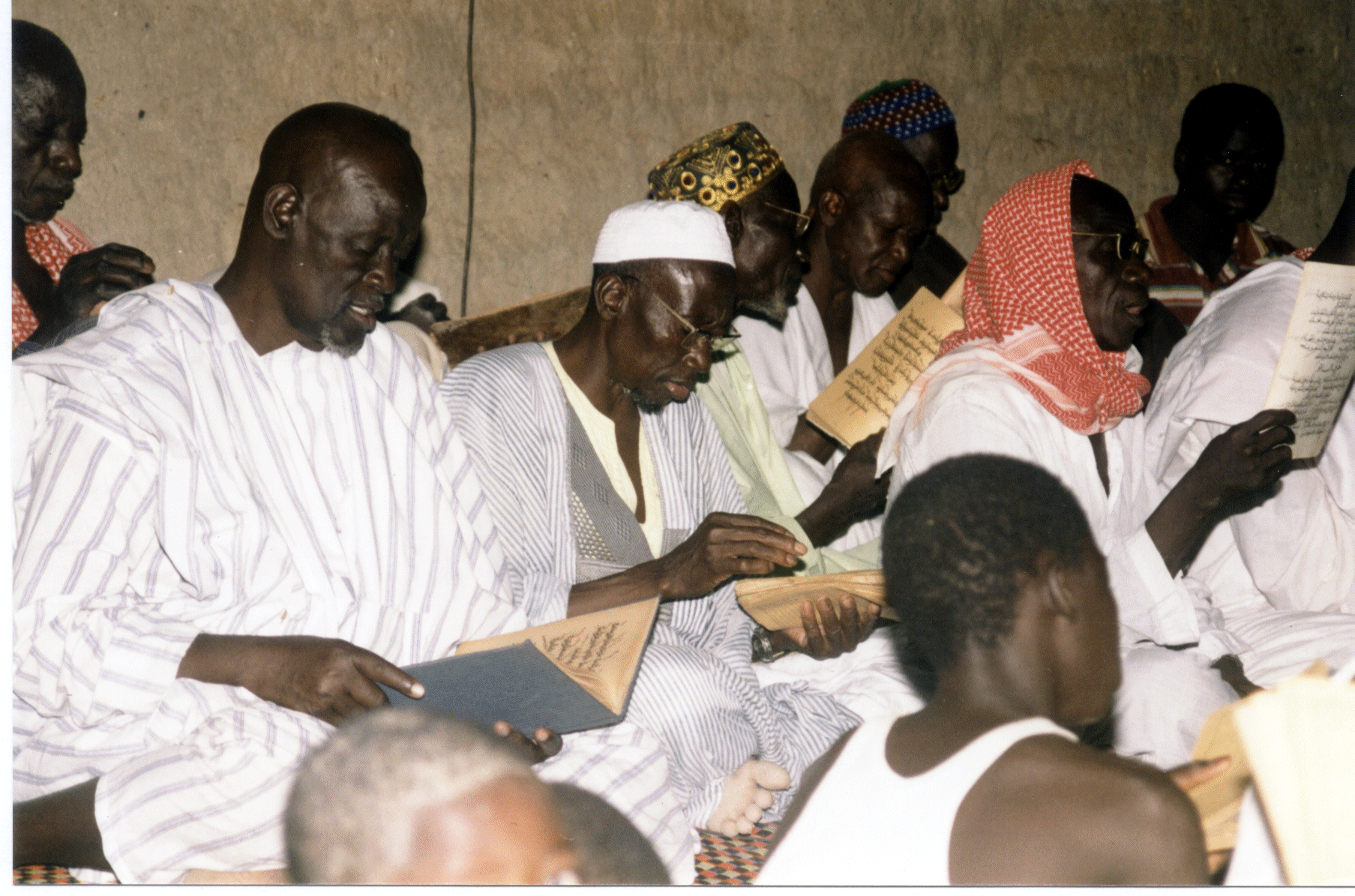
DJENNE PATRIMOINE
BP 07 DJENNE Mali
DJENNE PATRIMOINE Informations
numéro 11, juillet 2001
NOUVELLES DE DJENNE
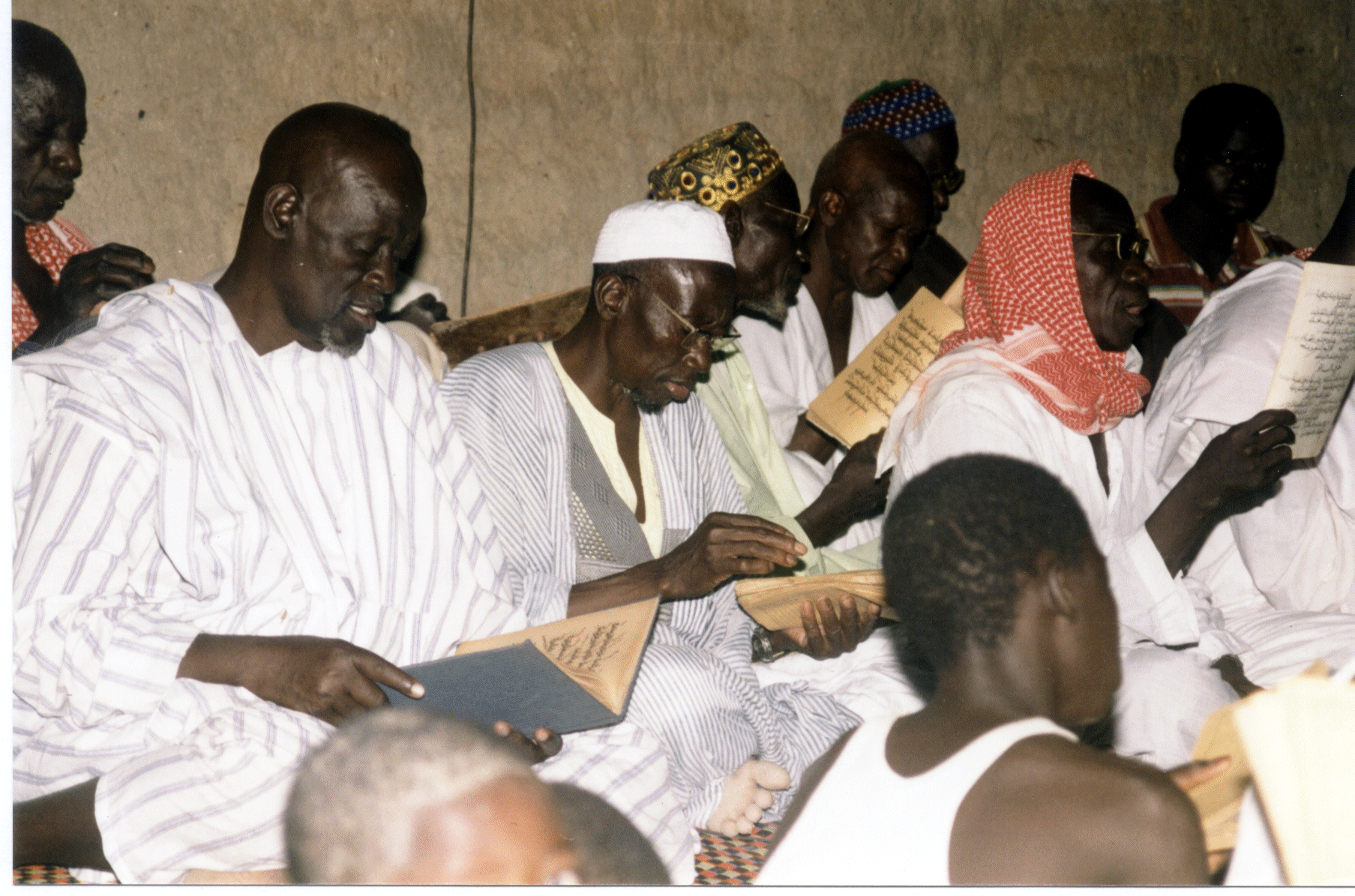 |
Nouveau délégué du gouvernement
Le 22 janvier dernier, Monsieur Sidi Konaté, après huit années à la tête du cercle de Djenné, huit années au cours desquelles il a été successivement commandant de cercle puis délégué du gouvernement, a passé le flambeau à Monsieur Alassane Diallo, qui arrivait du Nord, plus précisément du cercle de Tin-Essako, où il avait servi six ans.
Cette grande opération a eu lieu cette année le jeudi 10 mai et le samedi 19 mai. La première date était connue quelques jours à l’avance (le samedi précédent), la seconde n’a semble-t-il été annoncée à la mosquée que le vendredi 18 mai. Il faut donc être sur place, ou être disponible pour prendre la route dès l’annonce de la date, si l’on veut assister à cette belle fête. Les Djennenké n’ont pas encore décidé qu’ils pourraient partager ce moment d’intense activité festive avec des étrangers qu’ils inviteraient spécialement : ce qui supposerait qu’on les avertisse suffisamment à l’avance pour leur laisser le temps de se préparer. Pourtant, comme le banco de crépi doit pourrir pendant plusieurs semaines, il devrait être possible de fixer dès le lancement de cette opération la date du crépissage lui-même…
Pour cette activité, la ville de Djenné est divisée en deux secteurs. Le secteur 1 comprend les quartiers de Djoboro, Konofia, Yoboucaïna et Kanafa. Le secteur 2 comprend Sankoré, Damougalsoria (ou Soriakatamé), Kouyétendé, Algasba, Bambana, Samseye et Seymani. Cette division a été instaurée, dit-on, pour stimuler la compétition entre les équipes mobilisées par les différents quartiers. Le secteur 1 est responsable du crépissage de la partie Nord de la mosquée, et le secteur 2 est chargé de la moitié Sud. On remarque que chaque secteur va crépir des façades qui sont difficiles à voir (ou invisibles) depuis les quartiers qui le composent : au contraire, le travail de chaque secteur sera bien visible depuis les quartiers du secteur " concurrent ", si l’on ose dire.
Depuis deux ou trois ans, apparemment, la compétition entre les secteurs ne porte plus seulement sur la qualité du travail, elle a été étendue à la rapidité de son exécution. Ainsi, alors que, il y a quelques années, le crépissage durait toute la matinée, et donnait l’occasion aux vieux, qui ne sortent pas très tôt de chez eux, de venir voir, et commenter, et conseiller, jusqu’à midi à peu près, cette année, lors du crépissage de la façade Sud, le travail était commencé aux pinacles avant le lever du jour, juste après la première prière, et vers 8 h 30 tout était terminé.
Dans chaque secteur, chaque année, un quartier " prend le drapeau ", c’est-à-dire se charge de l’essentiel du travail (ou au moins de la direction des opérations). Dans ce quartier, on choisit alors un amir woï (une cheftaine) et un amir har (un chef). En réalité, cette désignation a lieu au cours de réunions spécialement consacrées à la préparation du crépissage, et les chef et cheftaine se proposent à l’approbation de l’assistance. Ensuite, ils devront faire le maximum, avec l’appui de leurs familles. Ainsi, la cheftaine fera beaucoup de plats, et tous ses parents vont l’aider à remplir au mieux ces fonctions qui honorent toute sa famille.
Dans chaque quartier, un comité est constitué pour collecter et gérer les contributions des chefs de famille. Nous avons pu obtenir un ordre de grandeur des collectes réalisées en 2001 dans les quartiers de Djoboro, Sankoré et Samseye, et une estimation très précise des recettes et des dépenses pour l’ensemble des quartiers du secteur 2.
Ainsi, pour le quartier de Djoboro, cinq personnes participent au comité de 15 membres mis en place pour organiser le travail du secteur 1. C’est ce comité qui fixe la date du pourrissement du banco, puis celle du crépissage proprement dit. C’est lui qui rassemble les dons " pour l’amour de Dieu ", les enregistre dans un cahier où les noms des donateurs " pour l’amour de Dieu " (sauf si tel ou tel demande à apparaître anonymement comme " donateur pour l’amour de Dieu " et les sommes sont exactement consignées. C’est ce même comité qui paie les dépenses. Il est possible que les comptes ne soient pas tenus par écrit, ou pas tenus avec une grande précision pour l’ensemble du secteur, mais le quartier de Djoboro sait exactement les charges qui lui incombent :
En somme, la contribution du seul quartier de Djoboro en 2001 se monterait donc à 384.000 FCFA.
Pour l’ensemble du secteur 2, où on devrait compter au moins 500 familles, on dénombre 54 dons en espèces en 2001 ; la somme totale collectée est de 211.400 FCFA, soit une moyenne de 4.000 FCFA par donateur ; la répartition en fonction du montant individuel montre que cette moyenne est fortement affectée par deux dons très importants. A cela s’ajoutent des dons en nature, notamment les plats préparés par les femmes, qui représentent une contribution de l’ordre de 105.000 FCFA supplémentaires.
Ces sommes servent à couvrir des dépenses dont, là encore, les documents du quartier de Sankoré permettent de se faire une idée :
L’ensemble des dépenses donne un total très proche du montant collecté. En pratique cependant, certaines des dépenses énumérées ci-dessus (notamment une partie des achats de banco et de son) ont pu être faites sur des fonds restés disponibles de l’année passée ; et donc la collecte de cette année permettra de constituer une avance pour l’année prochaine
A cela s’ajoutent les plats préparés par les femmes. Pour le seul quartier de Sankoré, qui a contribué pour environ la moitié de la collecte en espèces de son secteur, les plats sont au nombre de 8 : 4 tasses de crème et 4 tasses de gingembre. Aucune valeur n’a été donnée pour ces plats, mais on a pu estimer qu’elle est de l’ordre de 20.000 FCFA. Pour l’ensemble du secteur 2, les plats sont au nombre de 22 et leur valeur totale estimée dépasse 100.000 FCFA : à la crème dègè et au gingembre s’ajoutent des galettes (c’est ainsi qu’on appelle ici les petits beignets), des plats de riz, de gros beignets de farine de blé widjilan, cuits à la vapeur (plat originaire de Tombouctou), des plats de " farine " (il s’agit de beignets en forme de boule, faits de farine de blé, œufs, eau, jetés dans une grande poëlle à frire), de poisson, de sinassar (grandes galettes ou crêpes à base de riz qu’on mange avec du miel ou de la sauce ou du beurre de vache).
Ces plats sont répartis entre les acteurs principaux de la fête, à proportion exacte, en s’en doute, du rôle qu’ils jouent dans l’affaire : les maçons en recevront 5, les " preneurs de drapeaux " 3 (plus la moitié d’un plat de sinassar), les travailleurs du banco 3 et " l’imam, les muezzin et divers notables et marabouts " : 9 (plus la moitié d’un plat de sinassar).
A cela, s’ajoutent enfin les dons en nature : du thé vert, du sucre, des bonbons, du thé Lipton, des dattes, etc. Pour le seul quartier de Sankoré, la collecte a porté sur 4850 g de thé vert, 18 kg de sucre, 62 paquets de bonbons, 2 kg de dattes, 5 litres de lait, 6 paquets de cigarettes : au total, cela représente tout de même environ 30.000 FCFA. Au total par conséquent, à Sankoré, les dons en nature représentent une contribution aussi importante que les dons en espèces.
Pour le seul quartier Samseye, une rapide estimation, que nous devons aux responsables du comité de quartier, fait état de :
donc un total estimé, peut-être un peu largement, à 800.000 FCFA
La distribution des dons en nature n’est pas décrite avec précision, sauf pour les plats. Mais on imagine tout de même sans difficulté que ces dons permettront d’encourager beaucoup de gens à participer activement, pas tant au travail d’ailleurs, parce que beaucoup se font un devoir d’y apporter physiquement leur concours, en fonction de leurs compétences, qu’à la réjouissance elle-même. C’est dans le même esprit qu’on peut comprendre ce qu’il est donné de voir le jour du crépissage : un adulte attirant l’attention par le mouvement qu’il fait pour atteindre le fond des poches de son pantalon, de toute évidence particulièrement spacieuses et profondes, et dont il s’avère bientôt qu’il est spécialement chargé d’en tirer, de temps à autre, des piécettes pour les distribuer aux gamins qui se démènent aux abords du chantier, notamment pour fouler le banco, que les filles viennent arroser périodiquement en colonnes de porteuses d’eau, et à ces gamins sur lesquels on compte aussi pour charger en vitesse les paniers des cohortes de jeunes gens qui, en musique, vont en courant des échelles aux tas de banco et des tas de banco aux échelles pour approvisionner ceux qui, juchés sur la paroi, font la course pour crépir le plus rapidement possible la surface qui leur est assignée.
J. Brunet-Jailly
Pour les fonctionnaires maliens, le 4 juin, date anniversaire de la naissance du Prophète, était un jour de congé, un jour comme il y en a tant dans l’année… Pour les Djennenké, le 4 juin était un jour de marché, un jour de marché comme il y en a beaucoup dans l’année. Cependant, pour ces derniers, ce jour marquait aussi, chacun le savait sans cesser pour autant son travail, le début d’une semaine exceptionnelle pour les croyants. Ainsi donc, à Djenné, si on ne fête pas à proprement parler la naissance du Prophète, l’anniversaire de cette naissance inaugure une semaine très particulière qui se terminera par une grande fête, peut-être la plus grande fête religieuse ici, celle du baptême du Prophète, cette année le lundi 11 juin.
Cette semaine est exceptionnelle parce qu’elle sera marquée, tous les soirs, par des assemblées de croyants, consacrées à la psalmodie de textes sacrés, en deux endroits qui signalent le privilège dont disposent deux familles maraboutiques de Djenné, la famille de Alpha Ibrahim Traoré, dit Byabya, et la famille de Alpha Bamoye Gaba. Ainsi, chaque soir, sur la placette qui se trouve devant la maison de Byabya, on dispose des nattes, des ventilateurs et une sonorisation, éventuellement des bâches, et à partir de 20 h 30 environ, et jusqu’à une heure avancée de la nuit, des marabouts de la famille et des invités vont se relayer et s’épauler pour réciter et chanter les textes choisis pour cette nuit. De même sur la place qui se trouve à côté de l’école coranique de Sidi Ba Yeya, pour ceux qui vont suivre la soirée organisée par la famille Gaba.
Une assistance importante prend place sur les nattes, les hommes beaucoup plus nombreux que les femmes, assises un peu à l’écart naturellement, beaucoup d’hommes venant avec leurs livres pour suivre la lecture et y participer avec plus ou moins d’aisance, plus ou moins d’assurance, malgré leurs mauvais yeux, s’aidant de vieilles lunettes mal adaptées dans certains cas, malgré le trop faible éclairage, s’aidant d’une lampe torche si nécessaire, malgré le manque d’entraînement peut-être, malgré le sommeil contre lequel certains luttent désespérément... Mais on ne peut pas ne pas être frappé par l’ambiance studieuse de cette lecture collective !
Les thèmes des psalmodies et des chants sont, d’après les informations sommaires que nous avons pu recueillir, de deux ordres : d’une part, on utilise un livre d’Ibn Barry, consacré à la description des caractères moraux du Prophète Mohamed, et à ses louanges ; d’autre part d’un livre intitulé Al Bourda, dont l’auteur décrit essentiellement le voyage nocturne du prophète depuis La Mecque jusqu’à Jérusalem, et de là son élévation, sous la conduite de l’archange Gabriel, jusqu’au 7ème ciel. Tels sont les thèmes qui vont nourrir les pensées des croyants durant ces nuits.
Quoi qu’il en soit de ce contenu, une nouvelle fois, l’étranger qui assiste à une soirée de ce genre retiendra de Djenné une image bien différente de celle qu’il avait de l’Afrique telle qu’elle est vue du Nord ; l’image d’une société cultivée, dont la culture islamique est bien là, profonde, ancienne, approfondie par divers exercices en diverses occasions, et aussi rajeunie par la transmission aux nouvelles générations.
Certes, toute la population de Djenné ne participe pas à ces lectures, il s’en faut de beaucoup. Ce sont peut-être deux cent personnes qui se trouvaient sur la place de Konofia, devant chez Byabya le 9 juin, pas plus à Kamansébéra où la soirée avait lieu le 10 juin autour des fils du même marabout, et guère plus de la moitié ce même soir dans le groupe réuni autour de la famille Gaba. Mais, ici comme là, si l’assistance ne compte que quelques vieillards, on y voit beaucoup d’hommes dans la force de l’âge, et à peu près autant de jeunes hommes. Bien sûr, tous ne sont pas de Djenné, et on imagine même qu’une proportion non négligeable de ceux qui sont ici ne sont que des élèves des deux célèbres marabouts. Il n’empêche : il s’agit d’une culture vivante, et qui se transmet.
L’ambiance est studieuse, sérieuse, mais elle n’est pas compassée. Les organisateurs font bien les choses. Un ou deux d’entre eux sont chargés d’accueillir les arrivants, de les guider vers les places disponibles ; mais aussi de lutter contre certaines effluves bien caractéristiques de la saison des pluie en se promenant dans l’assistance pour y balancer, au bout de leurs bras, des encensoirs en terre cuite ; et encore de faire respecter la discipline du lieu par les enfants, qui sont admis à condition de rester tranquilles, ou de s’endormir sur la natte. De même, on règle sans gêne les problèmes qui peuvent naître d’une défaillance de la sonorisation. Puis, lorsque le moment sera venu, on verra sortir de la maison voisine des plateaux chargés de dizaines de ces petits verres qui ne se déplacent d’ordinaire que par paire : on va distribuer à toute l’assistance un bon thé, bien bouilli, bien sucré, bien brûlant, à avaler en faisant beaucoup de bruit pour que la vigueur de l’aspiration en atténue un peu la température.
Et ce n’est pas tout ! Un peu plus tard, c’est autre chose qu’on offrira à l’assistance : les serviteurs apparaîtront portant de grands plateaux sur lesquels ont été édifiées de hautes pyramides de petits paquets gris, des petits paquets en forme de poire, des petits paquets bien serrés dans du papier de sac de ciment, des petits paquets qui contiennent une poignée de farine de pois de terre, mélangée à de la poudre de gingembre et à du sucre ; voilà l’aliment qu’il vous faut, niamakou-mougou, vanté pour l'énergie qu'il va vous donner, propre à vous permettre de poursuivre la lecture des hadiths encore une partie de la nuit.
Et ce n’est pas tout ! Il sera encore possible de rompre la monotonie de la psalmodie, et peut-être de réveiller quelques dormeurs, en autorisant un enfant, à un moment donné, à prendre seul le micro pour guider un instant la récitation ; et tout le monde de rire, de se détendre, avant de reprendre le fil de la lecture studieuse.
Ambiance studieuse et tolérante, puisque que le dimanche 10 juin, alors que les deux groupes étaient réunis, l'un autour des fils de Byabya à Kamansébéra, l’autre autour des fils de Bamoye Gaba à l’entrée du quartier de Kouyentende, la grande place qui s’étend devant la mosquée de Djenné, symbole voulu de l’unité de l’islam dans cette ville, était occupée par la sonorisation installée par des prêcheurs de la secte musulmane An Sar Din (mot-à-mot : soutien à la Dina), qui cherchaient à convaincre une assistance plutôt clairsemée (surtout, semble-t-il, des enfants et quelques promeneurs arrêtés un instant pour voir de quoi il s’agissait), de se tourner résolument vers un islam pur, intransigeant…, ce que ne serait pas celui qui prie à l’entour !
Ambiance studieuse, tolérante, mais aussi festive, puisque, le lundi 11 juin, anniversaire du baptême du Prophète, c’est dès le matin, vers 9 heures, qu’on se réunissait à nouveau dans les lieux de prière, mais alors en tenue d’apparat. La fête, ce jour-là, exige que chacun se montre vêtu de son plus beau boubou, chaussé de ses plus belles babouches, coiffé de son plus beau couvre-chef, sans oublier de se munir de tout ce qui peut contribuer à donner de lui la meilleure image : chapelet, livre saint soigneusement empaqueté dans une reliure de couleur vive, parapluie multicolore pour se protéger du soleil, canne d’apparat… Et comme, à cette heure, tout le monde peut venir, jeunes et vieux, homme et femmes, l’assistance sera beaucoup plus importante que pour les nuits. C’est donc par excellence le jour où l’on devrait faire les portraits de tous les vieux de Djenné, de tous les chefs de famille, de tous les hommes dans la force de l’âge, mais aussi bien des femmes, des jeunes filles et des enfants ! Maintenant que nous le savons, nous y songerons !
Songez-y, vous aussi, puisque, à la différence de la date du crépissage de la mosquée, tenue encore secrète sans véritable raison jusqu’au dernier moment, la date de l’anniversaire du baptême du Prophète est facile à connaître longtemps à l’avance !
Amadou Tahirou Bah et Joseph Brunet-Jailly
L’assainissement, un défi à relever !
Un défi que le bureau communal s’évertue à relever, tant il est constamment interpellé tant par les citoyens que par les visiteurs. Cependant, il n’est un secret pour personne que l’éradication de ce fléau exige des moyens bien supérieurs à ceux dont dispose la commune de Djenné. Mais cette dernière a considéré que ce n’était pas une raison pour baisser les bras : à coeur vaillant, rien d’impossible !
C’est ainsi que le bureau communal a initié une série de contacts permanents avec les différents ministères concernés par la ville de Djenné. Les visiteurs de marque de Djenné ont été sensibilisés en faveur de la cause. Mais, si plusieurs promesses ont été faites, leur mise en œuvre a été bloquée par le manque d’une étude de faisabilité bien élaborée et chiffrée. Entre l’étude de faisabilité et la réalisation des travaux, bien du temps se passera encore et l’eau continuera de couler dans les ruelles de Djenné, et les plastiques de joncher le sol, surtout après le marché tous les lundis.
C’est pour pallier à cet état de fait que le bureau communal, avec l’aide de ses partenaires, a entrepris plusieurs actions, parmi lesquelles nous ne citerons que deux :
Amis de Djenné, honorables visiteurs, nous sollicitons le concours de tout un chacun afin que la cité historique de Djenné retrouve son charme d’hier. En 1956, un journaliste écrivait ceci : " Djenné possède l’ensemble architectural le plus beau et le plus homogène de l’Afrique de l’Ouest ". Voilà le but visé par la commune de Djenné avec l’aide de tous !
Foourou Alpha Cissé,
Premier adjoint au maire de la commune de Djenné
NOUVELLES DU PATRIMOINE DE DJENNE
Réorganisation du Ministère de la Culture
Le Conseil des ministres a adopté le 20 juin 2001 des projets de textes relatifs à la restructuration des services du Ministère de la culture. Ces textes prévoient en particulier la création d’une Direction nationale du Patrimoine culturel, à laquelle en particulier seront rattachées les missions culturelles (de Bandiagara, Djenné, et Tombouctou). On note avec un très grand intérêt, dans la note de présentation de l’ensemble des textes au Conseil des Ministres, que, parmi les mutations qui ont justifié la réforme de l’organisation du Ministère de la culture, figure la suivante :
" la nouvelle orientation de la politique culturelle du Gouvernement visant à assurer à la société civile (association culturelle, groupement d’intérêt économique, GIE, etc.) un rôle de plus en plus prépondérant en matière de promotion de la culture nationale ; et cela dans le cadre de la démocratisation et de la politique de décentralisation ".
Mais, il faut bien constater que cette nouvelle orientation ne se traduit aucunement dans les dispositions des textes en question. Certes, on trouve bien, par exemple, dans le projet de loi relatif à la Mission culturelle de Djenné, que cette institution a les missions suivantes :
" - inventorier les biens culturels mobiliers et immobiliers présents sur le site ;
" - élaborer et mettre en œuvre un plan de conservation, de restauration et de promotion du site ;
" - assurer la participation des structures communautaires et des associations culturelles à la gestion du site ;
" - exploiter et diffuser les sources écrites et orales de l’histoire locale "
Mais rien, dans ces textes, ne donne ni aux associations, ni aux GIE, ni aux collectivités locales le moindre rôle précis dans ces activités : les missions seront de simples services rattachés à une direction nationale, elles seront certainement heureuses de trouver localement des associations ou des mairies pour leur servir de courroie de transmission, mais la société civile et les institutions qui traduisent dans les faits la démocratisation et la décentralisation ne jouent aucun rôle dans la décision.
C’est bien dommage ! C’est une occasion perdue ! Comment ces textes peuvent-ils prétendre être inspirés par la nouvelle politique culturelle du Gouvernement ? Par le souci d’assurer à la société civile un rôle " de plus en plus prépondérant " (les mots n’ont sans doute pas été choisis au hasard) en matière de promotion de la culture nationale ? Par le souci de démocratisation et de décentralisation ?
Faut-il rappeler la position que DJENNE PATRIMOINE a prise il y a un an déjà, dans DJENNE PATRIMOINE Informations n° 9, de juillet 2000, où on lit : " Compte tenu des enseignements des premières années d’activité de la Mission Culturelle, DJENNE PATRIMOINE propose que cette mission, au lieu de rester un organisme temporaire dépendant directement du Ministère de la culture, soit placée, avec tous ses moyens humains et financiers qu’y consacre ce Ministère, sous le contrôle de la Mairie de Djenné. Cette organisation est d’ailleurs celle qui prévaut dans la plupart des villes classées " Patrimoine Mondial ".
Le caractère temporaire de la Mission vient d’être aboli, mais le rattachement aux services centraux du Ministère continue à traduire une conception élitiste, celle selon laquelle la défense du patrimoine ne peut être assurée que par des fonctionnaires des services spécialisés, conception qui s’accompagne naturellement d’une défiance totale de ces agents à l’égard de la décentralisation en général, et à l’égard de la population de Djenné dans le cas qui nous concerne.
Produit de la taxe touristique à Djenné
C’est par une délibération n° 5 du 26 février 2000 que le conseil communal de Djenné, lors de sa session budgétaire 2000 a décidé, conformément aux prérogatives que reconnaissent aux communes les textes sur la décentralisation, de créer une taxe touristique de 1000 FCFA par personne, qui sera payée à l’entrée de la ville –au moins pendant la saison touristique– contre remise d’un ticket imprimé, frappé de l’image de la mosquée de Djenné.
Le budget définitif de la commune urbaine de Djenné, pour l’exercice 2001, montre que cette taxe devrait rapporter plus de 7 millions FCFA à la commune, soit presque 1/5ème de ses recettes totales de fonctionnement. Cette recette n’est donc pas négligeable ; elle équivaut à peu de choses près aux recettes provenant de la location du camion qui a été offert à la ville par Jean-Louis Bourgeois ; elle est très largement supérieure au produit de la taxe payée par les commerçants qui viennent chaque semaine pour le célèbre marché de Djenné. Enfin, sur ce budget, on remarque que près de la moitié des recettes de la commune urbaine de Djenné provient du reversement par l’Etat d’une partie de la " taxe de développement local " qu’il perçoit.
Comme la collecte de cette taxe n’est pas absolument systématique, il faut conclure du montant ci-dessus que largement plus de 7.000 personnes ont visité Djenné pendant l’année. C’est bien plus qu’on ne pensait !
Papa Moussa Cissé,
Président de DJENNE PATRIMOINE,
Vice-Président du Conseil de Cercle
Visite d’une délégation du Projet de développement urbain et de décentralisation (PDUD)
Une mission de ce projet, venant de Gao et de Mopti, conduite par le Secrétaire Général du Ministère de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Zié Ibrahima Coulibaly, est passée à Djenné fin juin, et a été sensibilisée par ses hôtes sur les problèmes essentiels de la ville : la mauvaise évacuation des eaux de pluie, des eaux usées et des ordures ménagères . La municipalité a montré ses premières réalisations, mais elle a aussi fait état de ses ambitions : paver au moins l’artère principale de la ville, protéger les berges, réaliser certains équipements marchands. Les journaux concluent : " Le PDUD admet le bien-fondé de ces demandes ", mais rappelle qu’il n’est pas bailleur de fonds… Bref, encore une mission de bonnes paroles, semble-t-il !
L’avenir de Djenné et le barrage de Talo
Le 8 juin dernier, les députés maliens ont encore une fois entendu le Ministre du Developpement Rural, El Madani Diallo, à propos du barrage de Talo –eh ! pardon ! du " seuil ", comme il voudrait qu’on l’appelle. Il s’agissait pour lui de répondre aux questions des députés Mahamane Santara, élu de Djenné, et Dassé Bréhima Bouaré, élu de Bla, cercle sur le territoire duquel doit être édifié l’ouvrage.
Mahamane Santara fait lecture de la lettre qu’il a adressée au Ministre le 21 avril, lettre où il signale toutes les menaces que représente ce barrage pour la population de Djenné : on va perdre 50.000 ha de terres cultivables pour gagner 7850 ha de terres irriguées ; on va assécher des bourgouttières qui, depuis toujours, étaient les zones de pâture pour le bétail de la région de Mopti, de celle de Ségou, et du Liptako-Gourma (région située aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso).
Vient ensuite l’intervention de Monsieur Dassé Bréhima Bouaré, qui lit sa lettre du 8 mais 2001, par laquelle il exigeait des explications quant au retard qu’accuse le démarrage des travaux. Le ton du député de Bla à l’égard de tous ceux qui s’opposent au barrage est très vif : " la lutte anti-Talo par des fils même de notre pays a atteint un seuil qui jure avec leur appartenance à notre patrie ", et quant aux autres opposants, ce sont des " maniaques, fous " ! Tel est le ton, pour ne pas parler du niveau de l’argumentation. On comprendra mieux plus loin à quoi l’honorable député fait allusion.
Le Ministre du Développement rural répond posément que le " seuil " sera construit quoi qu’il arrive, contre vents et marées. D’abord, il ne coûte que 22 milliards, qui ont été trouvés, alors que le seuil de Djenné coûterait 70 milliards. Ensuite, il assurera une régularisation du cours du fleuve, ce qui profitera à Djenné.
A Djenné on se souvient pourtant parfaitement des propos du prédécesseur, le Ministre Modibo Traore, lorsqu’il était venu à Djenné il y a un an et demi. Pour lui, l’assèchement des plaines de Djenné était si inéluctable qu’il conseillait aux habitants de Djenné d’adopter les cultures sèches, et par exemple de s’intéresser à la culture de l’oseille de Guinée, très demandée, ajoutait-il, au Sénégal !
A Djenné, on se demande aussi quelle est la logique du Ministère : d’un côté on accepte que l’USAID finance des travaux d’un montant de 580 millions FCFA pour sécuriser 42.000 ha dans le Pondo, et de l’autre on s’engage dans un programme beaucoup plus coûteux qui diminuera encore l’irrigation du Pondo.
De son côté, l’Association des ressortissants de Djenné résidant à Bamako a organisé, le samedi 7 juillet, une conférence de presse, à laquelle assistaient une vingtaine de journalistes, et au cours de laquelle a été diffusé un document rédigé par son Président, Bagouro Noumanzana. Ce document reprend en particulier des informations publiées dans le dernier numéro de DJENNE PATRIMOINE Informations, notamment les conclusions des articles de Gil Mahé et de Marcel Kuper, mais il y ajoute d’autres remarques. En effet, l’ONG américaine Cultural Survival a développé un projet sur Talo, dont elle a confié la direction à Jean-Louis Bourgeois, et elle a commandé un rapport d’expertise à l’Université américaine Clark. Une version provisoire de ce rapport a été communiquée aux autorités maliennes et à la BAD courant juin, et le Ministère du Développement rural y a d’ailleurs répondu en détail par écrit.
L’information la plus importante livrée au cours de la conférence de presse des ressortissants de Djenné résidant à Bamako est la suivante : des instructions auraient été " données récemment par les partenaires financiers de la BAD de surseoir à toutes les interventions en faveur du projet ". " La BAD a déjà notifié à la partie malienne la suspension du projet " a déclaré le Président de la Commission technique de l’association.
NOUVELLES DE DJENNE PATRIMOINE
Quatre stagiaires à DJENNE PATRIMOINE
Cette année, dans l’espoir de développer sa contribution à l’étude des problèmes que rencontre Djenné en matière de protection et de promotion de son patrimoine, DJENNE PATRIMOINE a innové, en passant des conventions avec des universités françaises. Ces conventions ont permis à DJENNE PATRIMOINE de recevoir quatre stagiaires, la plupart pour un séjour total au Mali de quatre mois, dont trois à Djenné même.
C’est ainsi que Charline Cardon a travaillé sur le tourisme à Djenné, en s’adressant autant aux hôteliers, aux guides, à la population qu’aux touristes eux-mêmes ; que François Guillet va travailler spécialement avec les hôteliers et restaurateurs pour voir dans quelle mesure il peut les aider à résoudre certains de leurs problèmes d’organisation du travail et de qualité des prestations ; que Marie-Laure Villesuzanne a travaillé sur le rôle de la commune dans la protection du patrimoine architectural de Djenné (elle s’est adressée à la population autant qu’aux administrations); et que Nadège David travaille sur l’impact qu’aurait le barrage de Talo sur les activités de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche autour de Djenné. Charline Cardon et Marie-Laure Villesuzanne viennent de l'Institut Universitaire Professionnalisé " Environnement, technologies et société " de Marseille ; elles étaient supervisées au Mali par le Professeur Balla Diarra (ISFRA, et équipe de recherche IRD sur le développement local). François Guillet vient de l’IUP " Métiers de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs " de Clermont-Ferrand. Nadège David fait un DESS de " Gestion sociale de l’environnement " à Albi (Universités de Toulouse). Elle a travaillé en étroite relation avec un autre stagiaire, géographe, venu quant à lui dans le cadre de l’IRD pour préparer son mémoire de DEA en géographie à l’Université d’Orléans, sous la direction d’Yveline Poncet, chercheur à l’IRD. Nous rendrons compte des travaux de ces étudiants dans nos prochains numéros.
Une perte incalculable pour l’humanité….
Au mois de mars dernier, le Mollah Omar, chef suprême des talibans –un groupuscule d’extrémistes religieux de confession musulmane– s’en est pris au patrimoine culturel et artistique mondial, en ordonnant la destruction des Bouddhas sur le site exceptionnel de Bamiyan, deux célèbres statues sculptées dans le rocher il y a plus de 1500 ans. Ces statues colossales, mesurant respectivement 55 et 33 mètres de haut, étaient les trésors de l’art et de la civilisation bouddhique en Afghanistan.
Par cet acte, les talibans ont anéanti l’héritage de tout un peuple ; mais dans le même temps, c’est un peu de nos racines à nous tous qu’ils ont démolies, car ce site faisait partie du Patrimoine de l’Humanité. Ils ont violé une règle aujourd’hui universelle : " les œuvres du passé sont un patrimoine de l’humanité, qui doit être protégé, avant tout, parce qu’il nous éclaire sur nos origines et fonde nos identités ".
Cette destruction a suscité un élan de réprobation dans le monde entier ; elle a indigné les uns, consterné les autres, et les protestations ont été véhémentes. En ce qui me concerne, je considère cette action comme un acte de pur vandalisme, un odieux événement qui ne manquera pas d’assombrir les horizons culturels du monde. C’est un geste de provocation et de défiance venant d’individus animés par un orgueil démesuré, bien plus que par la piété dont ils se réclament. Ces iconoclastes légitiment leur acte en prenant à témoin une conception de leur foi, laquelle interdirait toute représentation humaine dans les fresques, sculptures et autres œuvres d’art. Devons-nous comprendre par là que toutes les générations de musulmans qui les ont précédés dans cette région, et tous les chefs religieux musulmans qui les ont incités à épargner les deux Bouddhas, n’auraient rien compris à l’Islam et à la loi islamique ? Je n’ose le croire, ni le penser…. Leur motivation est avant tout une réaction de défis à l’égard du monde extérieur : le Mollah et ses acolytes ont juste voulu " cracher " à la face du monde, " gifler " les Etats Unis, et " punir " les occidentaux qui ont infligé des sanctions à leur pays.
Malheureusement, les talibans ne sont pas les seuls à détruire le patrimoine de leur pays. Encore aujourd’hui, des villes et des villages sont constamment vidés de leurs trésors, et ce pillage est exacerbé par le marché illicite de l’art. Et c’est contre toutes ces formes de pillage et de vandalisme qu’il faut que des mesures soient prises et que des actions de sensibilisation et d’éducation soient menées, si l’on veut continuer à protéger nos monuments historiques, ainsi que nos sites.
C’est pour cette raison que je ne peux finir sans lancer un grand message de soutien à nos amis de DJENNE PATRIMOINE, qu’ils soient membres, sympathisants ou bienfaiteurs, qui agissent et combattent pour la protection du patrimoine culturel de Djenné, et qui tous les jours œuvrent (directement ou indirectement) à la protection des sites de cette ville, et s’efforcent d’impliquer la population dans la préservation de son patrimoine. Qu’ils trouvent ici la reconnaissance et l’encouragement de tous ceux pour qui le patrimoine culturel représente quelque chose de grand, et de tous ceux qui de par le monde sont attachés à Djenné…. C’est grâce à leur action et leur vigilance que Djenné ne s’éveillera pas un jour pour apprendre la nouvelle de la destruction du tombeau de " Tapama Djenepo " ou de tel ou tel autre œuvre exceptionnelle de son passé pré-islamique.
Boubou Cissé, Aix en Provence
Juin 2001
Cher Monsieur,
Mon fils Pierre [NDLR : Pierre Ducoloner, co-auteur du livre " Djenné, d’hier à demain] m’a fait part de votre courrier désirant prendre contact avec André Ducoloner. Vous allez être surpris d’apprendre qu’André Ducoloner est une Andrée, très vieille arrière grand-mère, et mère de Pierre !
J’ai beaucoup apprécié le beau livre sur Djenné. J’ai admiré l’amour de la famille, le respect et l’amour que vous avez également pour les traditions ancestrales, ainsi que les qualités d’artiste dans la fabrication artisanale de bijoux, de vannerie, de tissus aux couleurs et aux dessins remarquables, les travaux de broderie et le travail du cuir, etc.
J’ai toujours voyagé par imagination, en me basant sur les ouvrages de Jules Vernes et autres, la vie extraordinaire de René Caillié à Tombouctou. Les lectures des ouvrages du 19ème siècle sur la découverte des territoires inconnues d’Afrique et d’ailleurs m’ont toujours passionnée. Et cet ouvrage me confirme l’idée que j’avais de toutes ces découvertes que vous gardez précieusement sans gâcher ces ouvrages dans un but purement lucratif.
Vous habitez vraiment un beau pays que mon grand âge ne me permettra pas de connaître, hélas.
Veuillez croire, Cher Monsieur, à toute ma sympathie.
Andrée Ducoloner
Septembre 2000
[cette lettre nous a été pieusement confiée par Pierre Ducoloner, début 2001, après le décès de sa mère Andrée Ducoloner, quelques semaines après qu’elle eût rédigé la lettre qu’on vient de lire]
FETER A DJENNE… LE NOUVEL AN 2002 !
Après la première édition, il y a deux ans, Fêter à Djenné l’aube du 3ème millénaire, qui a été un grand succès, DJENNE PATRIMOINE va organiser pour ses adhérents Fêter à Djenné… le nouvel an 2002 ! En voici le programme :
Vendredi 22 décembre : arrivée à Bamako
Samedi 23 décembre : accueil et hébergement à Djenné ;
Dimanche 24 décembre : repos ; visites de courtoisie aux autorités ; lancement des festivités ; danses populaires ;
Lundi 25 décembre : ouverture de l’exposition d’artisanat d’art de Djenné et de l’exposition de photographies ; visite du célèbre marché hebdomadaire de Djenné ;
Mardi 26 décembre : visite commentée des sites et musées ; conférence sur la société de Djenné ; projection de documents vidéographiques ;
ercredi 27 décembre : visite de la salle d’exposition du projet de rehabilitation de l’architecture traditionnelle de Djenné ; conférence sur l’architecture et la construction en terre ; dîner en musique (cuisine de Djenné) ;
Jeudi 28 décembre : visite des ports, des portes et des chantiers navals ; visite de Roundé Sirou, où a séjourné Sékou Amadou, fondateur de l’Empire peul du Macina ; en soirée, danses populaires ;
Vendredi 29 décembre : causerie-débat avec le chef de village et les notables au palais du chef ; présence à la sortie de la mosquée, à la fin de la grande prière du vendredi ; soirée culturelle ;
Samedi 30 décembre : visite du village peul de Senossa ; parade de pirogues ; soirée culturelle ;
Dimanche 31 décembre : visite du village Bambara de Keke ; soirée culturelle (vidéo : crépissage de la mosquée) ; réveillon du 1er janvier 2002 : dîner en commun mixte
Lundi 1er janvier 2002 : visite du marché hebdomadaire, emplettes, photos, repos ;
Mardi 2 janvier : excursion (partie en car, partie en pirogue) au village bozo de Kolenze sur le Niger ; au retour, soirée d’adieu, repas en commun, musique locale , évaluation des activités
Mercredi 3 janvier : départ pour Bamako
Un bulletin d’inscription est joint. Utilisez-le pour réserver vos places.
DJENNE PATRIMOINE au Forum des Associations et GIE culturels
DJENNE PATRIMOINE a été représentée par son Président, Papa Ousmane Cisse au Forum des Associations et GIE culturels qui s’est tenu à Bamako, à l’Initiative du Ministère de la Culture et grâce à un financement de l’Union Européenne, du 3 au 5 juillet 2001. Ce Forum a été l’occasion pour le Ministère de présenter le recensement auquel il a procédé de près de 300 associations et GIE culturels. Fort bien, mais plusieurs entreprises purement commerciales, dans le secteur culturel, apparaissent au milieu des associations et GIE, comme s’il s’agissait de structures comparables . Quel avantage y a-t-il à entretenir la confusion ?
De même, ce Forum a été l’occasion pour le Ministère d’exposer sa doctrine, notamment en matière de décentralisation et de participation des acteurs de la société civile (les associations et les GIE culturels). Dans la communication du Docteur Amidou Maïga, Chef de Cabinet du Ministre, on relève par exemple l’idée que " un accent particulier est mis sur la responsabilisation des collectivités territoriales " et que " dans ce cadre, la décentralisation des établissements culturels (musées, centres de documentation, bibliothèque, etc..) a une place prépondérante ". De même, on lit que " les structures associatives sont activées, constamment sollicitées et largement responsabilisées ". Allant plus loin, le Directeur National des Arts et de la Culture, Tereba Togola, parle, dans sa communication à ce même Forum, des " droits d’une collectivité sur sa propre culture " et de la " nécessité de la consulter sur toute action visant à conserver et promouvoir cette culture ". Comme on ne veut pas porter l’accusation de double langage, on conclut que les propos émanent d’un autre ministère de la culture que celui qui prépare les textes de la réforme de la Direction Nationale des Arts et de la Culture ou les nouveaux statuts du Musée National (voir ci-dessus).
Enfin, ce Forum a permis de présenter le Programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées (PSIC) qui a notamment pour objectifs de " favoriser l’émergence, à côté de l’Etat, de promoteurs culturels non étatiques capables d’organiser, de gérer, d’animer le secteur culturel de façon durable " et de " renforcer les capacités d’initiative et d’action des opérateurs culturels indépendants et des collectivités locales ". Le coordinateur du PSIC est l’anthropologue Salia Malé.
Papa Ousmane Cissé,
Président de DJENNE PATRIMOINE
DOCUMENT 1
L’intérêt de la recherche archéologique sur l’ancienne Djenné
[Note de la rédaction : nous avons le privilège de publier ici, avec l’accord de Madame Susan McIntosh, la transcription de l’interview qu’elle a donnée le jeudi 7 janvier 1999 à Radio-Jamana, alors qu’elle séjournait à Djenné même à l’occasion de la première campagne de fouilles archéologiques dans la ville actuelle, plus précisément sur le site de l’ancien dispensaire, où devrait être construit le musée de Djenné. Pour être déjà ancien, ce document n’en conserve pas moins son intérêt exceptionnel, comme nos lecteurs s’en rendront bientôt compte. DJENNE PATRIMOINE remercie chaleureusement Madame Susan McIntosh de son autorisation. L’interview est conduite par Mamary Sidibe, à l’époque volontaire malien auprès de la Mission culturelle, aujourd’hui en poste au Macina, et que nous remercions également]
MS : Bonsoir Madame ! Vous êtes archéologue et professeur d’Université. Depuis 1977, vous et votre mari avez entrepris des recherches ici à Djenné, et notamment à Djenné-Djèno. Les résultats de ces recherches ont beaucoup contribué au classement de Djenné-Djèno et de Djenné, dix ans après, en 1988, sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Dix ans après ce classement, et vingt ans après le début de vos travaux, que signifient pour vous, Madame, ces événements ?
Susan McIntosh : Pour moi, tout cela montre l’importance de l’histoire de l’Afrique de l’Ouest pour la compréhension de l’histoire de toute l’humanité. L’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO signifie que quelque chose s’est passé ici, à Djenné, dont tout le monde, l’humanité entière doit avoir connaissance pour comprendre le trajet historique que l’humanité a suivi. Ceci est d’une importance capitale d’abord pour les Maliens : ils ont contribué, dans le passé, à une étape décisive de l’évolution de l’humanité, l’apparition de la civilisation urbaine au Sud du Sahara. Ceci est d’une importance capitale aussi pour les autres peuples : chacun d’eux a suivi un trajet historique différent, et chacune de ces expériences est également valable. Qu’est-ce qu’un trajet historique différent ? Et bien par exemple, au début de l’archéologie, on a commencé par des fouilles dans les grands centres du Moyen-Orient et dans les grandes villes de l’Europe, et qu'on a découvert un certain type de trajet, qu’on a supposé devoir être le trajet que devraient suivre toutes les sociétés. C’est seulement lorsqu’on a conduit des fouilles ailleurs, en Afrique de l’Ouest, en Amérique du Sud, on a découvert par exemple que l’évolution de l’agriculture, les plantes cultivées, etc. étaient très différentes ici et là, et que cela conduisait à des développements différents de la société dans son ensemble. Maintenant, par exemple, on comprend qu’il n’est pas obligatoire, pour parvenir à l’urbanisation, d’avoir une agriculture irriguée par des aménagements hydrauliques, comme c’était le cas au Moyen-Orient par exemple. Et c’est Djenné qui l’a montré, puisque là l’urbanisation s’est faite sans que l’irrigation soit contrôlée : l’agriculture y utilise l’irrigation naturelle par le système du fleuve Niger pour les cultures de décrue. Voilà comment l’expérience de Djenné-Djéno peut ajouter beaucoup à notre compréhension globale de l’histoire de l’humanité. Par ailleurs, le classement a attiré beaucoup de touristes à Djenné, ce qui est une bonne chose, par certains aspects, mais ce qui ne va pas sans poser des problèmes. Donc ce que j’espère pour Djenné, c’est un développement intelligent et sain du tourisme : il faut par exemple que leur nombre soit compatible avec les infrastructures d’accueil, y compris l’évacuation des ordures et des eaux usées, sinon la présence des touristes détériore les conditions de vie des habitants de Djenné. Mon mari et moi avons essayé de contribuer, à la mesure des moyens que nous avons, au développement d’un tourisme intelligent à Djenné.
MS. : Quel est l’impact de vos recherches sur les connaissances scientifiques ?
Susan McIntosh : L’impact a été de transformer notre compréhension de la préhistoire et de l’histoire de l’Afrique de l’Ouest. Il y a vingt ans, on croyait que le développement des villes et du commerce à longue distance était lié à l’arrivée des commerçants arabes, qui ont organisé le commerce transsaharien à partir du VIIIème siècle de notre ère. A Djenné-Djeno, nous savions par les traditions orales que la ville avait été fondée plusieurs siècles avant la conversion de Koy Konboro à l’islam, au XIIème siècle. Donc, on se disait : cette ville a peut-être été fondée au VIème siècle, au VIIème… On a été très étonné quand les datations au radio-carbone pour les matériaux trouvés au fond des dépôts ont donné des dates de presque 300 ans avant notre ère. Ensuite, plus on a travaillé sur le site, plus on a dû admettre qu’il avait grandi très vite après sa fondation : il avait presque atteint son étendue maximum dès le IVème ou Vème siècle de notre ère. C’était donc, pour tous les historiens de l’Afrique de l’Ouest, et même de l’Afrique toute entière, une véritable découverte que l’existence d’une ville aussi ancienne et aussi importante dans la ceinture sub-saharienne. Donc les préoccupations des historiens sont devenues toutes autres : ils se sont désormais demandé quelles étaient les origines autochtones de tous ces événements (urbanisation, commerce à longue distance, développement de la civilisation) ? Il ne s’agissait plus de rechercher une influence extérieure, mais de rechercher localement, en Afrique de l’Ouest, l’origine de tous ces événements. Pour tous les historiens de l’Afrique de l’Ouest, c’était un grand moment, dû à ce qu’on a pu sortir de Djenne-Djèno.
MS. : Vous êtes une référence dans l’identification des poteries du Delta central du Niger et en particulier de la région de Djenné-Djèno. Pouvez-vous nous expliquer comment vous arrivez à faire la différence entre les poteries des différentes époques, et comment expliquez vous ces différences ?
Susan McIntosh : C’est vrai que la céramique est une passion pour moi. Les changements dans le style des céramiques se font selon les mêmes processus que nous connaissons tous dans nos vies quotidiennes. Par exemple, les automobiles qui ont été importées dans le Delta intérieur au cours des années 20, des années 30, des années 40, etc. n’avaient pas le même style, et les automobiles d’aujourd’hui ont encore un style différent ; par exemple, les land-cruiser qu’on voit aujourd’hui n’existaient pas comme style il y a trente ans. C’est dans la nature de l’être humain de changer le style des objets qu’il fabrique (les artefacts), mais je ne sais pas si on peut expliquer pourquoi. Mais les archéologues se servent beaucoup de ces évolutions de style pour leurs reconstructions du passé : si les objets fabriqués par les êtres humains restaient inchangés, on ne pourrait pas reconstruire le passé. Donc lorsqu’on fouille, on prend le plus grand soin à identifier les événements qui ont créé le site : par exemple à voir que, ici, on a creusé un petit trou, on l’a utilisé comme poubelle, donc on sépare le contenu de la poubelle de la terre dans laquelle elle a été creusée (parce que ce qui est dans la poubelle est plus récent que ce qui est autour) ; on peut alors comparer les tessons qui sont dans la poubelle et ceux qui sont autour, plus anciens ; et ensuite, on sait que les niveaux archéologiques qui sont plus profond que la poubelle sont aussi plus anciens qu’elle, et plus anciens que ce qui était autour d’elle ; après quelques mois de fouille, j’ai beaucoup de niveaux archéologiques qui se succèdent dans le temps, dans un ordre que j’ai reconstitué ; et chacun d’eux est représenté par un ensemble de céramiques légèrement différentes. Alors, j’utilise un ordinateur, qui, à partir de toutes les caractéristiques enregistrées sur tous les tessons, me donne des tendances d’évolution : par exemple, jusqu’à tel moment, les céramiques étaient en général peintes, ensuite elles étaient décorées d’impressions faites avec des peignes, des cordelettes, et ainsi de suite. Et voilà une application : entre les années 500 et les années 900, il y avait un style de céramique peinte, très spécial, et on trouve des tessons de ce style partout sur le site de Djenné-Djèno ; le style qui a succédé ne se trouve qu’au centre du site (après les années 1000 ou 1100, le périmètre de Djenné-Djèno est beaucoup plus réduit que les 33 ha qu’il avait entre les années 500 et les années 900) ; c’est comme cela qu’on a compris que le déclin de Djenne-Djèno avait commencé dans les années 900 à 1000 de notre ère.
MS. : Et dans quel sens évolue cette céramique ? Vers un affinement, ou le contraire ?
Susan McIntosh : C’est un peu difficile à dire, parce que c’est aborder une question d’esthétique, dans laquelle interviennent plusieurs éléments. Mais disons que tout au début, les occupants, les habitants et les potières de Djenné-Djéno ont fabriqué une céramique très belle, vraiment très belle, très soigneusement fabriquée, avec des parois très minces, très bien décorées, avec beaucoup de soins : une céramique de très haute qualité du point de vue esthétique. Est-ce que la céramique peinte de la période qui a suivi était moins esthétique ? La pâte est plus grossière, mais la peinture est plus esthétique, très bien faite ; si la pâte est plus grossière, cela ne veut pas dire que les potières y ont mis moins de soins, mais qu’elles visent d’autres qualités. Une vaisselle qui doit aller au feu et qui ne doit pas se casser lorsqu’elle est chauffée, et une vaisselle qui doit être imperméable parce qu’on s’en servira pour stocker de l’eau, sont évidemment fabriquées en fonction d’objectifs différents, et en adoptant donc des solutions différentes. Les potières adaptent la solution aux différents besoins, et parfois la pâte sera plus grossière, parfois plus fine. Cela dit, la production de céramiques de Djenné-Djèno est extrêmement variée, certaines ayant une grande qualité esthétique et d’autres non ; mais cela ne doit pas nous étonner, c’est exactement pareil actuellement encore ; mais les potières d’aujourd’hui reconnaissent que leurs grands-mères fabriquaient des céramiques plus soignées que celles qu’elles font aujourd’hui ; et elles savent parfaitement pourquoi : aujourd’hui le marché demande une production de masse, pour beaucoup de monde, y compris les touristes, et donc il faut produire les pièces beaucoup plus rapidement qu’on ne le faisait autrefois. Dans le passé, on prenait plus de temps, on donnait plus de soin. Les potières se sont donc adaptées aux exigences de la demande, comme le faisaient déjà leurs arrière grands-parents et arrière- arrière-grands parents. Mais si la demande présente une exigence de qualité, comme pour les productions de luxe, on obtient la haute qualité voulue en y consacrant le temps et les soins voulus.
MS. : Madame le Professeur, en plus de vos passions pour les sondages archéologiques et pour les céramiques, vous faites partie du Conseil sur le patrimoine culturel qu’a constitué le Président Bill Clinton. Pouvez-vous nous parler de l’expérience américaine sur la gestion du patrimoine culturel ?
Susan McIntosh : Oui, mais dans le cadre du comité dont j’ai l’honneur d’être membre, et qui a été créé en 1983 pour mettre en œuvre la convention UNESCO que les Etats-Unis avaient signée dans les années 1960. Le patrimoine culturel a été compté au nombre des droits universels de l’homme par la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies en 1988. Ce droit signifie que chaque personne a le droit de participer à une culture, y compris une culture passée. Dès les années 1960 l’UNESCO était choquée par l’importance des pillages qui étaient en train de détruire le passé de beaucoup de pays, et avait essayé par la convention de 1970 d’intéresser les pays membres des Nations-Unies à un effort contre le pillage, pour sauvegarder le passé qui fait partie du patrimoine culturel, et qui garantit le droit qu’a chaque personne de participer à une culture. C’est de cette question globale que notre comité s’occupe. Avec la législation en vigueur aux Etats-Unis, le Président est autorisé à constituer un conseil qui fera des recommandations concernant les demandes reçues par les Etats-Unis des autres pays signataires de la convention UNESCO de 1970 : les pays qui considèrent que leur passé est menacé par le pillage et qui craignent que les objets ne soient vendus aux Etats-Unis, peuvent demander aux Etats-Unis une certaine protection, que les Etats-Unis peuvent leur accorder sur recommandation de notre comité. Ces protections sont par exemple l’autorisation donnée à la douane américaine de saisir les objets protégés pour les empêcher d’entrer aux Etats-Unis. Ces protections prennent souvent la forme d’accords bilatéraux, dont l’un existe entre le Mali et les Etats-Unis. C’est très important, parce que, comme vous le savez, les Etats-Unis sont un pays qui achète beaucoup d’antiquités africaines, et provenant d’autres pays aussi. Le Mali a été le premier de l’Afrique à demander aux Etats-Unis ce type de protection. Notre comité a estimé que les conditions du pillage sont réunies dans ce pays, que la situation est sérieuse et menace l’intégrité de la culture passée du Mali, que l’interdiction d’importer aux Etats-Unis pourrait améliorer la situation, que les autres pays acheteurs pourraient aussi participer à cet effort (notre législation ne permet pas que les Etats-Unis agissent seuls, mais justement la France a enfin signé tout récemment la convention UNESCO et cela devrait lui permettre de participer à la lutte contre le pillage), et que le Mali lui-même faisait son maximum pour lutter contre le pillage (c’est aussi une exigence de la législation américaine). Cet accord a été signé par le président Konaré en 1997 doit être renouvelé au bout de 5 ans, et c’est notre comité qui va évaluer les efforts du Mali dans la sauvegarde de son patrimoine culturel. La création des Missions culturelles, comme celle de Djenné, a énormément impressionné le comité et a beaucoup aidé aux progrès réalisés par le Mali dans cette lutte. Il reste beaucoup à faire, mais si on va à Djenné-Djéno, on voit que la législation qui protège le site est annoncée, par un panneau splendide qui explique un peu les couches archéologiques du site, etc., et on connaît tout le processus de sensibilisation de la population à l’importance du passé, à l’importance qu’il y a à sauvegarder les papiers anciens, et le rôle des associations telles que les Amis de Djenné et DJENNE PATRIMOINE. On voit que la population commence à réagir pour la préservation de son propre passé, de sa propre culture. C’est ça qui va assurer, j’en suis sûre, le renouvellement de notre accord bilatéral.
MS. : Madame le Professeur, revenons maintenant à Djenné et aux fouilles archéologiques qui sont en cours dans la ville. Qu’en attendez-vous et qu’ont-elles, à la date de ce jour, révélé ?
Susan McIntosh : On a beaucoup d’espoir pour ces fouilles, c’est une opportunité très spéciale, parce que nous avons été invités par nos collègues maliens à entreprendre une fouille en prévision de la construction à cet endroit d’un nouveau musée à Djenné. La construction va inévitablement détruire une certaine quantité de dépôts archéologiques. On fouille pour sauver les informations que peuvent contenir ces dépôts avant que la construction ne commence. Notre espoir, c’est de découvrir ici les types de céramiques qui existaient à Djenné après la fin de l’occupation de Djenné-Djèno, vers 1400 de notre ère : sur ces 600 ans de culture matérielle, nous n’avons pas beaucoup d’informations jusqu’à présent. Mais il y a aussi des questions relatives au déclin de Djenné-Djèno et à la croissance de Djenné : est-ce que les deux ont coexisté pendant une certaine période et est-ce que le déclin de Djenné-Djèno a été lié à la croissance de Djenné, ou bien y a-t-il eu une rupture après la fin de Djenné-Djèno ? Et quelles peuvent avoir été les raisons du déclin de Djenné-Djèno : instabilité politique au XVème siècle, dégradation climatique, troubles religieux liés à l’arrivée de l’Islam ? Jusqu’à présent on ne sait pas. Les fouilles peuvent au moins nous montrer s’il y a eu une rupture. Nous espérons aboutir dans les jours qui viennent aux couches des XVème et XIVème siècles, qui sont ceux de la transition. Jusqu’à présent, nous avons trouvé, tout en haut, de jolies couches de sacs en plastique bleu, qui sont sans doute venues après 1975, parce que je n’en avais pas vu lors de mon premier voyage à Djenné. On a trouvé ensuite les traces du dispensaire, puis de l’époque toucouleur, et ensuite de celle de Sékou Amadou, puis des niveaux avec beaucoup de pipes à tabac. Or on sait que le tabac a été introduit par les Marocains, qui sont arrivés en 1591, et donc on suppose que ce niveau remonte au XVIème ou XVIIème ou éventuellement XVIIIème siècle. Les trois derniers siècles représentaient deux mètres de dépôts archéologiques ; maintenant, nous sommes descendus à 3,5 mètres environ et nous commençons à trouver des céramiques qui ressemblent beaucoup à celles desquelles je suis familière, celles qu’on trouvait à Djenné-Djeno dans les dépôts du XIVème et XVème siècles. Nous sommes donc sur le point de répondre à la question de savoir s’il y avait une rupture ou une coexistence entre les deux villes. Les Djennenké se souviennent qu’il y a quatre ans, nous sommes venus avec des équipements de carottage, qui nous ont permis de faire des carottes et de mesurer la profondeur des dépôts archéologiques sous le sol actuel de Djenné : or, nous avons appris que, dans le secteur où nous fouillons actuellement, les dépôts ont 7 m de profondeur. Comme à 3,5 m nous commençons à trouver des céramiques qui ressemblent beaucoup à celles de Djenné-Djèno, il paraît très probable que Djenné et Djenné-Djèno ont coexisté pendant plusieurs siècles avant l’abandon final de Djenné-Djeno.
MS. : Quel peut être l’impact des fouilles sur Djenné ?
Susan McIntosh : Pendant notre travail, nous constatons l’intérêt énorme que les fouilles suscitent non seulement dans la population locale, mais aussi chez les touristes qui viennent, attirés par l’inconnu. Parmi les questions qu’on nous pose, la première est : est-ce que les objets que vous retirez seront exposés dans le futur musée ? Nous espérons que le matériel archéologique peut contribuer à l’attraction de Djenné. Mais améliorer notre connaissance du passé de la région est également très important : la popularité de Djenné-Djéno auprès des touristes montre qu’il y a une véritable faim de connaissances concernant le passé de l’Afrique ; en développant ces connaissances, on augmente l’intérêt pour l’Afrique, et par voie de conséquence l’intérêt des institutions capables de financer par exemple la construction du musée, ou le développement du tourisme. Par exemple, le World Monument Fund a financé les fouilles à Djenné-Djèno il y a deux ans et les travaux de protection du site contre l’érosion. Plus on travaille, plus on trouve des choses passionnantes, plus le monde extérieur s’intéresse à Djenné, et se montre prêt à contribuer au processus. Il y a donc des avantages tout-à-fait locaux, comme par exemple la construction du musée, mais il y a des impacts à une échelle bien plus grande, par exemple au niveau du Patrimoine Mondial et de la disponibilité des organismes extérieurs à aider le Mali à découvrir son propre passé.
MS. : Madame le Professeur, pour terminer, est-ce que vous avez un message à l’adresse des milliers d’auditeurs qui nous écoutent à Djenné ?
Susan McIntosh : Oui, et c’est un message qui vient de mon cœur : la conservation du patrimoine culturel de Djenné, la protection des sites archéologiques autour de Djenné sont une ressource pour l’avenir de Djenné. Djenné n’a pas beaucoup de ressources naturelles, mais l’archéologie est une ressource qui peut être exploitée ; mais cette ressource culturelle, unique au monde, et qui peut être la base d’une activité économique, ne doit pas être gaspillée. Or, Djenné-Djèno nous a appris que l’érosion due au ravinement des eaux commence dans les trous des pilleurs, et de ces trous sont sorties au bout de quelques années d’énormes ravines qui menacent l’intégrité du site. Depuis 1980, date de notre dernière grande campagne de fouille là-bas, on a perdu plus de 10 % du site à cause de cette érosion. Et ça avance de plus en plus vite : si on ne fait rien, on perdra peut-être la moitié du site dans les vingt années prochaines. Il faut donc comprendre qu’en détruisant son passé, Djenné détruit son avenir. Protéger le passé, c’est non seulement conserver, pour la fierté et l’identité des enfants de Djenné, les traces d’un passé brillant et glorieux, mais c’est aussi un de nos grands espoirs pour l’avenir de Djenné !
DOCUMENT 2
Les Saman, ou l’histoire d’un groupe de Djennenke du pays dogon(1)
par
Gilles HOLDER
Au Mali, on associe généralement les Saman(2) au nom Kansaye, un clan qui, au XIXe siècle, joua un rôle politique tout à fait important au pays dogon, autour de la cité de Kani-Gogouna, qui se trouve à trente-deux kilomètres au nord-est de Bandiagara. Quoi que moins connus, il existe pourtant d’autres groupes saman, que l’on situe souvent hors du pays dogon. Hormis les Fofana, qui constituent un groupe maraboutique à part, on trouve en effet les clans Kamia (ou Kamian), Soulo (ou Sylla), Napo (ou Napio), Kampo et Tarawouré (ou Traoré), que le géographe Jean Gallais définit comme des Marka nononke(3) venus du Delta intérieur du Niger, il y a plusieurs siècles(4).
Fulbe et Fuutankoobe de la région de Bandiagara parlent quant à eux de Jennenkoobe hayre, c’est-à-dire dire de " Djennéens de la montagne ", désignant ici les Saman liés à Kani-Gogouna, mais aussi certains groupes qui vivent à l’ouest et au nord-ouest du plateau dogon(5). Confirmant cette désignation, l’administrateur colonial Charles Monteil rapportait, dans sa monographie sur Djenné publiée en 1903, que " des dissensions, survenues au moment de la guerre avec les Songhay, déterminèrent une émigration des Djénnéens vers le Tomboro [c’est-à-dire le pays dogon]. A Djénné, précisait l’auteur, on connaît ces émigrants sous le nom de "Djénnéens de la montagne" "(6)
*
* *
Si les Saman apparaissent donc bien comme des Djennéens installés au pays dogon, les Kansaye font toutefois remonter leur origine au-delà de Djenné, en se définissant en tant que Kanyaga-si, ou ceux de la " race du Kanyaga ". Chez les Bamana, le terme kanyaga désigne le Nord, mais il renvoie initialement à cette partie du pays soninke que l’on associe au célèbre royaume du Wagadou, où le géographe arabe Al-Bakrî situait, en 1068, les " Farawiyyîn ", un nom qui, selon Claude. Meillassoux, pourrait être rapproché de celui de Tarawouré.
Autrement dit, les Kansaye seraient liés à ces Marka nononke d’origine sahélienne, dont les traditions indiquent qu’ils s’imposèrent dans la région de Djenné à partir du IXe siècle. A cet égard, Monteil mentionnait l’existence d’une liste de soixante-quatorze chefs de Djenné, tirée d’une chronique locale désormais disparue, dans laquelle figurait un certain " Vi Samana Mana ", septième chef de la ville qui aurait régné peu avant 1200(7). L’auteur estimait que " Vi " était une contraction de Were, titre donné au chef de la cité avant la conquête songhay, tandis que le linguiste Maurice Delafosse précisait que " maa-na " était un titre porté jadis par les rois du Kanyaga et du Tekhur (duquel est issu le terme français " Toucouleur "), que l’on donne encore par politesse aux familles ayant fourni des dynasties de rois(8).
Malgré l’existence de ce chef de Djenné qui se serait appelé " Samana " et une certaine concordance avec les traditions orales des Saman, on ignore quel rôle jouèrent exactement ces derniers vis-à-vis de la ville. Qu’il s’agisse des conditions de fondation de Djenné-Djeno, dont l’archéologie date les premières traces d’occupation du IIIe siècle avant notre ère(9), ou encore du transfert vers l’actuelle cité de Djenné, à une époque que le Ta’rîkh al-Sûdân(10) situe autour de 1200, mais dont on sait qu’il s’est poursuivi jusqu’au début de 1400(11), les chercheurs ne possèdent pas de données suffisantes pour restituer une histoire, et moins encore pour définir l’identité des Djennéens de ce temps.
De même, si l’on dispose d’informations plus précises à propos du Mali, les chroniques s’attardent plus sur Gao et Tombouctou que sur Djenné. Rapportant des faits qui lui sont antérieurs de plus de trois siècles, le Ta’rîkh al-Sûdân indique que Kankun Mûsâ, de retour de La Mekke, se serait emparé de Gao en 1324, puis de Tombouctou(12). Mais pour Djenné, les chroniques restent floues, voire contradictoires. Le Ta’rîkh al-Sûdân affirme que la ville serait demeurée souveraine jusqu’à la conquête songhay(13), tandis que le Ta’rîkh al-Fattâsh indique qu’elle fut au contraire assujettie au Mali et tenue à verser l’impôt à l’épouse de l’empereur(14), après que ce dernier eut subi l’affront d’une attaque de ses pirogues par les armées djennéennes vers 1325, à hauteur de Kami(15), au nord de l’actuelle ville de Mopti (cf. carte 1).
|
Carte 1 : Batailles qui opposèrent les Songhay de Sonni Alî Ber aux Djennéens et localités des principaux chefs de guerre de Djenné au XVe siècle. |
S’il est impossible de repérer les Saman à cette époque, ils sont en revanche mentionnés dans les chroniques de Djenné à propos de la conquête songhay. La date précise de celle-ci est inconnue, mais on sait qu’elle intervint dans le même mouvement que celle de Tombouctou, qui eut lieu le 18 janvier 1469, et qu’elle se réalisa au prix d’un siège de plusieurs années, au terme duquel Sonni ‘Alî Ber épousa la veuve du chef défunt de Djenné en guise d’alliance(16).
Le Ta’rîkh al-Fattâsh décrit ici avec précision les trois grandes batailles menées par le conquérant songhay, avant qu’il n’assiège Djenné (cf. carte 1). Il est dit qu’il défit d’abord le " Kouran ", l’un des plus puissants chefs militaires de Djenné ayant autorité sur le " Chîtaï ", une région qui se situait à l’intersection du Niger et du Bani, incluant la localité de Kami déjà citée. Remontant la rive droite du fleuve, il se heurta alors au " Tounkoï ", chef de même rang que le " Kouran ", qu’il battit devant sa cité portuaire de Kouna, implantée sur le fleuve Bani, à 55 kilomètres au nord de Djenné. Puis il vainquit le " Soriâ ", qui se portait au secours du précédent, un chef de moindre importance qui commandait le pays de " Kanb’ga ", c’est-à-dire l’actuelle localité de Kouonbaka, située sur le Bani, à 35 kilomètres à l’est de Djenné(17).
Le sens de ces titres (Kouran, Tounkoï, Soriâ) qui avaient cours au XVe siècle est aujourd’hui oublié. Mais, à propos du " Tounkoï " de Kouna, nous avons établi avec une quasi-certitude un lien direct avec les Kansaye. En effet, si l’on reprend le texte arabe original de la chronique, on voit que ce n’est pas exactement le terme " Tounkoï " qui est mentionné, mais celui de Tunky, auquel les traducteurs ont ajouté le mot songhay koy qui signifie " chef ", pris dans son acception la plus large. Le terme Tunky renvoie vraisemblablement à " Toungka " (tuNka), qui désigne le " souverain " en langue soninke, et dont Maurice Delafosse rapportait qu’il s’agissait du titre royal en vigueur chez les Cissé de Ghâna et les Bâkyili de Galam(18). Or, chez les Saman de Kani-Gogouna, le titre traditionnel porté par les souverains Kansaye se réclamant du Kanyaga est précisément " Toungko " (tuNO), la voyelle "a" de " Toungka " étant prononcée ici comme un "o" ouvert.
Mais il ne s’agit pas du seul point qui témoigne du lien entre les Kansaye et ce Tunky. La chronique indique en effet que la résidence du Tunky se trouvait à Kouna, aujourd’hui modeste localité de la région que l’on appelle Fakala, mais qui était autrefois l’un des ports de Djenné les plus importants, situé à l’intersection de la voie fluviale Djenné-Tombouctou et de la piste commerciale qui traversait le pays dogon pour atteindre le pays haoussa. On peut se faire une idée de son importance économique avant l’époque coloniale, grâce à la description qu’en faisait René Caillé, après y avoir débarqué le 24 mars 1828, impressionné par l’ampleur du trafic qu’il y observait alors(19). Or, là aussi, les traditions des Kansaye de Kani-Gogouna mentionnent Kouna, et indiquent que c’est précisément à partir de cette localité que leurs ancêtres entreprirent leur premier mouvement migratoire vers l’actuel pays dogon, à la suite de la conquête de Sonni ‘Alî Ber.
*
* *
Le Ta’rîkh al-Fattâsh se borne à signaler qu’après la défaite devant les armées songhay, les populations de la région du Bani se réfugièrent dans le " Hadjar ", terme arabe qui désigne des massifs, lesquels font vraisemblablement référence au Pinia, situé à quelques dizaines de kilomètres à l’Est(20), sur la partie occidentale du plateau dogon. Mais les traditions recueillies à Kani-Gogouna sont plus loquaces : elles précisent que les Saman furent chassés par un certain Mûsâ Touré, et cet exode se traduisit par une scission en deux groupes.
Il est difficile d’identifier avec certitude ce Mûsâ Touré, dont le patronyme pourrait très bien se référer à un Marocain, peut-être le hakîm Muhammad B. Mûsâ, qui commanda Djenné du 10 août 1654 au 15 mai 1655(21). Mais les Saman le désignent comme songhay et, compte tenu de l’époque et de la conjoncture, on peut donc penser aussi à Muhammad B. Abou Bakr El Touri, celui qui devint le premier Askia, mais qui était auparavant le chef des armées de Sonni ‘Alî Ber, et donc à même d’avoir chassé le Tunky de Kouna vers 1468-69.
Quoi qu’il en soit, les Saman furent alors contraints de quitter la région de Kouna et ils s’installèrent à Tangadouba, dans les massifs du Pinia. Un groupe poursuivit sa route sur le plateau en direction du Sud-Est, pour arriver au bord de l’escarpement et occuper le haut de la falaise de Bandiagara, vers l’actuel Kani-Kombolé (cf. carte 1)(22). Ces Djennéens, connus sous le nom de " Saman-de-la-Falaise ", seront contraints à un nouvel exode au début du XVIIIe siècle, chassés par des groupes de guerriers dogon venus de la plaine du Seeno.
Quant aux Saman qui étaient demeurés autour de Tangadouba, ils redescendirent par la suite dans la vallée et réoccupèrent leurs anciens villages situés principalement sur la rive droite du Bani et du Niger, implantation qui détermina leur nom de " Saman-de-l’Eau ". Les traditions de Kani-Gogouna citent les localités de ces Djennéens, lesquelles s’étendaient de Kouna, au Sud, à Konna, au Nord, incluant Néma, Kolongui, Ya (aujourd’hui disparue), Dio, Ségué, Soufouroulaye (ou plus exactement Sio), Nianangali, Pérempé, Dialagou, Sokarel, Togonrogo, Saba, Wandiaka et Diamba-Kourou (cf. carte 2). Si beaucoup de ces villages sont aujourd’hui encore des chefferies marka ou nononke, on peut toutefois penser que ceux qui se trouvent au-delà de Pérempé furent occupés plus tardivement, après la conquête marocaine.
|
Carte 2 : Localités del'interfluve Bani-Niger occupées par les Saman entre le XVe et le XVII siècle |
Cette géographie rétrospective semble bien confirmer le fait que, après la conquête de la région, les Songhay optèrent pour la paix propice à l’activité économique de Djenné, veillant à reconduire les anciens pouvoirs territoriaux qui avaient reconnu leur autorité. Chroniques et traditions orales sont muettes quant aux conditions de cette réinstallation, et ce n’est que deux siècles plus tard, c’est-à-dire après l’arrivée des Marocains, que l’on retrouve les Saman, dans une position éminente.
*
* *
Mandaté par le Sultan de Fez, Ahmad Al-Mansûr, le Pacha Djûdar soumit la Boucle du Niger en prenant Gao le 12 avril 1591, puis Tombouctou le 30 mai et enfin Djenné(23), peut-être en 1598. L’administration que les Marocains mirent alors en place à Djenné ne fit pas table rase de l’organisation songhay. Si la cité, qui relevait en principe de Tombouctou, était bien administrée par un préposé à l’ordre public (Hakîm), puis par un gouverneur (Qâ’id) élu par les Arma de Djenné à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle(24), le chef songhay de Djenné conservait néanmoins certaines prérogatives en tant que " prince des noirs "(25).
Pourtant, cette politique de conciliation n’empêcha pas les troubles, à l’instar de l’ultime tentative de reconquête de Djenné par le Mali, en 1599, ou encore du soulèvement de la ville de Konna, en 1609(26). Mais les évènements les plus graves, au cours desquels on retrouve les Saman, commencèrent en juillet 1653, pour s’achever le 12 mars 1656. Le Ta’rîkh al-Sûdân, témoignant là de faits qui lui sont contemporains, indique que le chef de Djenné, Abû-Bakr, " que les nègres dans leur langage appellent Ankaba’la […,], s’est révolté contre les gens du Makhzen(27) de Dienné et […] a gagné la campagne ", entraînant sa destitution au profit de son frère Muhammad Kambara. En fait de campagne, précise la chronique, Abû-Bakr s’enferma dans la " ville de Chio, chez Sâtonka-Chima ", puissante cité équipée de trois forteresses, à laquelle les Arma se heurtèrent à huit reprises sans succès(28).
Cette ville de Chio, ou Chiou, que la chronique cite un certain nombre de fois(29), n’existe plus. Mais un document français anonyme, datant de la fin du XIXe siècle, la mentionne sous le nom de Sio, en indiquant qu’elle aurait été détruite vers 1870 par Tidjani Tall, qui déporta les populations à Soufouroulaye, localité qu’il fit construire non loin de là, dans la vallée, pour y installer provisoirement sa capitale(30) (cf. carte 3). Or, non seulement la chefferie de Soufouroulaye est toujours détenue par des Marka du clan Kamia, mais les traditions des Saman du pays dogon évoquent elles aussi Sio, situant cette ancienne ville fortifiée tout près de Soufouroulaye.
|
Carte 3 : Mouvements de migrations des Saman après le soulèvement d'Abû-Bakr contre les Arma, en 1653 |
Quant au chef de cette cité, que la chronique nomme " Sâtonka-Chima ", il s’agit en fait d’un " Chima " (que les Marocains traduisaient par Qâ’id, ou commandant de corps d’armée et gouverneur militaire d’une cité(31)), un titre militaire qui renvoie sans doute au terme Sama d’origine marka, que l’on retrouve à Dia et dans le Pondo, et qui désignait à Djenné les deux principaux généraux de l’armée songhay(32).
Outre l’analogie entre le nom de ce titre et l’ethnonyme Saman –ce qui pourrait signifier que les Saman se définissent littéralement comme " Ceux-du-Sama " – , le chef de la cité de Sio ne nous est pas inconnu. En effet, si " Sâ-Tonka " semble ici être pris pour un nom propre, le terme " Tonka " est en fait une autre transcription de Tunky. Cela signifie que la chefferie traditionnelle de Kouna, dont se réclament les actuels Kansaye du pays dogon, aurait été transférée à Sio entre le XVe et le XVIIe siècle, en même temps qu’elle était intégrée à l’organisation politico-militaire songhay de Djenné. Mais la rébellion d’Abû-Bakr contre les Arma entraîna ces Saman de Sio dans un second exode, et c’est à nouveau le Ta’rîkh al-Sûdân qui nous en fourni les données préalables.
*
* *
Les coalisés évacuèrent en effet Sio en juin 1654, pour continuer la lutte à " Bînâ ", qui est probablement l’actuel village de Bina, situé à 45 kilomètres au sud-ouest de Djenné (cf. carte 3). À partir du mois d’août, la situation devint critique pour les Arma, car " le Djinni-Koï [c’est-à-dire le chef songhay, Abû-Bakr] avait soulevé avec lui toutes les populations soudaniennes en sorte que les Marocains n’avaient plus personne qui reconnût leur autorité ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière "(33).
La situation demeura ainsi jusqu’en mars 1656, date à laquelle le Pacha de Tombouctou fut informé que " le néfaste, le kharidjite, le Djinni-Koï Bokar [ou Abû-Bakr], avait équipé une armée et s’était mis en marche sur Kanba‘a [ou Kouonbaka] dans le dessein de tuer Soryâ [le descendant de celui qui lutta contre Sonni ‘Alî Ber] […], et de s’emparer de sa ville, afin d’intercepter les routes à ceux qui se rendaient à Dienné. Mais il se trouva que le lieutenant-général Abdallah El Mâssi [un Marocain], avec environ trente fusiliers de garde, était à ce moment à Kanba‘a. Quand les hommes de Djinni-Koï arrivèrent près des remparts de la ville, le combat s’engagea : Dieu donna la victoire au lieutenant-général et à Soryâ qui mirent en fuite le Djinni-Koï ainsi que sa troupe de misérables rebelles, après les avoir battus et leur avoir tué au moins trois cents hommes, grâce à l’appui et à la puissance de Dieu. Les rebelles, déçus dans leurs espérances, tournèrent le dos. Dieu en fit périr un grand nombre et, dans sa grâce et sa générosité, délivra de ce fléau les hommes et le pays "(34).
Ici s’arrête la chronique, laissant entendre que la " troupe de misérables rebelles ", dans laquelle on compte les ancêtres des Saman, abandonnèrent le pays. Les traditions des Saman évoquent effectivement la migration du clan Soulo (ou Sylla) qui, aux côtés d’un groupe dogon Karambé, se rendit alors à Kaka (l’actuelle Sofara) pour franchir le Bani, puis longea l’escarpement vers l’Est, monta sur le plateau dogon au niveau de Koundou (près de Sangha, qui n’existait pas encore) et se scinda en deux groupes : l’un s’installa sur la partie orientale du plateau, dans la région de Mory-Madougou, tandis que l’autre se dirigea vers l’Ouest jusque dans le secteur de Bandiagara(35), une ville qui ne sera bâtie qu’à la fin du XIXe siècle (cf. carte 3).
Les autres groupes saman remontèrent quant à eux vers le Nord et demeurèrent dans la vallée du Bani-Niger dans des conditions qui nous sont assez mal connues. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que nous les retrouvons, période où ils déclenchèrent une série de guerres vers le Nord : on sait que des Kampo s’emparèrent de Konna(36), tandis que des Tarawouré partirent s’installer au nord-ouest du plateau dogon, autour de Gew-Madougou(37). Quant aux Kansaye et aux Kamia, accompagnés par un groupe de Kampo, ils décidèrent de quitter Konna pour aller à Wandiaka, avant d’en être chassés et de se réfugier à Dialagou. C’est dans les années 1780-1790 qu’ils partirent de la région, pour se diriger vers le pays dogon et fonder Kani-Gogouna, où ils vivent toujours (cf. carte 4).
|
Carte 4: Ultime migration des Saman sur le plateau dogon à la fin du XVIIIe siècle |
*
* *
Les causes de ces guerres et de ces exodes successifs sont très probablement liées aux campagnes des Bamana de Ségou. Les traditions rapportent que ces derniers guerroyèrent en effet dans la région de l’actuelle Sévaré(38), Jean Gallais situant entre 1730 et 1750(39) l’installation de nombreux villages bamana autour de Mopti et au nord du plateau dogon. Mais c’est au temps de Ngolo Diarra (qui, selon l’ethnologue Jean Bazin, régna de 1766-70 à 1787-90(40) que les Kansaye, les Kamia et les Kampo durent s’exiler vers le pays dogon, Ngolo ravageant la région de Wandiaka, avant d’aller occuper un temps une partie du plateau occidental(41).
C’est donc cet ultime exode qui amena définitivement les Saman sur le plateau dogon, après qu’ils eurent quitté le fleuve dans des conditions dramatiques, dont leurs traditions témoignent encore. L’histoire des Saman qui s’ouvre désormais est un chapitre que nous n’aborderons pas ici, parce qu’elle ne concerne plus guère Djenné. Confrontés aux Dogon, avec qui ils établiront des alliances, les Kansaye fonderont, en réunissant les Saman-de-la Falaise et les Saman de l’Eau, la cité-État indépendante de Kani-Gogouna au début du XIXe siècle, peu de temps avant la mise en place de la Diina de Cheikhou Amadou (1818).
Mais malgré cette rupture géographique et historique avec Djenné, les Saman veilleront à conserver leur culture djennéenne, que ce soit à travers la pratique de l’Islam, celle du commerce, ou encore leur organisation politique, laquelle s’inspire de celle de Djenné et des cités marka de la vallée du Niger. Aussi, cette préservation identitaire conduira-t-elle les Saman à s’allier aux États théocratiques qui s’imposeront dans la Boucle du Niger au XIXe siècle : Kani-Gogouna deviendra, à partir de 1864, un important émirat détenteur d’un tambour politico-militaire (que l’on nomme tubal en fulfulde), une évolution qui se fera au détriment des anciennes alliances des Saman avec les Dogon.
Telle est l’histoire oubliée de ces Djennenke du pays dogon, dont on parvient pourtant à suivre la trace à travers les deux grandes chroniques locales que sont le Ta’rîkh al-Sûdân et le Ta’rîkh al-Fattâsh, une histoire incroyablement conservée par la tradition orale, parce qu’elle est garante de leur existence loin de Djenné. On peut toutefois s’étonner que ces Saman aient ainsi sans cesse reflué de cités en villages, pour aboutir finalement au cœur du pays dogon. En vérité, ils ne furent nullement des cultivateurs attachés à un terroir, mais des gens de guerre liés à Djenné, et qui, dans une conjoncture de paix, pouvaient alors devenir des citadins vivant de négoce. Mais quand la guerre était là, et surtout la défaite, c’est seulement par l’exode que les Saman, sans terres ni attaches, pouvaient conserver leur liberté et leur identité djennéenne.
(1)
Les données ethnohistoriques originales de ce texte sont tirées
d'une enquête de terrain que nous avons effectuée de 1993 à
1995. Celles-ci sont reprises dans notre ouvrage sur les Saman, qui sera édité
par la Société d'ethnologie de Nanterre à l'automne 2001.
Nous voudrions ici remercier tout particulièrement les Saman, pour l'accueil
et l'aide qu'ils nous ont offerts, et saluer la mémoire de notre assistant
et ami Boulkassoum Ouologuem, sans qui ce travail n'aurait jamais vu le jour.
Retour au texte
(2) Contrairement aux noms de
famille, qui sont officiellement transcrits avec l'orthographe française,
nous avons conservé une transcription phonétique simplifiée
pour les noms de populations.Retour au texte
(3) Les Nononke, groupe mal
connu vivant dans la vallée du Niger, se seraient dispersés à
partir d'une mystérieuse cité, Nono, aujourd'hui disparue. Les
Nononke, qui sont en général associés aux Marka "
noirs ", se caractérisent notamment par un islam jugé antérieur
à l'empire du Mali ainsi que par la pratique de la teinture à
l'indigo et du commerce.Retour au texte
(4) Voir chez cet auteur : Le
Delta intérieur du Niger. Étude de géographie régionale,
2 t., IFAN, Dakar, Mémoire de l'IFAN, 1967 : 110-111, ainsi que : Hommes
du Sahel. Espaces-Temps et Pouvoirs ; Le Delta intérieur du Niger 1960-1980,
Paris, Flammarion, 1984 : 23 et 24 n. 2.Retour au texte
(5) Lire ici G. Calame-Griaule
(" Les dialectes dogon ", Africa XXVI, 1956 : 66), J. Gallais (Pasteurs
et paysans du Gourma ; la condition sahélienne, Bordeaux, Mémoire
du CEGET, Paris, CNRS 1975 : 110) et J.-C. Moine ("Gens de Djenné"
en pays dogon ; les Janaga des vallées du Jew, thèse de doctorat,
Université de Paris X-Nanterre, 1998).Retour au texte
(6) Voir C. Monteil : Monographie
de Djénné, Cercle et ville, Tulle, Imp. J. Mazeyre, 1903 : 263.Retour
au texte
(7) Ibid. : 292-293.Retour
au texte
(8) Cf. M. Delafosse : La langue
manding et ses dialectes (Malinke, Bambara, Dioula), 2 t., Paris, Librairie
orientaliste Paul Geuthner, 1929 : 481.Retour au texte
(9) Voir notamment les dernières
conclusions sur les fouilles de Djenné-Djeno par R. J. McIntosh : The
People of the Middle Niger. The Island of Gold, Malden, Blackwell Publishers,
1998.Retour au texte
(10) Al-Sa'di : Ta'rîkh
al-Sûdân, (trad. O. Houdas : Tarikh es-Soudan), Paris, Ernest (manuscrit
rédigé en 1655), 1900 : 24.Retour au texte
(11) Cf. J. Devisse et R. Vernet
: " Le bassin des vallées du Niger. Chronologie et espaces ",
in Vallées du Niger, Paris, Éditions de la Réunion des
musées nationaux, 1993 : 21.Retour au texte
(12) Al-Sa'di, op. cit. : 14-15.Retour
au texte
(13) Ibid. : 21, 25.Retour
au texte
(14) À propos du rôle
politique de cette épouse appelée Kasa, on peut lire ici Ibn Battûta
(cf. C. Defremery & B. R. Sanguinetti : Voyages d'Ibn Battuta, Paris, Éditions
Anthropos [Coll. Textes et documents retrouvés] 1969 [1ère éd.
1854] : 417-419, t. IV), qui la décrit montant à cheval et étant
" dans le gouvernement l'associée du souverain ".Retour
au texte
(15) Kâti : Ta'rîkh
al-Fattâsh fî akhbâr al-buldân wa-l-djuyûsh wa-akâbir
al-Nâs, (trad. O. Houdas & M. Delafosse : Tarikh El-Fettach), Paris,
E. Leroux (manuscrit A rédigé en 1665 à Cordoue, repris
plusieurs fois jusqu'au XIXe siècle), 1913 : 65.Retour
au texte
(16) Al-Sa'dî, op. cit.
: 26-28.Retour au texte
(17) Kâti, op. cit. :
96-97. Nous remercions ici Jean Bazin, qui nous a permis de situer le plus précisément
possible les localités citées par la chronique et qui existent
aujourd'hui encore.Retour au texte
(18) M. Delafosse, op. cit.
481.Retour au texte
(19) R. Caillié : Voyage
à Tombouctou, Tome 1 et 2, Paris, Editions La Découverte (éd.
originale : 1830), 1996 : 166-168.Retour au texte
(20) Kâti, op. cit. : 96-97.Retour
au texte
(21) Al-Sa'di, op. cit. : 483.Retour
au texte
(22) La présence des
Saman dans cette région est rappelée à travers les traditions
orales dogon, qui sont reprises dans les célèbres chants épiques
du baji-kan ; cf. notre thèse de doctorat : Le système politique
sama. Parcours et relations d'une société guerrière dans
la Boucle du Niger ; analyse comparative (sous la dir. de R. Jamous), Université
de Paris X-Nanterre, 2 t., 2000.Retour au texte
(23) Al-Sa'dî, op. cit.
: 219-222.Retour au texte
(24) Lire M. Abitbol : Tombouctou
au milieu du XVIIIe siècle (d'après la chronique de Mawlây
al-Qâsim B. Mawlây Sulaymân), (présentée et
traduite par…), Paris, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1982 : 46 n. 143, 71.
Le nom " Arma ", qui vient de ruma (litt. " tirailleurs, fusiliers
") devint en usage pour désigner les Marocains du corps expéditionnaire
qui prirent leur indépendance vis-à-vis du Sultanat de Fez (Abitbol,
op. cit. : 49, n. 171).Retour au texte
(25) Al-Sa'dî, op. cit.
: 461.Retour au texte
(26) Ibid. : 278, 303, 445.Retour
au texte
(27) Comprendre : l'administration
marocaineRetour au texte
(28) Ibid. : 445, 461, 476-477,
480.Retour au texte
(29) Ibid. : 104, 445, 447
sq.Retour au texte
(30) Lire ici M. Sissoko : "
Chroniques (El Hadji Oumar et Cheikh Tidiani) ", L'Éducation Africaine
26, n° 97, 1937 : 141 n. 1.Retour au texte
(31) M. Abitbol, op. cit. :
72.Retour au texte
(32) Al-Sa'dî, op. cit.
: 243, 248, 453.Retour au texte
(33) Ibid. : 477-480.Retour
au texte
(34) Ibid. : 488-489.Retour
au texte
(35) Ces Soulo quitteront cette
région dans le premier tiers du XIXe siècle, en fuyant l'État
théocratique de Hamdallaye aux côtés de leur allié,
le chef des Fulbe de Goundaka, Geelaajo, fils du célèbre Ham Bo'deejo.Retour
au texte
(36) J. Gallais 1984, op.
cit. : 30, 155.Retour au texte
(37) J.-C. Moine, op. cit.
: 24, 77.Retour au texte
(38) L. Desplagnes : Le
plateau central nigérien, Paris, Larose, 1907 : 174, 175 n. 1.Retour
au texte
(39) J. Gallais 1975, op.
cit. : 132.Retour au texte
(40) In C. Monteil : Les Bambara
du Ségou et du Kaarta, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larose (1ère
éd. : 1924), 1977 : 413.Retour au texte
(41) Lire ici C. Monteil, op.
cit. : 75-76 ; A. H. Bâ et J. Daget : L'empire peul du Macina (1818-1853),
Abidjan, Les Nouvelles Editions Africaines (1ère éd. 1962), 1984
: 131.Retour au texte
________________________________
Ont participé à la rédaction de ce bulletin : Amadou Tahirou Bah, Joseph Brunet-Jailly, Boubou Cisse, Foourou Alpha Cisse, Papa Ousmane Cissé, Andrée Ducoloner, Gilles Holder, Susan McIntosh, Mamary Sidibe