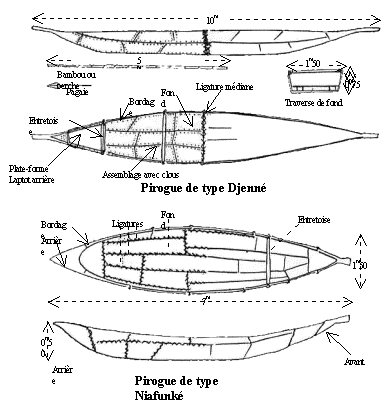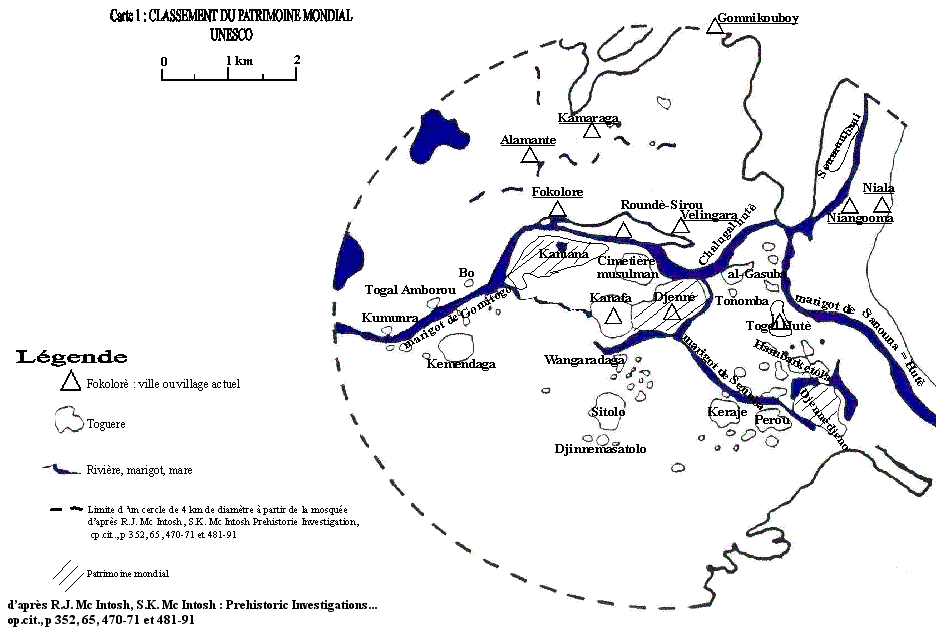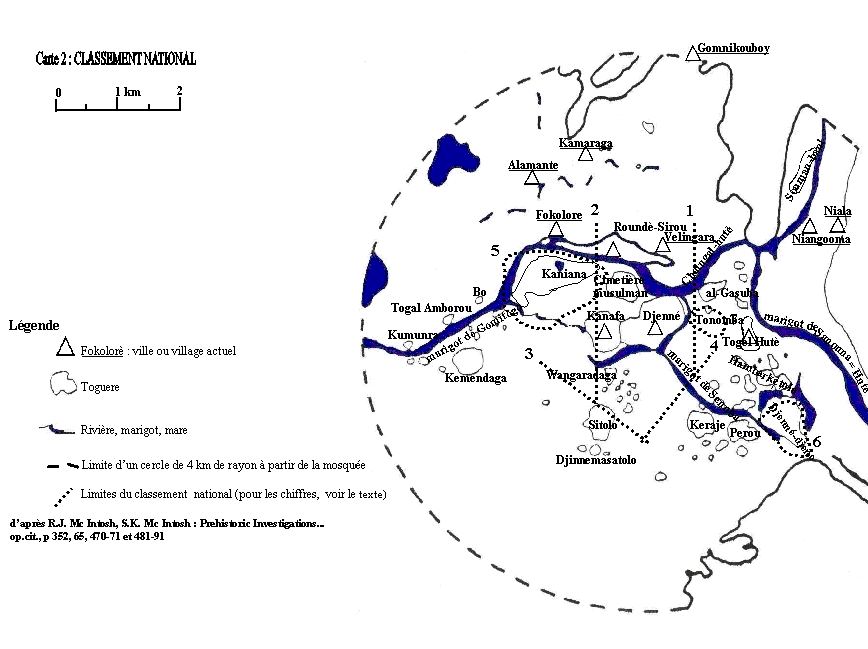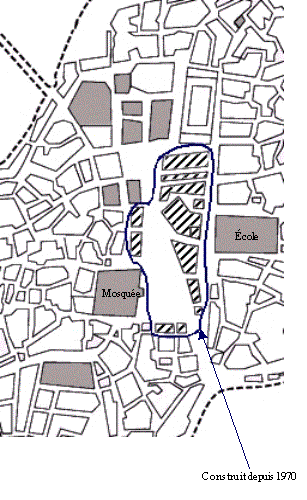Le Chef de l’Etat, le Général Amadou Toumani
Touré, est venu à Djenné le 23 mars 2003,
pour l’inauguration du chantier de la piste Djenné-Mougna-Saye.
L’inauguration de la mairie a eu lieu en
présence du Ministre de la Culture, Cheick Oumar Sissoko, le 28 janvier 2003.
Une importante réunion concernant les barrages
de Talo et de Djenné, le 15 février 2003
Ce forum a regroupé à Djenné, outre le Ministre
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, le Ministre délégué au plan,
le Ministre délégué à la sécurité alimentaire, les cadres techniques nationaux
et régionaux, les représentants de tous les cercles riverains du Bani des
régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti (Kolondiéba, Dioïla, Bla, San,
Djenné et Mopti).
Ce forum, maintes fois reporté, vient clôturer
une longue série de rencontres pleines d’incompréhension entre le gouvernement
et les ressortissants et amis de Djenné à travers le monde. Pendant quatre
ans, les populations du cercle de Djenné se sont opposées à la réalisation
du seuil de Talo, pour les raisons suivantes :
1) manque d’information des populations situées
en aval et en amont du site du seuil, avant sa réalisation ;
2) pourquoi réaliser Talo alors que le seuil de
Djenné, plus important que celui de Talo, n’a fait l’objet d’aucune recherche
de financement de la part de l’Etat malien ?
3) la hantise de voir les eaux du Bani détournées
en faveur d’une zone de culture sèche au détriment de Djenné, zone rizicole
par excellence ;
4) le retard de la crue du Bani, consécutif à la
construction du seuil de Talo, pourrait non seulement compromettre les récoltes,
diminuer les espaces cultivables, et anéantir les pâturages, alors que Djenné
reçoit chaque année des troupeaux du Seno, de Ségou et même de Mauritanie.
Les institutions bancaires avaient un moment bloqué
les fonds, exigeant des études complémentaires et l’obtention d’un consensus
des usagers en amont et en aval.
Mais, pendant ces quatre années, aucun des gouvernements
successifs du pays n’a envisagé l’abandon du projet de Talo. Cependant des
efforts ont été faits pour une nouvelle conception du seuil, et des mesures
d’accompagnement ont été proposées pour atténuer les impacts négatifs de la
réalisation de cet ouvrage sur le cercle de Djenné.
Quelques semaines avant la tenue du forum, l’atmosphère
était électrique au sein de la population du cercle de Djenné. Deux tendances
sont apparues : ceux qui encouragent le refus catégorique sans aucune
concession, au risque de tout perdre, et ceux qui sont prêts à dialoguer,
négocier, faire des propositions au gouvernement, l’acceptation de ces dernières
pouvant conduire à la fin du bras de fer. Ces propositions sont notamment
les suivantes :
- diligenter les études et réaliser le seuil de
Djenné
- lancer immédiatement la recherche de fonds pour
la réalisation du seuil de Djenné
- surcreuser des chenaux à partir du Bani et du
Niger pour permettre une inondation des plaines avant la réalisation su seuil
- relier le Pondori à la piste Djenné-Saye
- octroyer une aide alimentaire au cercle de Djenné
compte tenu de l’état des récoltes cette année.
Après trois heures de débats, d’explications et
de recherche de consensus, comme les maliens savent le faire sous le vestibule
du chef de village, sous l’arbre à palabres, ou sous le tougouna, les litiges
les plus cinglants ont généralement eu un dénouement heureux. C’est ainsi
qu’une commission de rédaction composée d’un représentant par cercle, a proposé
la résolution suivante :
1) créer un comité de pilotage pour la réalisation
des seuils de Talo et de Djenné ;
2) créer un comité de bassin du Bani ;
3)
accélérer les études complémentaires pour la réalisation du seuil de Djenné ;
4)
procéder au démarrage du seuil de Talo ;
5)
réaliser des mesures d’urgence d’accompagnement dans les cercles de Djenné
et de Mopti ;
6)
surcreuser les chenaux à partir du Bani et du Niger.
Dans le cadre de l’appui sur le plan alimentaire,
le ministre délégué à la sécurité alimentaire a annoncé au cercle de Djenné
un don gratuit de 2500 tonnes de céréales et 300 tonnes d’aliments du bétail
cédés aux éleveurs au prix d’usine.
La résolution ayant pris en compte les aspirations
des uns et des autres, elle a été acceptée de tous. Le porte-parole de Djenné
a affirmé qu’il n’y a ni perdant ni gagnant, le seul gagnant c’est le Mali.
Seulement la population de Djenné recommande aux autorités du Mali une application
rigoureuse de la présente résolution. C’est avec un grand espoir pour l’avenir
que les différentes délégations ont quitté Djenné pour avoir réussi par le
dialogue à trouver la solution d’un problème dont personne ne présageait à
l’avance une telle issue heureuse. Tout le mérite en revient au ministre de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Monsieur Seydou Traore, qui a
eu le courage de rencontrer les gens de Djenné et de leur parler en frère.
Foourou Alpha Cissé, Premier adjoint au maire de Djenné
Pour beaucoup de lecteurs, ce compte-rendu au ton
intentionnellement apaisant devra sans doute être éclairé par un certain nombre
d’informations complémentaires, que voici.
Autour des trois ministres, Messieurs Seydou Traore
(agriculture), Ibrahim Oumar Toure (sécurité alimentaire) et Marimanthia Diarra
(plan), on trouvait à cette réunion les Présidents des conseils des cercles
de Bla, Bougouni, Dioïla, Djenné, Kolondieba, Mopti, San, Ségou, Sikasso,
les directeurs régionaux de l’agriculture de Ségou et de Mopti, un représentant
de chacune des douze communes du cercle de Djenné, mais aussi le préfet de
Djenné et le Haut Commissaire de Mopti, et encore le député de Djenné, le
chef de village, un représentant de l’imam, le Président de l’AMUPI, trois
représentants des catégories professionnelles (les agriculteurs, les éleveurs
et les pêcheurs), et le représentant des ressortissants de Djenné résidant
à Bamako… Au total, plus de 100 personnes, dont vingt-trois pour représenter
Djenné. Chacun a vite compris que les représentants de Djenné étaient noyés
dans une foule, et que tous les représentants des nombreux cercles situés
en amont du futur barrage ne pouvaient pas avoir la même position que ceux
des deux seuls cercles situés en aval ! En outre, l’atmosphère était
si tendue dans la ville, que l’accès à la salle était conditionné par la présentation
d’une carte d’invitation, et que ses abords étaient ceinturés par des hommes
en armes ! Djenné n’avait jamais vu un tel déploiement de forces dans
ses murs, et chacun se demandait : pourquoi tant de précautions ?
Radio Jamana transmettait en direct les débats qui se déroulaient dans la
Maison du Peuple.
En effet, cette réunion avait été soigneusement
préparée par l’administration. La direction régionale de l’agriculture avait
sillonné le cercle, assurant que le projet n’avait aucun des inconvénients
dont certains avaient parlé, et promettant des mesures d’accompagnement. Puis
le ministre de l’agriculture lui-même est venu en visite « privée »
à Djenné le 19 janvier, pour soutenir et organiser les partisans du projet ;
et le 7 février 70 représentants d’une vingtaine de villages du cercle étaient
réunies à Soa, apparemment à l’initiative d’une association locale, Benkadi,
présidée par le maire de Gomitogo.Cette association a été créée il y a quelques années à l’initiative
de Care-Mali pour soutenir ses activités. Or il est apparu que les ouvrages
construits par Care-Mali dans le Pondori ne servent à rien si l’eau n’entre
pas dans les plaines : Benkadi est donc devenue un soutien actif des
projets de barrage de Talo et de Djenné. Le Président de la chambre d’agriculture
décrit ainsi l’atmosphère de la rencontre : « on nous a fait comprendre
que la construction de ce barrage était inéluctable, il s’agissait donc seulement
de discuter de mesures d’accompagnement. » Dans le même esprit, une mission
d’explication a été organisée par l’Assemblée régionale
de Mopti : le vice-président du conseil de cercle de Djenné a été envoyé
dans les villages, essentiellement pour établir la liste des mesures d’accompagnement :
à Konio, à Sofara, à Taga… De même le Président de la Chambre d’agriculture
s’est déplacé dans les chefs-lieux des communes pour obtenir leur ralliement.
Pour mesurer l’inquiétude engendrée à Djenné par
cette campagne, il suffisait d’assister à la grande prière le jour de la tabaski,
le 12 février, et d’entendre les bénédictions faites, devant des milliers
de personnes, tous les hommes que compte la cité, et dans le plus grand silence,
pour que le barrage de Talo ne se réalise jamais !
La réunion avec les ministres avait enfin été préparée
à Djenné même, le samedi 14 février au soir. Beaucoup de gens se sont retrouvés
à l’école, de 21 h à 2 h du matin, à l’initiative du député, qui avait téléphoné
à la fois au maire et à un autre notable pour leur demander de convoquer les
gens. Le député de Djenné présidait une grande assemblée où l’on remarquait
notamment le second député du cercle, des représentants de sept communes du
cercle, les plus directement concernées (Nema Bangnena Kafu, Wouro Ali, Femaye,
Gomitogo –dont le maire et son adjoint–, Dandougou Fakala, Sofara, Derary),
de nombreux chefs de famille de Djenné même, des représentants des groupes
professionnels et des personnalités telles que le premier adjoint au maire
de Djenné, et le maire lui-même, ainsi que trois représentants des djennenké
de Bamako. Les discussions ont été longues parce que le Président a demandé
à chaque commune de donner ses arguments. Mais la position unanime était la
suivante : les présents s’opposent au lancement des travaux du barrage
de Talo et à toutes les mesures d’accompa-gnement, qui ne servent qu’à acheter
des avis favorables ; ils demandent, avant toute nouvelle discussion,
que soit réalisée une étude sérieuse de l’impact de ce projet à l’aval, notamment
dans le cercle de Djenné. A la fin de la réunion, vers 2 h du matin, la présidence
promettait de rédiger ces conclusions pour le lendemain matin et de les défendre
devant les ministres.
Mais là, devant les ministres, les interventions
étaient si unanimement favorables au projet de barrage, et les mesures d’accompagnement
exploitaient de façon si évidente les mauvaises récoltes dont le cercle de
Djenné souffre cette année, que ses représentants ont vite compris qu’ils
étaient tombés dans un traquenard organisé depuis Bamako. Aussi, après la
suspension des débats prononcée à 14 h pour la prière, les représentants des
groupes socio-professionnels de Djenné ont décidé de ne pas rejoindre la salle
des débats.
A vrai dire, un membre de la délégation venue de
Bamako avait clairement affirmé dans la salle, chacun l’a entendu à la radio
: « nous ne sommes pas venus pour négocier les barrages, mais pour les
mesures d’accompagnement ; si vous persistez à refuser, vous ne sortirez
pas de cette réunion la tête haute ». C’est ce même message que
l’administration avait fait passer pendant des mois : l’Etat fera Talo,
que Djenné le veuille ou non, il est donc inutile de s’y opposer ; mais
on mettra des formes à cette capitulation… De fait, trois ministres sont venus,
ils ont parlé aux gens de Djenné, et ce faisant, ils ont montré qu’ils ne
méprisaient pas Djenné, et donc les notables de Djenné ont pu donner leur
accord du bout des lèvres.
La commission chargée de rédiger les recommandations
était ainsi composée : les représentants élus des cercles de Bougouni,
Koutiala, San, Bla et Mopti, plus le Haut Commissaire. Mais le cercle de Djenné,
lui, était représenté par le préfet de Djenné ! Cette commission rédigera
les recommandations suivantes :
1) « création et mise en place d’un comité de pilotage
des seuils de Djenné et de Talo
2)
création et mise en place
du comité du bassin du Bani
3)
accélérer la mise en œuvre
du projet de développement intégré du cercle de Djenné (seuil de Djenné)
4)
démarrage des travaux du
seuil de Talo (phase I)
5)
réalisation des mesures
d’urgence pour soutenir la production agricole dans les cercles de Djenné
et Mopti (VRES, PNIR, PADR), surcreusement des chenaux d’irrigation à partir
des fleuves Niger et Bani pour améliorer l’alimentation des plaines ;
6)
prendre les mesures nécessaires
pour l’approfondissement de la connaissance des ressources en eau pour une
meilleure gestion des ouvrages ;
7)
accélérer les études des
sites identifiés sur le haut bassin du Bani »
C’est alors que, pour ceux qui suivaient les débats
à la radio, s’est produit le coup de théâtre : au grand dam de la population
de Djenné, son député, son chef de village et son maire ont accepté ces recommandations,
et le représentant de son imam y a ajouté ses bénédictions ! Il ne restait
plus au Président du conseil de cercle et au Préfet qu’à apposer leurs signatures !
Propreté de Djenné
Depuis le 3 août 2002, un agent de la direction
nationale de l’assainissement et de la lutte contre les pollutions et les
nuisances, Monsieur Bakary Coulibaly, a été affecté à Djenné. Il a été rejoint
par un volontaire américain, Nathan Forsythe. Ce service ne dispose cependant,
jusqu’à présent, ni de local, ni de budget, ni de matériel. Pourtant il a
relancé certaines activités et recommencé à mobiliser toutes les personnes
et groupements qui jouent un rôle dans la propreté de Djenné.
Ainsi, le 24 décembre 2002, une réunion a rassemblé
autour du préfet toutes les associations féminines qui interviennent dans
ce domaine, les services publics concernés, les hôteliers, les guides, les
milieux religieux (AMUPI), les services de l’enseignement (CAP) et les « porteurs
d’uniformes » (gendarmerie, garde nationale). Parmi les questions débattues
figurait la relance du balayage de Djenné, l’évacuation des eaux usées et
l’installation de poubelles dans la ville.
Depuis des années, le balayage de la place du marché
et des rues adjacentes dépend d’associations féminines, qui ont été périodiquement
motivées par des dons de matériels et par des promesses de subventions, et
périodiquement découragées par les promesses non tenues. Ainsi, en août 2002,
les associations concernées souffraient d’un retard de cinq mois dans la modeste
subvention municipale grâce à laquelle elles fonctionnent (60.000 FCFA par
mois, soit 12500 FCFA par association). Actuellement cinq associations ont
repris le travail, deux fois par semaine (lundi soir ou mardi, et samedi) :
- la Coopérative multifonctionnelle, présidée par
Mme Aïssata Simpara,
- Badegna, à Djoboro, présidée par Mme Mamou Sao,
- Hamfendou, à Seymani, présidée par Mme Wahou
Naciré,
- AFAM, à Farmantala, présidée par Mme Tata Santara,
- Faïda, à Yoboucaïna, présidée par Mme Tata Souko
et trois autres ont manifesté l’intention de se
remettre au travail :
- Sabunyuman, à Kanafa, présidée par Mme Fanta
Kanta,
- Lahidou, à Farmantala, présidée par Mme Nako
Yaro
- Demessen bolo, à Yoboucaïna, présidée par Mme
Aïssa Toure
Parallèlement, le nouveau service prenait contact
avec tous les notables et les chefs de quartiers, et sensibilisait la population
sur le thème de l’évacuation des eaux usées. Au cours de visites des quartiers,
un certains nombre de chefs de familles ont été invités soit à installer un
canari ou une fosse cimentée pour recueillir les eaux usées pendant la journée
(elles seront déversées sur la rue dans la nuit et y sécheront avant le lever
du jour au lieu d’y stagner toute la journée) ; d’autres à faire de petits
aménagements dans la rue pour canaliser les eaux usées.
Après cette action, une commission de verbalisation
nommée d’après la tradition ndie fisifisi, celui qui s’occupe du balayage,
a été constituée pour surveiller les effets de la sensibilisation : des
amendes allant de 3.000 à 18.000 FCFA pourront être infligées (loi 01-020
du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances). Parallèlement, un prix
de la propreté a été créé, doté de 500.000 FCFA, qui sera attribué aux trois
quartiers qui auront fait le plus grand effort (premier prix : 250.000
FCFA ; second prix : 150.000 FCFA ; troisième prix : 100.000
FCFA).
Bakary Coulibaly, chef du service d’assainissement
Ces nouvelles appellent un commentaire. On ne peut
que se réjouir de voir qu’un nouvel effort est entrepris pour la propreté
de Djenné. Cependant, on y voit les administrations centrales continuer à
nommer des agents dépendant d’elles dans les communes, et compter sur les
mairies pour fournir à ces agents les moyens de travailler. Localement, les
agents des services centraux faisant bloc, la mairie se trouve dépossédée
des décisions qui lui incombent d’après les textes sur la décentralisation.
Le préfet décide et demande ensuite à ses services de veiller à ce que le
maire prenne les arrêtés municipaux qui s’imposent. La décentralisation est-elle
donc une façon de mettre à la charge de la collectivité locale de nouvelles
charges tout en lui imposant un contrôle plus étroit par la présence d’un
personnel central plus important ? D’un autre côté, si la mairie reconnaît
que « du fait que nous sommes tous parents, à Djenné, il ne nous est
pas possible de recourir à la force » pour imposer des décisions d’intérêt
collectif, ne faut-il pas que l’administration centrale agisse ? Aujourd’hui,
la mairie ne peut s’affirmer qu’en tardant indéfiniment à financer les actions
décidées en dehors d’elle, et les administrations continuent à prospérer en
décidant à la place des intéressés !
Evaluation
de l’expérimentation d’assainissement de Djenné
L’expérimentation lancée par l’Université technologique
de Delft dans les quartiers de Yoboucaïna et Bamana a été évaluée en janvier
2003. On y apprend notamment que plus de 600 maisons de Djenné
sont raccordées au réseau d’eau. Cependant, dans le quartier de Yoboucaïna,
et plus précisément dans le secteur choisi pour l’expérience, la grande majorité
s’approvisionne aux fontaines publiques (25 des 30 maisons concernées). D’après
l’étude faite auprès de ces 30 maisons, la consommation maximum journalière
d’une famille raccordée est de 528 litres, à comparer à 234 litres pour une
famille non raccordée.Dans ce quartier, la capacité d’infiltration du sol, argileux comme
ailleurs dans Djenné, serait néanmoins assez importante : presque 300
litres par m2 et par jour. Néanmoins, les fosses d’infiltration, enterrées
à 50 cm en dessous du niveau du sol, ont des volumes assez conséquents :
de 0,4 à 1,8 m3, selon la consommation d’eau de la maison. Le coût de l’opération
a été de 2 millions FCFA, ce qui représente en ordre de grandeur une dépense
de 60.000 FCFA par maison (certaines sont équipées de deux, voire de trois
dispositifs). L’évaluation se termine par les questions suivantes :
- est-ce qu’on doit redouter un compactage du sol
dans les fosses d’infiltration, ce qui diminuerait progressivement leur capacité
d’infiltration ?
- est-ce qu’on doit redouter, comme conséquence
à terme de l’infiltration, un ramollissement du sol, qui pourrait entraîner
des dégâts aux maisons ?
- en combien de temps la fosse d’infiltration serait-elle
envasée ?
- le dispositif se montrera-t-il fonctionnel et
facile d’utilisation en toute saison ?
- les utilisateurs prendront-ils facilement l’habitude
d’entretenir le dispositif en nettoyant les cuvettes de décantation ?
Ce premier bilan de l’expérience n’apporte pas
de réponse à ces questions, parce qu’on n’a pas assez de recul ; mais
il est prévu une autre évaluation, un an plus tard, en 2003.
Un
« plan stratégique d’assainissement» pour Djenné
Le Ministère de l’environnement avait confié à
un bureau d’étude la préparation d’un plan stratégique d’assainissement (PSA)
pour la ville de Djenné. Le rapport du bureau d’études, CIRA-Ingénieurs Conseils a été présenté à un atelier de validation qui s’est
tenu à Djenné les 4 et 5 janvier 2003. Les solutions proposées sont les suivantes :
1)
pour les eaux pluviales :
- un réseau de collecteurs à ciel ouvert en maçonnerie
de moellons pour les grandes rues de la ville (soit 5 km de collecteurs à
créer) ;
- rues pavées et refaçonnées pour obtenir le ruissellement
superficiel des eaux dans les petites rues de la ville (plus de 58000 m3 de
blocs de grès à tailler pour paver 14 km de ruelles) ;
- aménagement de l’ensemble des berges (pavage
en pierres naturelles), des quais et des exutoires de la ville ;
- aménagement des cours des concessions et des
cours des établissements publics pour faciliter le drainage des eaux pluviales ;
- aménagement des abords des bornes-fontaines et
des aires de lavage en vue de drainer leurs eaux vers le réseau d’égout.
2)
pour les eaux usées et les
excreta :
- installation de lavoirs pour les eaux usées de
lessive et de vaisselle dans toutes les habitations ;
- installation de latrines à deux fosses ventilées
alternantes dans toutes les habitations qui disposent de l’espace voulu ;
- installation de bassins d’interception dans les
concessions qui n’ont pas assez d’espace ;
- système « condominial » pour l’évacuation
des eaux usées ; ce système a pour caractéristique que les blocs ou groupes
de maisons se trouvant sur un même tronçon ont la responsabilité de la gestion
commune des installations qui les concernent ; ces tronçons aboutissent
à des points de rejet, au nombre de 22, sur les berges ;
- filtres bactériens et pré-filtres à flux horizontal
pour l’épuration des eaux usées sur les berges ;
- bassins de stabilisation pour la station d’épuration ;
- lits de séchage des boues ;
- latrines à deux fosses ventilées alternantes
et à cabines multiples pour les lieux publics ;
- fosses septiques avec toilettes modernes pour
les centres d’hébergement, hôtels et services.
3)
déchets solides
- pré-collecte dans les concessions et services
publics dans des poubelles métalliques ;
- collecte et évacuation vers quatre sites de transfert
à l’aide de chariots en tricycle, opération pour laquelle on compte sur la
redynamisation des associations féminines qui sont déjà intervenues dans ce
domaine dans le passé ;
- évacuation vers la décharge finale à l’aide de
camions porte-conteneurs ;
- valorisation par compostage de la composante
biodégradable des déchets.
Ce programme devrait être réalisé en répartissant
le coût entre l’investissement public et l’apport des bénéficiaires. L’investissement
colossal nécessité par l’évacuation des eaux usées (3,6 milliards FCFA)
serait à rechercher auprès de bailleurs de fonds, car il est hors de portée
de la population.
Par contre, « les coûts d’aménagement nécessaires dans les cours des
concessions pour assurer l’évacuation correcte des eaux pluviales seront à
la charge des ménages. Les enquêtes menées ont établi une prédisposition des
bénéficiaires à ce sujet » peut-on lire dans le même document.
On prévoit pourtant que le projet pourrait fournir gratuitement des dalles
et des tuyaux PVC, et que les familles pourraient emprunter 60.000 FCFA au
taux de 21 % remboursables en 2 ans, « ce qui est tout à fait supportable
par près de 95 % des ménages enquêtés ». Plus généralement, tous les frais de branchement individuel au
réseau seront à la charge des familles, car « l’idée maîtresse est d’assurer
le paiement par les usagers/bénéficiaires du service rendu ».Mais
le document, prolixe lorsqu’il s’agit de faire de grandes phrases sur la participation,
ne dit rien de plus précis sur la répartition des coûts, sauf que « la
population a démontré, lors des enquêtes, sa volonté de payer pour des services
fiables ».
Ce rapport conclut par une estimation du coût des
travaux à envisager : pas moins de 6,5 milliards FCFA. Est-ce bien raisonnable ?
Un
premier commentaire de ce projet
Le volontaire du Corps de la paix placé, auprès du service
d’assainissement de Djenné, Nathan Forsythe, surnommé Dramane Cisse,
a rédigé le commentaire ci-dessous du projet.
« Le rapport final du PSA a été rendu par le bureau CIRA-Sarl vers la fin
du mois de novembre 2002. Une première lecture révèle que les solutions retenues
penchent vers le côté sophistiqué des technologies appropriées, et que la
réalisation de ces solutions nécessiterait de très gros financements. Les
paragraphes suivants expliquent les recommandations du volontaire.
1.
Concernant la démarche générale
à adopter par le Service d’assainissement et de contrôle des pollutions et
nuisances (SACPN)
Le volontaire recommande que le SACPN entreprenne une enquête approfondie auprès
de la population de la ville, pour :
-
recenser les équipements
privés déjà présents, évaluer leur évolution probable ;
-
vérifier quantitativement la
volonté de la population de payer pour la réalisation et surtout l’entretien
des infrastructures ;
-
pour trouver un consensus parmi
la population sur un compromis équilibré entre la sophistication et la qualité
des ouvrages (représentée par leur prix unitaire) et le nombre de ceux qui
pourront être réalisés compte tenu de la disponibilité des financements.
Il est recommandé aussi, à la suite de l’enquête, de développer et d’exécuter
un programme de sensibilisation des élèves (et des autres groupes cibles pertinents)
aux comportements favorables en matière d’assainissement et d’hygiène.
Une troisième recommandation concernant la démarche générale est de développer
les capacités organisationnelles du SAPCN : le doter d’un local permanent,
l’équiper pour qu’il puisse travailler efficacement et créer un système d’information
géographique contenant les données nécessaires à la planification et à la
gestion des infrastructures d’assainissement.
2.
Concernant la gestion des eaux
pluviales
Toute décision concernant les solutions techniques et l’ordre de priorité des
réalisations, compte tenu des financements, devrait recevoir l’accord d’un
groupe représentant les différents acteurs de l’assainissement et les diverses
composantes de la communauté économique et sociale.
Cela dit, dans un premier temps, l’aménagement des voies carrossables pourrait
être prioritaire, parce qu’il pourrait sécuriser la circulation (voire diminuer
l’enclavement de la ville pendant la saison des pluies) et renforcer la capacité
des autorités à réagir en cas d’urgence. Il aurait aussi un impact sur la
première impression des touristes, et par là probablement sur l’activité économique,
favorisant des séjours plus longs.
En outre, il conviendrait sans doute de repenser les dimensions des caniveaux.
Il s’agit ici premièrement de minimiser les coûts de réalisation et d’entretien,
ainsi que leur emprise sur les espaces publics, ce qui implique de minimiser
la longueur des chemins d’écoulement et de favoriser le déversement des eaux
pluviales sur les berges en chaque point convenable ; en second lieu,
il faut se demander si l’intensité des pluies utilisée pour dimensionner les
caniveaux ne sera pas si peu fréquente qu’on s’imposerait en la conservant
des sur-coûts injustifiés en construction et en entretien.
En ce qui concerne les ruelles, il est recommandé de séparer la réalisation
des rigoles centrales et celle des trottoirs qui les bordent. L’extension
du système des rigoles est prioritaire car elle réduirait fortement la stagnation
des eaux à l’intérieur de la ville, et diminuerait aussi l’effet néfaste des
eaux pluviales sur les trottoirs non aménagés ; la mise en état des trottoirs
ne présente par le même caractère. Or l’aménagement des ruelles présente une
excellente opportunité pour instaurer une approche participative de l’aménagement
de la ville. Impliquer la population de chaque quartier dans la planification
et l’ordre de réalisation des aménagements, dans leur financement et dans
leur entretien renforcera la prise de conscience des avantages et des besoins
en infrastructures ; elle renforcera aussi la capacité locale d’action
communautaire.
En ce qui concerne les berges, le coût astronomique du devis estimatif pour
les travaux proposés et le fait que les principaux bénéficiaires en seront
les touristes, conduisent à recommander que le financement de ces travaux
soit recherché à part de celui du reste du projet.
3.
Concernant la gestion des eaux
usées
Sur ce point, il est essentiel de considérer la complémentarité des équipements.
Les problèmes actuels viennent de ce que l’équipement public d’évacuation
des eaux usées n’a pas tenu le rythme de l’équipement public d’adduction d’eau.
Pour l’avenir, s’il y a donc un retard à rattraper, il faut aussi prendre
le temps de vérifier que les ouvrages envisagés pour l’évacuation des eaux
usées sont véritablement justifiés par les activités et équipements qui génèrent
des eaux usées. L’hypothèse du volontaire est que même si les branchements
privés vont se multiplier dans les années qui viennent, ils risquent de se
limiter à un robinet au milieu de la cour, avec des équipements domestiques
restant « traditionnels » (latrines simples, aires de lavage au
milieu de la concession ou de la rue…). Cette hypothèse est à vérifier, et
on ne peut le faire que par une enquête directe auprès de la population : cette
enquête a donc une importance prépondérante.
Si cette hypothèse se confirmait, le volontaire recommanderait un système mixte,
où les eaux « grises » (eaux de lavage, vaisselle et bain) seraient
évacuées par des rigoles à ciel ouvert, servant aussi à l’évacuation des eaux
pluviales, vers des dispositifs locaux de traitement (probablement :
un ou des décanteurs, un lit bactérien et un puisard). Dans ce cas, en effet,
les bassins d’interception et les conduites enterrées recommandées par le
PSA ne seraient pas appropriés à la situation réelle de Djenné. Quoi qu’il
en soit, les recherches de financement concernant les rigoles et les dispositifs
locaux de traitement devraient être regoupées.
Pour les excreta, il est recommandé que la vidange des latrines soit confiée
à un ou des GIE à vocation d’assainissement. Il faudra sans doute envisager
à long terme la construction d’une station d’épuration des boues, sauf si
une station édifiée à Mopti ou Sévaré ou San –et des coûts de transport faibles–
la concurrençaient. Pour cette raison, la recherche de financement pour une
station d’épuration doit être traitée à part de celle qui concerne les autres
équipements.
4.
Concernant les déchets solides
L’initiative prise en décembre 2002 par le Préfet, qui a mis en œuvre un « plan
d’action citoyen pour l’assainissement de la ville de Djenné » est très
importante à cet égard. L’un de ses aspects les plus judicieux est l’idée
que les quartiers concluent des contrats de prestation avec des GIE pour le
balayage des ruelles et la collecte des déchets ; que les commerçants
passent contrat avec des associations féminines pour le balayage des marchés
et des places publiques, ou encore que la mairie s’entende avec des GIE pour
l’évacuation vers une décharge finale des déchets ramassés. Cependant, ces
contrats ne pourront être exécutés que si les autorités imposent et suivent
le recouvrement de la cotisation de 100 FCFA par mois et par famille, ce qui
représente une recette d’environ 200.000 FCFA par mois, à répartir entre les
GIE (le prix des services des associations féminines étant à négocier entre
elles et les commerçants).
Sur ce point, le volontaire recommande la réalisation des quatre dépôts de transit
et de la décharge finale qui sont prévus dans le PSA. Mais leur dimensionnement,
et le devis estimatif prévu pour cette réalisation dans le PSA, sont à revoir.
La réduction du volume des déchets par compostage des matières organiques,
par recyclage des matières synthétiques, et surtout par réutilisation, permet
de diminuer la dimension des ouvrages, donc leur coût de construction et leur
coût d’entretien.
Il est recommandé de séparer la recherche de financement pour les dépôts de
transit et celle qui concernera la décharge finale. Les premiers peuvent être
le support d’une activité participative, la dernière est un ouvrage important
pour lequel un bailleur de fonds doit être sollicité. L’éventuel financement
des poubelles et leur répartition entre les quartiers sont aussi des questions
favorisant une approche participative.
5.
Concernant la gestion des ouvrages
Tout au long de la démarche de planification et de réalisation des infrastructures,
il faudra rester conscient des limites de la volonté de payer (VDP) de la
population pour la réalisation et surtout pour l’entretien des infrastructures
d’assainissement. Cette volonté sera appréciée lors de l’enquête auprès de
la population, mais les infrastructures planifiées doivent être limitées pour
que les coûts de leur exploitation et de leur entretien soient inférieurs
ou égaux à la VDP.
Nathan
Forsythe, dit Dramane Cisse
Crépir
ou revêtir les façades de briques cuites ?
Il semblerait que l’administration commence à évoluer :
au moment de remettre en état la maison du sous-préfet, elle a choisi de la
recrépir, et pour cela de supprimer le revêtement de briques cuites qui y
avait été posé il y a quelques années. On sait que ce type de revêtement ne
constitue pas une solution satisfaisante, parce que, outre son coût supérieur
à celui du crépissage, l’eau s’infiltre derrière les briques et créée des
dommages qui peuvent rester inapparents tant qu’ils ne sont pas très graves ;
souvent, il est alors trop tard pour intervenir. Mais les propriétaires, mal
informés,
croient faire une bonne opération qui leur évitera quelques simples crépissages !
Lutte
contre le trafic de biens culturels
18 statuettes sorties illégalement du Mali ont été restituées
en novembre 2002, après une longue procédure judiciaire en France, où elles
avaient été exportées illégalement. Un lot de 16 statuettes des 13ème-15ème
siècle, provenant du delta intérieur du Niger, avaient en effet été saisies
en 1996 par les douanes françaises. Elles ont été restituées au Musée National
du Mali, qui enrichit donc ses collections d’objets sans valeur archéologique.
Deux statuettes volées il y a quelques années dans le village dogon de Néni
ont également rejoint le Mali, après qu’une plainte ait été déposée à la Mission
culturelle de Bandiagara par les villageois ; elles auraient été retrouvées
chez un antiquaire parisien à la suite d’une enquête menée par un journaliste
belge, Michel Brent, et la chaîne de télévision France2.
Pour en savoir plus sur le problème général, voir Cristiana
Panella : « Les terres cuites de la discorde : déterrement
et écoulement des terres cuites anthropomorphes du Mali, les réseaux locaux »,
Research School of Asian, African and Amerindian Studies, Universiteit Leiden,
The Netherlands, 2002, 236 p.
Réunion
du comité scientifique du projet de restauration et de conservation de l’architecture
de Djenné (27 janvier 2003)
Ce
projet a été lancé en 1996 grâce au financement apporté par le Royaume des
Pays-Bas. Sa gestion a été l’activité essentielle de la Mission Culturelle.
La supervision a été assurée par un comité dans lequel Rogier Bedaux et Pierre
Maas ont joué un rôle essentiel, dont ils doivent être remerciés. Une équipe
locale du projet a été constituée, mais sa composition a changé au cours du
temps. Dans une première phase, l’architecte Sébastien Diallo s’est établi
à Djenné pour suivre les travaux ; dans une seconde étape, cette surveillance
a été confiée à un cabinet d’architectes de Mopti, qui a délégué un technicien.
Une
nouvelle fois, le comité scientifique a constaté que le programme était en
retard par rapport à ses prévisions : « des chantiers traînent depuis
des années », et par exemple, au début 2003, toutes les maisons qui étaient
au programme des années 2001 et 2000 ne sont pas terminées. Les raisons invoquées
dans le rapport sont « l’attitude négative de certains maçons, qui n’honorent
pas régulièrement leurs engagements », d’une part, et « l’indifférence
des propriétaires des maisons » d’autre part. C’est pour cette dernière
raison qu’il avait été décidé d’ouvrir le comité de pilotage aux propriétaires
de maisons, mais le résultat n’est apparemment pas convaincant. Naturellement,
la Mission culturelle a aussi évoqué les retards des virements bancaires.
La
qualité des travaux réalisés pose aussi problème. « Des constructions
qui n’ont qu’une année commencent à présenter des fissures ; des décorations
ayant subi l’épreuve d’une seule saison des pluies sont toutes parties » :
même si les maçons ont raison de dire qu’il faut crépir plusieurs fois pour
obtenir un crépi solide, les habitants de Djenné savent tous que la qualité
du travail sur les chantiers de la Mission culturelle n’est pas ce qu’on attendait.
On devait obtenir la meilleure qualité, on en est loin ! Le prix décerné
au maçon de l’année (50.000 FCFA) ne suffit manifestement pas à entraîner
l’adhésion enthousiaste de la profession ! On en est d’ailleurs à donner
des ordres aux maçons, dans le bureau du préfet et en présence du chef de
village ! De même, l’introduction d’un minimum de transparence dans les
opérations (depuis 2002, chaque propriétaire sait quelles sommes sont versées
au maçon pour faire les travaux convenus) ne suffit pas à obtenir que les
propriétaires s’approprient le projet, qui reste une affaire de la bureaucratie
nationale appuyée par des étrangers. Les taux de refus sont très importants :
sur 19 maisons initialement programmées en 2002, 9 ont fait l’objet de refus !
La Mission culturelle a été amenée à réhabiliter des maisons qui n’étaient
pas sur la liste dite « des réserves », et même à intervenir sur
les bâtiments de l’OPAM qui, construits dans les années 1970, ne sont aucunement un témoignage
de l’architecture originale de Djenné !
Il faut rappeler que l’objectif du projet, tel qu’il
a été présenté dans les documents spécialisés, était de restaurer 176 maisons
identifiées lors du recensement réalisé en 1995 par l’équipe hollandaise. Cet objectif a été ramené à 100 maisons au motif que, lors du
lancement effectif du projet, 30 maisons avaient disparu et que 34 autres
avaient été construites sur des places nouvelles. Aujourd’hui, à quelques
mois du terme du projet, 92 maisons ont fait l’objet d’une intervention. Et
le financement hollandais de 350 millions FCFA –ce qui n’est tout de même
pas rien ! – est pratiquement épuisé. En outre, tous ceux qui pensaient
que l’opération permettrait de retrouver les techniques traditionnelles et
d’en revivifier l’emploi, tous sont déçus : aucun effort n’a été fait
pour retrouver la technique de construction en djenne ferey ou la composition
des meilleurs revêtements de façade, aucun effort pour retrouver les modèles
de claustra en terre cuite, aucun effort pour retrouver la meilleure qualité
dans le travail des menuisiers et dans la protection des portes et fenêtres
(pour ces dernières, on a employé les peintures du commerce, et on a choisi
des couleurs à la mode à la place de la seule couleur traditionnelle rouge
brique obtenue à partir de la latérite).
C’est ainsi que, au cours de la discussion, le représentant
de DJENNE PATRIMOINE a été amené à rappeler que, si aucun maçon vivant aujourd’hui
à Djenné n’a jamais construit lui-même une maison en djenne ferey,
des éléments de savoir-faire sont encore disponibles ; et ils ont été
utilisés au cours d’un chantier–école, pendant un mois, dans le quartier de
Djoboro, courant 2002 : une entrée de concession, sifa (ou bolon),
a été édifiée et le chantier a reçu beaucoup de visiteurs. C’est aussi dans
un cadre privé que les motifs des claustra anciennes ont pu être retrouvés
par la potière Mme Badji Samassekou.
Le
souci exprimé en diverses occasions concernant l’appropriation du projet par
les chefs de famille et par les représentants élus de la population locale
a été perçu et exprimé, à l’occasion de cette réunion du comité scientifique
et par le Directeur National du Patrimoine et par le Directeur Général de
l’Institut des Sciences Humaines. La gestion du projet a été caractérisée
par une pratique bureaucratique éprouvée, où les services centraux s’appuient
sur le chef de village et quelques notables, qu’on intéresse personnellement
à l’affaire, avant que les décisions ne soient imposées de façon autoritaire
aux populations.
Pour l’avenir, il paraît très important de modifier ces
pratiques. Dans un pays qui s’est engagé avec détermination dans la voie de
la décentralisation, la présence au niveau local de fonctionnaires centraux
disposant de moyens –fournis par l’aide extérieure– considérables par rapport
à ceux des collectivités territoriales est un anachronisme. Ce sont ces dernières
qui doivent être responsabilisées et qui doivent gérer les ressources humaines
et financières que l’Etat obtient pour leur permettre de réaliser des tâches
d’intérêt national, par exemple la conservation du patrimoine. De même, les
ressources humaines consacrées par l’Etat à ces tâches doivent être placées
sous la direction des collectivités concernées. En matière de patrimoine,
le cas est particulièrement net : si tout, les décisions, les financements,
les personnels, vient de la capitale, sans que les collectivités territoriales
soient investies de responsabilités et de pouvoir de décision, ces collectivités
sont à proprement parler dépossédées de leur patrimoine.
Cette question pourrait avoir une application très concrète.
Le comité scientifique s’est préoccupé de la façon dont les chantiers de réhabilitation
ont été documentés. On lui a répondu que l’état des maisons avant les travaux
a été documenté. La mission d’évaluation présente à Djenné du 20 au 27 janvier
a constaté que, par contre, les travaux de réhabilitation eux-mêmes n’ont
pas été documentés : il manque dans les dossiers le plan de restauration
et le plan de restitution. Or, la protection du patrimoine architectural de
Djenné exige que la mairie, qui donne les autorisation de construire et par
là joue théoriquement un rôle essentiel, dispose de toute la documentation
et de toutes les compétences qui peuvent lui permettre de remplir cette fonction.
Les archives du projet ne doivent pas rester aux Pays-Bas ou à Mopti, en un
seul exemplaire, dans des cabinets d’architecte, elles doivent être déposées
à Djenné même pour servir de base de travail à la mairie.
Dans le même esprit, qui est de responsabiliser la collectivité
territoriale et la population, on se demandera combien ont pu coûter les nombreuses
missions dépêchées depuis Bamako pour expliquer à la mairie de Djenné que
les administrations centrales sont défavorables à la taxe touristique créée
par la commune ! Le patrimoine de Djenné appartient à l’humanité toute
entière, oui, et nous en sommes fiers, mais il appartient aussi aux habitants
de Djenné qui doivent en vivre si l’on veut que ce patrimoine soit durablement
conservé ! La taxe touristique n’est certes pas le meilleur moyen de
faire contribuer les visiteurs à l’entretien et à la promotion du site, mais
les habitants de Djenné, et leurs édiles, sont mieux placés que quiconque
pour s’en rendre compte et pour imaginer une alternative. Le comité scientifique
a bien remarqué que la mairie pourrait contribuer d’une façon significative
au coût de l’entretien, dans le futur, des maisons réhabilitées ces dernières
années, encore faut-il que l’administration bamakoise ne vienne pas, sous
quelque prétexte que ce soit, priver la commune de toute ressource propre.
D’ailleurs,
il faut bien admettre que, si l’on ose parler aujourd’hui de revoir le classement
de Djenné, c’est que la critique du classement en bloc des « villes anciennes
de Djenné » est venue de Djenné même, alors que les services centraux
invitaient avec commisération les habitants de Djenné à ne pas sortir du domaine
de leurs compétences. Le représentant de DJENNE PATRIMOINE a tenu à le souligner,
et à rappeler que cette association a publié des propositions précises à ce
sujet.
Amadou
Tahirou Bah, Joseph Brunet-Jailly
Djenné
au Folklife Festival
Trois
maçons de Djenné sont d’ores et déjà invités à participer au Folklife Festival
qui est organisé à Washington, aux Etats-Unis, du 25 juin au 4 juillet 2003 :
Boubacar Kouroumansé, dit Bayéré, Béré Yonou et Kombaba Tanapo. Ils doivent
y construire une maison en employant les techniques en usage à Djenné !
Asmane Traore sera aussi présent, avec ses broderies ! Le Mali est l’hôte
d’honneur de ce festival, qui a été préparé par un mini-festival à Bamako
du 3 au 5 février.
A
Washington, le public américain pourra entendre une conférence du Professeur
Roderick J. McIntosh sur le thème « Là ou l’Afrique urbaine a commencé :
le patrimoine historique du Mali », ce qui sera l’occasion de présenter
les fouilles réalisées à Djenné depuis vingt ans. Ensuite, M. Robert Maxwell,
ancien ambassadeur des Etats-Unis au Mali, parlera du sujet « le Mali
d’aujourd’hui ». Puis Mary Jo Arnoldi et Pat McNaughton, deux anthropologues
bien connus, la première pour ses travaux sur le théâtre de marionnettes de
la région de Ségou, le second pour ses études du komo et ensuite des
forgerons, traiteront de « Deux aspects de l’art bamanan ».
Les sites touristiques du Mali seront ensuite présentés par l’ambassadeur
Pringle, l’ancienne directrice du Peace Corp à Bamako. Des pages publicitaires
devraient d’ailleurs paraître dans des magazines américains, tels que le Conde
Nast Traveler ou le National Geographic.
Madame
Zakiatou Wallet Halatine, ancien ministre de l’artisanat et du tourisme, est
chargée de piloter la préparation de la participation du Mali à cette manifestation.
Cette réunion a été l’occasion pour le bureau de
présenter ses excuses à toutes les personnes qui avaient envisagé de venir
à Djenné pour participer aux festivités que l’association voulait organiser
en leur honneur selon le programme publié en juillet 2002. La sécheresse qui
a sévi dans toutes les localités qu’on se proposait de visiter a été telle
qu’il était impossible d’organiser des réjouissances cette année. Le bureau
espère que la prochaine récolte sera meilleure et donc il se prépare d’ores
et déjà à proposer un nouveau programme pour le début janvier 2004.
Le bureau a également pris quelques décisions,
notamment les suivantes :
-
fixer
une périodicité à ses réunions ordinaires ;
-
convoquer
prochainement une assemblée générale ;
-
préparer
le prochain numéro du bulletin de l’association ;
-
programmer
les émissions en langues locales (notamment fulfuldé, bambara, sonraï, bozo)
sur Radio-Jamana, afin de mieux faire connaître, par une émission hebdomadaire,
les informations et positions de l’association
_____________________________________________________________
DOCUMENT 1
La
pirogue, monture du bozo, hier et aujourd’hui
Quel que soit son type, la pirogue est au cœur de la civilisation
de cette vaste plaine d’inondation qu’est le delta intérieur du Niger. Elle
est un moyen de transport, de communication ainsi qu’un facteur de production
pour les activités de pêche et d’agriculture. A ce rôle économique s’ajoute
une dimension culturelle : en tant que support de manifestations symboliques
au travers des courses de pirogues, elle occupe une place centrale dans les
sociétés de pécheurs.
*
* *
Dans le delta du Niger, selon la légende, la première pirogue aurait été construite
au moment du déluge par les 300 djinns qui travaillaient pour le prophète
de Misira (Egypte) dénommé Anabî Nouhoum (Ligers, 1969:12-13) : ce dernier
aurait été averti en rêve de l’imminence du déluge et aurait convaincu le
chef des djinns de lui construire une immense arche, pour laquelle il ne fallut
pas moins de 1707 arbres. Ce déluge n’est pas très précisément situé dans
le temps, on s’en doute ! Par contre, le mystère qui entoure l’apparition
de la pirogue prend des formes multiples : ici, c’est le chasseur légendaire
Mama Pamanta, originaire de Bangu sur le Lac Débo, qui, un beau jour, ayant
réussi à se défaire de deux serpents très dangereux, hérite de leur pirogue,
qui n’était autre qu’un python, et un python obéissant à la voie humaine !
(Ligers, 1969:53). Là, on nous parle d’une pirogue en or, appartenant à une
divinité d’eau nommé Maïma (djîdjo Maïma), habitant précisément en
face de Savna (Sahouna), et volée par les djinns, qui l’ont cachée longtemps
dans un trou d’eau de la mare située à Saba (Pora) ; pour la retrouver,
Maïma n’a pu que recourir au célèbre danseur et devin Kamani, de Godâ, dont
le père Godâ Dua (le vautour égyptien de Godâ, c’est donc un
surnom) était lui-même très célèbre ! Kamani parviendra à vaincre tous
les dangers de l’entreprise, notamment cette terrible antilope aux 1200 cornes,
au milieu desquelles se trouve un four portatif en terre cuite, où brûle un
feu ardent surmonté d’un canari, en terre cuite lui aussi, fermé par un couvercle !
Et, lorsqu’il aura retrouvé la pirogue en or, la divinité d’eau la lui donnera !
(Ligers, 1969:67-70)
Ce qui est très probable, c’est que les premiers habitants
du delta –ou bien ceux des abords de cette ancienne cuvette terminale du Niger,
au nord de Tombouctou et du lac Faguibine, dénommée Tûfâna, que les Sorko
considèrent comme une ancienne mer où vivait leur ancêtre Auvadja Bunnâhi
(Ligers, 1969:15)– ont su très tôt construire et utiliser des nacelles en
jonc, en roseau, en herbe, en paille. On peut penser que ces moyens de transport,
si primitifs qu’ils puissent paraître, se sont imposés dès que les premiers
habitants ont quitté les abris souterrains qu’ils occupaient (la légende veut
d’ailleurs que les bozos proviennent tous de deux importantes demeures souterraines,
le trou de Dia Kolo et celui de Wotaka, cf. Malzy, 1956:102) pour vivre en
plein air dans des campements ou des villages : avec ces embarcations,
on peut fuir sur l’eau et dominer l’adversaire (Ligers, 1969:95). Ce qui est
sûr aussi, c’est que le territoire occupé par les Sorko est jonché d’outils
préhistoriques (grandes haches, haches à tranchant recourbé, petites haches
et coins, étroits ciseaux en pierre permettant de creuser les trous pour coudre
les planches les unes aux autres, rabots…) qui pouvaient servir à la construction
de pirogues (Ligers, 1969:1) ; et que les bozos se disent autochtones,
premiers occupants de ces immenses zones marécageuses. Enfin, l’existence
des pirogues est attestée dans le Soudan occidental depuis le haut Moyen-Age,
sans qu’il soit possible d’affirmer avec certitude si elles sont issues d’un
emprunt extérieur ou le fruit d’une invention locale.
Par la suite, pour obtenir une plus grande solidité, les techniques de construction
évolueront vers la pirogue monoxyle, puis vers la pirogue cousue, pour aboutir
à l’actuelle pirogue clouée. Mais les techniques nouvelles n’ont pas immédiatement
chassé les anciennes : la pirogue tressée en roseaux était encore utilisée
il y a quelques générations seulement pour la chasse à l’hippopotame (Ligers,
1969:46). A Mopti, un jour de marché, au milieu des années 1950, on trouve
à la fois des pirogues en planches clouées pour le transport, avec ou sans
couture médiane, des pirogues monoxyles pour la pêche, des pirogues en fer,
et même quelques ancienne pirogues cousues (Ligers, 1969:130), qu’on dit désormais
« de Niafunké » (Malzy, 1946:119).
De construction simple (un tronc d’arbre évidé et grossièrement ouvragé), la
pirogue monoxyle pourrait être contemporaine de la période d’installation
des bozos dans le delta, et elle aurait été répandue dans toute l’Afrique
de l’Ouest. Au XIXème siècle, elle était encore utilisée pour la pêche et
la traversée des cours d’eau : René Caillié raconte les péripéties d’une
telle traversée (Caillié, 1979, I :338). L’appellation retenue par les
anciens, dans les années 1980, pour la désigner, fofo-kin, pirogue
des fofo, pirogues des pêcheurs du Nigéria, rappelle que ces derniers,
dans les années 1960, les utilisaient encore lorsqu’ils venaient pour des
campagnes de pêche dans le delta. Cette pirogue est taillée dans un bois tendre
(fromager, baobab, kapokier), elle est donc fragile et sa durée de vie est
limitée.
L’avènement de la pirogue cousue permet et signale l’intensification des échanges
marchands au Soudan sous l’impulsion des Etats médiévaux. Là, il est possible
d’assembler des planches de bois dur, et l’on y emploie donc par exemple le
caïlcédrat Khaya senegalensis, le vaine Pterocarpus erinaceus,
et, dans les aires post-lacustres, le palmier doum Hyphaene thebaica.
Grâce à ce perfectionnement, les empires du Ghana, du Mali et du Songhay firent
du fleuve Niger et de ses affluents le principal axe du commerce de longue
distance, grâce à la constitution d’une flotte de gros tonnage (debe kin)
et à la spécialisation dans le métier de batelier d’anciens groupes dominés
sous le statut de Somono. La pirogue est ainsi à la base de l’essor des places
commerciales de Djenné et Tombouctou, situées au carrefour du sel, de la kola,
de l’or, des vivres et des esclaves. Les grands armateurs, ainsi que les souverains,
pour leurs besoins d’intendance, ont été les promoteurs de ce développement
de la navigation. Le nombre élevé des pirogues et leur capacité de jauge leur
permirent de jouer un rôle économique de premier plan jusqu’à l’apparition
de la marine marchande coloniale (Monteil 1932, Caillié 1830, Caron 1881).
Ainsi, Djibril Tamsir Ndiaye écrit à propos du règne des Askia : « les
plus grosses fortunes de Djenné et de Tombouctou étaient fondées sur le trafic
fluvial du Niger et sur le commerce avec le Bitou, pays aurifère. Les propriétaires
des barques étaient établis à Djenné, ils étaient malinkés ou sarakollés pour
la plupart. D’importants marchés s’étaient développés le long du fleuve, dont
Dia, Sinsani et Saraféré, et grâce à la commodité des transports par voie
d’eau, était apparue une certaine spécialisation régionale de la production :
viande et produits laitiers du Macina, coton et cotonnades de Dia, poisson
sec et fumé d’Issa-ka et de Djenné. » (Niane, 1975:177) L’auteur affirme
que tout armateur de Djenné qui possédait plus de cinq barques sur le fleuve
entrait dans le groupe des dji-tigui, ou « grand maître de l’eau »,
et que ces mêmes armateurs envoyaient aussi des caravanes sur les pistes
du sud.
Malgré leurs inconvénients (lenteur, lourdeur, étanchéïté toute relative, conduite
difficile en l’absence de gouvernail…) des embarcations de grande taille étaient
utilisées pour relier Djenné à Tombouctou, et elles étaient démontées pendant
la saison sèche. Là encore, le témoignage de Caillié est intéressant :
lors de son second voyage, il a emprunté une pirogue de 90 à 100 pieds de
long, 12 à 14 de large en son milieu, 6 à 7 de cale, qui pouvait jauger 60
à 80 tonneaux, et il s’étonne de sa résistance en décomptant son chargement ;
il fallait 16 à 18 hommes, dont des écopeurs se relayant sans cesse, pour
manœuvrer de telles embarcations. En 1891, le lieutenant de vaisseau Caron
voyageant à Tombouctou remarque des pirogues atteignant parfois 20 m de long
sur 5 m de large, avec environ 1 m de cale, pouvant transporter plus de 200
personnes en sus des marchandises (Caron, 1891:228). Au début du XXème siècle,
toutefois, le tonnage diminue nettement : Monteil ne trouve que des barques
d’un tonnage d’environ 6 tonnes, et Dupuis-Yacouba en 1921 des embarcations
de 4 tonnes.
Les équipages étaient composés de somono. Il s’agit là d’un groupe socio-professionnel
qui n’a pas de langue propre, et qui a été composé au fil du temps par l’adjonction
d’individus d’origines diverses par les souverains médiévaux du Soudan. Les
premiers bateliers comprenaient aussi des bozos et des sorkos (ces derniers
sont des pêcheurs parlant la langue songhay), asservis et devenus somono par
la force des choses. Pour René Caillié « les hommes libres croiraient
se dégrader en se livrant à ce métier » (Caillié, 1979 :174). Le
statut social des somono est donc différent de celui des bozo de statut libre
(horon), même si certains parmi ces derniers ont été réduits en esclavage
et affectés à la batellerie.
La date d’apparition de la pirogue clouée (kango) n’est pas connue avec
précision, mais elle pourrait se situer au milieu du XIXème siècle. C’est
très tard, puisque Djenné importait du fer depuis des siècles : mais
nul ne peut dire aujourd’hui pourquoi le fer n’a pas été employé dans la construction
des pirogues jusqu’à cette époque très récente. Mage a remarqué des pirogues
clouées à Niamina en 1864 (Mage, 1980:80-81), mais Caillié n’en voit aucune
à Djenné en 1828. Monteil attribue la construction de la première pirogue
clouée à un bozo de Pora-bozo, au sud du delta, et d’après nos propres informations,
ce serait dans les années 40 à 50 du XIXème siècle. De là, elle se propage
dans toute la région à partir de Djenné (d’où l’appellation Djenne kurun
ou kangué, pirogue de Djenné, en bamanan) ; Mopti, Nouh, Dioro,
Konadaga, assureront plus tard le relais. Sa diffusion affecte tous les secteurs
de la vie économique, non seulement dans le delta, mais aussi partout au Mali
et même dans les pays voisins. Les clous en fer, aujourd’hui encore forgés
à l’unité à partir de métal de récupération, se sont substitués aux cordes
en fibres végétales qui servaient à assembler les planches, même si les flancs
sont encore souvent ornés en leur milieu d’un assemblage de cordes qui renforce
la souplesse de l’embarcation. Plus récemment, l’emploi de planches sciées
et de cordes en fibres synthétiques ont permis d’aboutir à des formes plus
aquadynamiques et à une plus grande sécurité. La pirogue s’est aussi
adaptée à la motorisation en adoptant les cornières métalliques, et en s’équipant
d’un gouvernail. Ainsi, elle a pu accroître considérablement ses dimensions
et devenir la longue et large pinasse omniprésente dans les ports. Aujourd’hui,
les pinasses (pirogues motorisées) sont complètement clouées, ce qui les rend
plus étanches et plus rigides, mais malheureusement plus vulnérables en cas
de choc.
Au milieu du XXème siècle, le choix du bois a encore toute son importance. A
la fois parce qu’on sait qu’une pirogue faite en planches de caïlcédrat Khaya
senegalensis pourrait atteindre une durée de vie de vingt ans, et celle
en planches de tamarinier trois ou quatre ans seulement (mais encore deux
fois plus qu’une pirogue en bois de qualité inférieure) ; et parce qu’on
sait en outre que le bois d’ébène Diospyros mespiliformis ou encore
le Mystragyna inermis fournissent aussi de bonnes planches, bien meilleures
que celles qui proviendraient d’un baobab Adansonia digitata, d’un
rônier Borassus flabellifer ou d’un Acacia albida, ces dernières
étant encore supérieures à celles qui proviendraient d’un fromager, ou d’un
ficus, d’après Ligers (1969:99-100). Mais encore et surtout parce que, dans
l’esprit des constructeurs de pirogues, à Nouh par exemple (il s’agit bien
du Nouhoun-bozo des cartes IGN), qui en est un centre renommé, le principal,
–d’après ce qu’en rapporte le même Ligers–, c’est de choisir un bon bois.
Si l’arbre coupé a appartenu à un méchant djinn, la pirogue construite avec
ses planches ne sera pas excellente et le propriétaire de cette embarcation
sera toujours poursuivi par la guigne : il faudrait alors la vendre pour
en acheter une autre ; au contraire, si l’on tombe sur un arbre qui a
un bon djinn, le bateau rapportera beaucoup d’argent à son propriétaire.
Et pourtant l’innovation continue sous nos yeux. Du fait de
l’évolution du marché du bois, on expérimente avec de nouvelles essences.
En effet, pendant longtemps, le bois utilisé était de provenance locale, Dioro
étant la zône d’approvisionnement privilégiée. Puis on a eu recours à l’importation,
depuis la Côte d’Ivoire et le Ghana notamment. Maintenant les constructeurs
traitent le plus souvent avec les scieries de Bamako (qui s’approvisionnent
elles-mêmes à Kangaba, Kolokani, Dioïla, Bougouni, Sikasso) ou avec des
grossistes qui achètent à Bamako ou importent pour revendre dans la région
de Mopti. Les scieries n’ayant aucun stock, il faut venir passer sa commande
et attendre qu’elle soit prête. Comme les scieries offrent des planches d’épaisseur
et de taille variées, on a pu obtenir un accroissement (jusqu’à un doublement)
de la charge utile des pirogues, tout en réduisant leur tirant d’eau, ce qui
leur permet d’accéder à des eaux moins profondes.
On expérimente aussi en ce qui concerne les produits assurant l’étanchéïté :
traditionnellement, on utilisait le beurre de karité, mélangé à du charbon
ou à d’autres matières calcinées (pour obtenir la couleur noire) ou le fruit
de baobab ou de kapokier ; désormais on utilise très couramment l’huile
de vidange, beaucoup moins chère, bien que le résultat obtenu soit médiocre,
et que l’opération doive donc être renouvelée deux fois l’an.
Cependant, l’outillage des constructeurs reste extrêmement sommaire : l’outil
essentiel est l’herminette (deselan) qui sert à toutes les tailles
et découpes, mais on trouve aussi des marteaux, scies, rabots, soufflets,
tenailles, poinçons, limes, très rarement des chignoles ou des étaux.
La taille des pirogues est évaluée, selon les endroits, en pieds, en mètres,
en tonnes de bois nécessaires à la construction ou en charge utile. Mais la
mesure la plus utilisée est la largeur en pieds de l’embarcation en son milieu,
car la longueur et le tonnage en dépendent. Les pirogues les plus petites,
utilisées pour la pêche ou l’agriculture mesurent entre deux pieds et deux
pieds et demi de large, ce qui permet une longueur de 5 à 8 mètres et une
charge utile de 1 à 1,5 tonne. Les pirogues de course et celles qui servent
au commerce ont entre trois et six pieds de large, ce qui correspond à des
longueurs allant de 10 à 25 m. Les pinasses peuvent atteindre 13 pieds de
large, 50 m de longueur et une charge utile de 150 à 180 tonnes.
Le nombre de ces embarcations utilisées dans le delta est
considérable : probablement 20.000 à 25.000 pirogues seraient employées
par les pêcheurs, 1.000 à 1.500 serviraient au commerce (une centaine de pirogues
de commerce est construite chaque année sur l’ensemble du delta, et la durée
de vie est estimée à une dizaine d’années), et 75 pinasses de grande taille
ont été recensées entre Tombouctou et Ké-Macina. Les plus grosses naviguent
entre Mopti et Ké-Macina, les autres entre Mopti et Tombouctou ; le plus
souvent, elles sont la propriété du pinassier. Les marchandises ont priorité
sur les passagers : au départ de Mopti, elles emportent des produits
de consommation courante, au retour elles apportent du poisson, des nattes,
du sel (si elles viennent de Tombouctou), du bois (si elles viennent de Youwarou,
Saréyamou, Attara). Le voyage aller-retour dure quatre à huit jours, à quoi
s’ajoutent un à quatre jours à quai.
La pirogue est donc le symbole du transport fluvial, comme le chameau est le
vaisseau du désert. Sa construction représente un grand savoir-faire technique,
dont une partie reste secrète, mais elle n’est pas l’apanage d’une ethnie.
Ainsi, au début du XXème siècle, la construction des kango à Djenné
employait des clous fabriqués par les forgerons, des charpentiers (kullé,
caste d’artisans) pour la fabrication de la proue, alors que les Bozos s’occupaient
de tout le reste de l’ouvrage. Aujourd’hui, l’apprentissage est libre, mais
les Bozo exercent une suprématie de fait sur le métier.
*
* *
Cependant, les croyances jouent un rôle encore plus essentiel dans la construction
des pirogues de course. Naturellement, ces pirogues ont une forme particulière,
leur proue est au raz de l’eau, leur longueur est double de la normale, entre
20 et parfois 30 mètres, mais leur largeur bien plus réduite, et elles ont
un faible tirant d’eau, les flancs ne peuvent donc pas avoir la forme généreusement
galbée qu’ils prennent d’ordinaire, et ils doivent être joints par des baux
–barres d’espacement transversales– très nombreux, de vingt à trente (ils
ne sont distants l’un de l’autre que d’une coudée et un empan, soit environ
70 cm). Elles peuvent emporter jusqu’à 40 rameurs, mais le plus souvent une
trentaine. Selon Boucadary Kwanta, doyen d’une des plus anciennes familles
de constructeurs de Nouh, ces pirogues sont faites de matériaux spéciaux :
on y emploie volontiers le caïlcédrat, considéré comme très résistant, mais
difficile à travailler, et on évite absolument le konomou (bozo) ou
sounsoun (bambara), c’est-à-dire Diospyros mespiliformis, le
bois d’ébène, qui porterait malchance.
La course de pirogues engage certes les capacités des rameurs, mais plus encore
les qualités occultes de l’embarcation elle-même. C’est une compétition, dans
laquelle l’effort des rameurs n’est rien sans la science occulte qui est mise
à contribution pendant la construction de la pirogue, les préparatifs de la
course et son déroulement. La victoire démontre la puissance occulte (dalilu)
impulsée dans l’embarcation, la compétition n’étant quant à elle perçue que
comme la manifestation de cette puissance. En ce sens, la course apparaît
comme l’affrontement de puissances occultes dont la plus forte commande à
la victoire, les rameurs ne faisant qu’office de figurants. Pour cette raison,
la construction de la pirogue est entourée du plus grand secret, le territoire
où elle est entreposée est soigneusement protégé, les eaux où la compétition
se déroulera sont surveillées, l’entraînement des rameurs est l’objet de la
plus grande attention et reste en grande partie secret, leur purification
avant la compétition est considérée comme essentielle et réalisée avec les
soins les plus vigilants, toutes les protections sollicitées en ces occasions
exigeant d’ailleurs un grand nombre de sacrifices (béliers blancs, kolas,
lait, etc.).
Bien sûr, un véritable maître artisan sait d’un simple coup d’œil détecter les
défauts d’une pirogue et évaluer son volume exact. Aujourd’hui, les artisans
sont conscients de la valeur de leur savoir-faire, de leur donniya.
Mais les plus superstitieux, s’ils aperçoivent un maître constructeur, auront
le souci de désarmer sa puissance maléfique, et pour cela l’aborderont en
lui disant : « cher maître, voici ton travail, Dieu fasse qu’il
aboutisse !». S’ils ne procédaient pas de la sorte, ils craindraient
que ce maître ne « travaille » leur propre ouvrage, qui sombrerait
à la première mise à l’eau : quelle honte ! D’autant plus que, pour surmonter
ce mauvais sort, c’est à ce même collègue qu’il faudrait alors obligatoirement
s’adresser pour qu’il indique la voie de la réussite.
Pour ces raisons, la fabrication des pirogues de course est réservée à un nombre
restreint d’artisans, à qui la victoire confère la célébrité : on chante
les louanges du constructeur après la course victorieuse. L’on croit qu’il
a été capable de déjouer le mauvais sort, de le retourner contre son auteur,
de rendre sa pirogue invulnérable à toutes sortes d’attaques, mais aussi de
lui impulser, à elle seule au milieu des autres, la force occulte du vent,
et de faire chavirer ses rivales en voie de la dépasser.
La course, quelle qu’elle soit, a des fonctions complexes, dont la première
serait d’ordre cathartique : la course est perçue comme un phénomène
purificatoire, qui vise la remise en ordre du monde, lorsque l’équilibre en
a été –ou va en être– perturbé par un acte répréhensible, une rupture d’interdit
pas exemple. La course de pirogues n’est pas la seule activité qui remplit
ce genre de fonction : avant toute pêche collective, il convient de se
concilier les bonnes grâces des divinités tutélaires des eaux, et ce sera
le rôle du ji-durama, le maître des eaux, que de leur présenter une
offrande, qui permettra d’établir la paix, d’éviter tout accident et d’assurer
une pêche fructueuse. Le même rôle incombe au chef des chasseurs avant les
chasses collectives, ou au maître de la pluie en cas de sécheresse. La course
serait donc un point commun à toutes ces célébrations : le cérémonial
propitiatoire de la pêche collective comportera la course des jeunes gens
qui traverseront de part en part la mare à pêcher. De même le cérémonial
de la course marque l’entrée des chasseurs occasionnels dans les bois lors
du fèlè ou petite battue, dirigée par le maître de chasse, qui servira
d’exutoire à la communauté pour faire tomber la pluie.
Le cas de la course de pirogue est toutefois un peu différent. Bien sûr, du
fait de son aspect spectaculaire et de son succès populaire, la course de
pirogue a été largement remise à l’honneur du temps de la colonisation française,
lors la fête le 14 juillet et à l’occasion des visites de délégations officielles.
L’administration malienne en a fait de même en organisant des courses de pirogues
à l’occasion des grandes manifestations (fête nationale du 22 septembre, fête
de l’armée du 20 janvier etc., et même pour les visiteurs de marque). La course
est dotée d’une récompense en numéraire, mais le plus important pour
les vainqueurs c’est de recevoir le fanion de la victoire appelé jonjon,
ou darapo (drapeau), qui leur confère honneur et fierté.
La course de pirogues reste essentiellement l’affaire des
familles bozo et somono. Elle oppose soit les quartiers d’une ville, soit
des villages voisins, entre lesquels généralement les échanges matrimoniaux
sont importants. Elle doit être organisée au mieux alors même que les tiraillements
entre ethnies d’un même quartier ou village, et/ou à l’intérieur de l’ethnie,
sont constants. Pour sauver l’honneur du quartier ou du village, il faut rassembler
toutes les énergies. Naturellement les jeunes auront un rôle essentiel, puisque
c’est leur force et leur adresse qui seront d’abord sollicitées. Il faut donc
éventuellement les rappeler de l’extérieur, s’ils sont partis en exode. Il
faut ensuite les sélectionner, ce que feront les aînés, en observant l’entraînement
des équipages sur des pirogues normales. Cette étape leur permettra aussi
de déterminer la place de chaque rameur, en fonction de sa vigueur physique
de sa fougue, de son expérience, de son âge, mais aussi de sa déférence envers
eux et de son esprit de groupe… C’est un déshonneur que de ne pas être sélectionné,
parce que ceux qui le seront subiront un entraînement intensif, entendront
leurs louanges chantées par les jeunes filles et jouiront durablement de la
considération générale.
Dans une pirogue de course, la disposition des rameurs se
fait selon des critères précis. La proue est toujours occupée par le représentant
d’une famille autochtone, et qui s’est distinguée de longue date dans les
compétitions. La même famille choisit toujours son candidat, c’est un honneur
qui lui est fait. Le rôle de ce rameur est très délicat, c’est lui qui guide
la pirogue, ce qui est difficile : le virage à prendre pour contourner
la bouée avant la dernière ligne droite est fatal à beaucoup d’embarcations
qui sombrent ! L’homme de proue doit être jeune et très agile, il doit
se montrer capable de danser sur la proue, mais aussi de galvaniser les énergies
de ses coéquipiers, et enfin d’exécuter les préceptes qu’on lui confie pour
protéger la pirogue. Comme la cadence des pagayeurs est plus rapide à la proue
qu’à la poupe, on mettra à l’avant des rameurs jeunes et fougueux qui imprimeront
à la pirogue une allure rapide ; à l’arrière on placera des rameurs plus
expérimentés et plus âgés, dont le rythme sera plus lent mais très précis.
Le plus souvent, on trouvera donc une quinzaine de pagayeurs assis à l’avant
et une douzaine de pagayeurs debout à l’arrière, plus le barreur muni de sa
large pagaie : en marche, à un coup de pagaie des hommes debout correspondent
deux coups de pagaie des hommes assis, le rythme étant donné par l’homme de
tête. (Malzy, 1946, p. 116)
Aux approches de la compétition, les villages ou quartiers sont mis en état
de siège : la présence des « étrangers » n’est pas souhaitée.
Toutes les eaux riveraines sont surveillées, et on avertit les voyageurs des
dangers qu’elles présentent pour eux. Les abords terrestres sont, eux aussi,
soigneusement gardés par des brigades de jeunes. Tout étranger, surtout s’il
est ressortissant d’un village ou quartier voisin, est considéré comme un
espion potentiel. La suspicion s’étend même aux femmes mariées originaires
des localités concurrentes ! On leur interdit les abords des lieux de réunion,
les confidences, etc. Et en cas de victoire de leur village (ou quartier)
d’origine sur celui de leurs époux, qu’elles n’aillent pas manifester leur
joie, elles seraient sanctionnées ! Des patrouilles inspectent les endroits
dangereux du territoire pour repérer et déterrer les sében (talisman)
ennemis, enfouis sous terre ou dans les eaux ! Les pirogues de course
sont gardées à l’abri du mauvais œil et des sortilèges, dangers et ennemis
de tout acabit ; les gardiens ne peuvent être que d’authentiques fils
du village, dont les deux parents (père et mère) en sont originaires, tous
les autres sont exclus de cette fonction !
Aux approches de la compétition, il faut aussi rassembler des cotisations, car
la course va entraîner des dépenses considérables dont l’enjeu est la victoire
à tout prix ! On va en effet faire appel à de nombreux intervenants pour
le « travail » dont ils vont se charger en vue d’assurer le triomphe !
Ceux qui possèdent les connaissances nécessaires à ce « travail »,
le dalilu, la puissance occulte, sont les marabouts, batuta-mori,
qui se livrent à des pratiques occultes, et les soma ou bida,
maîtres du savoir traditionnel. Leur intervention fera l’objet de marchandages
difficiles, car le pouvoir qu’ils procurent aux objets et aux personnes est
à la fois redouté et recherché par les concurrents, tous avides d’une victoire
éclatante : ils sont capables de conférer l’invulnérabilité face aux
attaques ennemies, d’accroître de façon inouïe la rapidité de la pirogue,
de provoquer le chavirement de celles des concurrents !
Chaque village, et dans une ville chaque quartier, participant à la compétition,
a son marabout et son bida attitrés. A une semaine de la compétition,
le batuta mori entre en retraite permanente : pendant ce temps,
il « travaille » nuit et jour pour ses clients, prie, accomplit
des sacrifices, et finalement prépare un talisman protecteur ou agressif qu’il
leur remettra : un liquide, ou un papier couvert de signes cabalistiques ou
de versets du Coran, car bien sûr c’est Allah le tout puissant qui est sollicité !
Dans le même temps, le bida s’est retiré en brousse, et, sans se laver
pour conserver son invulnérabilité, il prépare lui aussi, au terme de sacrifices
dans lesquels il emploie plantes et pratiques magiques, avec force incantations
adressées aux forces occultes, un talisman qui sera remis au client. Le matin
de la course, tous ces talismans (et aussi ceux qui auraient été confectionnés
à la demande individuelle et aux frais de membres de la communauté, pour renforcer
la commande collective) sont remis à une seule personne, qui en attache une
partie à la proue de la pirogue, en confie une autre partie à l’homme de proue,
et utilise le reste conformément aux prescriptions qui lui auront été faites :
il en enfouira un peu au lieu du départ, un peu à tel virage, etc., et l’homme
de proue le saura, et saura en tenir compte par des actions précises lorsqu’il
passera près de ces endroits. Il arrive ainsi qu’on puisse voir un homme de
proue tenir un talisman serré entre ses dents pendant la course, et le mordre
énergiquement si une pirogue rivale est en passe de le doubler, ce qui aura
pour effet de la faire sombrer inexplicablement ou bien de ralentir soudainement
sa marche !
La réputation de ces marabouts et bida est immense : en cas de victoire,
c’est leur nom qui sera le premier cité, et ils recevront, en sus de la rémunération
initialement convenue, d’autres récompenses de la part des vainqueurs. Quelles
que soient la vigueur et l’adresse des rameurs, tout le monde est en effet
convaincu que seul le dalilu, la puissance occulte, peut provoquer
la victoire. Et les dalilu musulman et païen cohabitent le plus naturellement
du monde, car ils visent la même finalité : pendant que le marabout invoque
Allah, le bida ou soma n’hésite pas à affirmer « Que Dieu
le veuille ou pas, mon travail réussira ! ».
Mais ce n’est pas tout ! Une semaine avant la course, les athlètes, eux
aussi, sont internés, en dehors du village, en vue de les soustraire à la
souillure : tout coït avec une femme compromettrait l’efficacité des
dalilu. En même temps, ils doivent s’abstenir des prescriptions musulmanes
ordinaires et en particulier de la prière musulmane. Néanmoins, le jour de
la course, ils feront les ablutions selon le plus pur rite islamique, pour
se purifier avant de monter dans la pirogue, et là on récitera la fatiya
(action de grâce musulmane).
Pendant toute la phase des préparatifs, et jusqu’à la fin de la compétition,
les concurrents et leurs partisans sont animés d’une passion aveugle sous-tendue
par la rage de vaincre : c’est, entre les villages et quartiers, l’ambiance
de kalamana qui s’installe, une ambiance de compétition et d’opposition,
de rivalité, de jalousie comparable à celle qui prévaut entre des fils de
même père et de mères différentes ; elle frise l’hostilité…
A l’issue de la course, ceux qui auront gagné, savoureront leur victoire tant
à la remise du darapo que pendant le tour d’honneur, et ensuite pendant
les jours de fête qui suivront, et au cours desquels on dansera chaque soir,
sans oublier de distribuer beaucoup de nourriture aux participants et aux
invités. Cette émulation persistera sous une forme enjouée jusqu’à la prochaine
course et les prouesses seront évoquées devant les perdants qui n’auront qu’à
supporter les quolibets! Car les commentaires et les allusions perfides iront
bon train sous le mode de la plaisanterie…
Ces évènements sont révélateurs de la mentalité des participants et des pratiques
mises en œuvre ! Voici par exemple ce qu’on pouvait apprendre de la compétition
entre les villages de l’arrondissement de Konna lors des courses de 1989.
L’un des marabouts engagé dans les préparatifs au service du village K étant
décédé avant la course de l’année précédente, les marabouts et soma
du village concurrent Y, vainqueur depuis des années, revendiquèrent la responsabilité
de cette disparition, en même temps qu’ils se vantaient d’avoir immobilisé
la pirogue du village K pour lequel il avait travaillé. Mais il se fit que
le marabout du village Y qui avait gagné l’année précédente vint à disparaître
juste après la course de 1988, et que son fils, qui le remplaça immédiatement,
se trouva aussitôt atteint de folie. Les marabouts de K, spécialistes du traitement
de cette maladie, soignèrent donc ce jeune homme, et parvinrent à le guérir,
mais non sans avoir percé le secret qu’il cachait, c’est à dire la véritable
l’identité du fabricant de la pirogue de course de Y. Il ne leur restait plus
qu’à organiser une quête auprès de tous les habitants de K pour pouvoir commander
au même constructeur une pirogue dotée d’un dalilu supérieur à celui
dont il avait doté la pirogue de Y. Sur le montant de la collecte, plus de
300.000 FCFA devaient revenir aux marabout et soma au cours de cette
seule année !
On raconte aussi que cinq ans plus tôt, la suprématie de Y s’était avérée possible
parce que le soma du village alors vainqueur, M, avait été outragé
et, pour se venger, avait jeté une malédiction sur son propre village, qui
ne devrait plus jamais gagner une course : de fait une de ses pirogues
sombra dans le dernier virage ! Et il était évident pour tous que ce
naufrage était une punition infligée par un rival. Cependant, une autre explication circulait :
le jury avait cautionné un faux départ, et c’est à la suite de ce dernier
que la victoire de K s’installa ; or l’une des épouses d’un membre influent
du jury venait de K !