 |
Photo J. Brunet-Jailly
 |
Photo J. Brunet-Jailly
DJENNE PATRIMOINE
Informations
n° 18, printemps 2005
NOUVELLES DE DJENNE
Inauguration de la
piste Djenné-Mougna-Saye
La réception provisoire de cette
route a eu lieu le 28 décembre 2004. L’inauguration, quant à elle, s’est
déroulée le 13 avril 2005, à l’occasion de la visite à Djenné du Président de
la République. Cette route en latérite désenclave l’interfluve entre le Bani et
le Niger ; elle est d’une longueur de 60 km ; à Saye elle débouche
sur une piste qui gagne Ségou par Sarro. Elle permettra aussi aux touristes qui
l’emprunteront de traverser une zone typiquement sahélienne, avec notamment une
forêt de rôniers, cet arbre dont le bois est utilisé pour édifier les toitures
des maisons de Djenné.
Visite du Directeur du Centre du
patrimoine Mondial
Au mois de février 2005, Djenné a reçu la visite de
l’honorable Directeur du Centre Mondial du Patrimoine, M. Bandarin, accompagné
par un de ses adjoints, M. Lazzare Elondou. L’objectif visé était de s’enquérir
de l’état de Djenné, ville du Patrimoine mondial de l’UNESCO, après les
« agressions » sur certains sites
notamment la mosquée (ventilateurs et portes), les poteaux métalliques
etc. Cette visite s’intéressait aussi au
projet de restauration des sites et monuments, au système d’infiltration des
eaux usées, dont les visiteurs avaient eu un écho favorable.
Après constat, la mission culturelle a reçu les
félicitations de la délégation pour l’excellent travail qui a été fait pour la
conservation et la préservation du riche patrimoine que représente Djenné. Dans
ses déclarations, M. Bandarin a dit que Djenné reste la seule ville originelle
au monde. Il nous demande à nous, professionnels en charge du patrimoine, de
travailler la main dans la main avec les associations pour réussir ce qu’on
peut appeler la gestion participative du patrimoine culturel de Djenné ;
de redoubler encore davantage nos actions de promotion, de sensibilisation et
d’information, pour amener le plus grand nombre à adhérer à nos idéaux de
conservation et de préservation de Djenné qui reste un modèle de bonne
conservation.
Amadou Camara, Mission culturelle de
Djenné
L’administration a mis la Maison
des hôtes à la disposition de la famille Niaré, qui gère le campement, ce qui
augmente sensiblement la capacité de ce dernier. La plupart des pièces ont été
divisées en deux, restaurées, des toilettes intérieures ont été construites,
les nouvelles chambres sont ventilées, et deux suites ont été aménagées, y
compris l’ancienne loge présidentielle. Le nouvel équipement compte donc 20
chambres et 2 suites.
Visite
du Président de la République, S.E. Amadou Toumani Touré à Djenné le 13 février
2005
La délégation présidentielle comptait, autour du chef de
l’Etat, le Général Kafougana Kone, ministre de l’administration territoriale,
M. Seydou Traore, ministre de l’agriculture, M. Bréhima Coulibaly, chef
d’état-major particulier du Président de la République, M. Daouda Tangara, chef
du cabinet du Président de la République, M. le Représentant de la BAD, M.
Modibo Diarra, ambassadeur, directeur du protocole de la République, M. Ousmane
Tandia, ambassadeur, chef du protocole du Président de la République, M. Seydou
Doucouré, représentant personnel du chef de l’Etat à la francophonie, M. Amadou
Sora conseiller technique à la Présidence de la République, M. Nouhoum… chargé
de mission à la Présidence de la République sur la filière agro-pastorale, et
beaucoup d’autres personnalités, dont le Gouverneur de la région de Ségou, le
Gouverneur de la région de Mopti.
Intervention de M. Gouro Cisse, Maire de la commune de
Djenné
« Excellence Monsieur le Président de la République,
Chef de l’Etat du Mali, Excellences Messieurs les Ministres, Madame et
Messieurs les membres des délégations régionales, Honorables députés à
l’Assemblée Nationale, Messieurs les Présidents des organes des collectivités
territoriales, Messieurs les chefs des services déconcentrés de l’Etat, Madame
et Messieurs les responsables des partis politiques, Madame et Messieurs les
représentants de la société civile, Messieurs les notables, Mesdames et
Messieurs,
« S’il y a une date qui s’est inscrite en lettres d’or
dans l’histoire de ce cercle, c’est bien ce 13 février 2005 ! Excellence
Monsieur le Président de la République vous êtes parmi nous pour procéder à
l’installation officielle de la cellule du projet de développement rural du
cercle de Djenné. A l’occasion de cet heureux évènement, qui s’inscrit dans les
conclusions du forum qui s’est tenu le 15 février 2003, dans cette même salle,
l’honneur m’échoit, au nom des populations de Djenné, et au mien propre, de
vous souhaiter, à votre illustre personne, et à tous les membres de la
délégation qui vous accompagne, la bienvenue à Djenné la merveilleuse.
« Excellence, Monsieur le Président de la République,
votre présence parmi nous traduit à la perfection votre attachement à la
réalisation des objectifs de développement des populations maliennes. Ce
déplacement est une marque d’estime pour nos populations, et va dans le sens de
votre engagement ferme à réaliser le décollage économique de notre pays par le
développement agricole, créant ainsi les conditions de la sécurité alimentaire,
de l’accroissement des revenus des populations, voire de la réduction de la
pauvreté.
« Excellence Monsieur le Président de la République,
vos prises de position sur l’agriculture en général et le coton en particulier,
tant à l’intérieur du Mali qu’à l’extérieur, traduisent à n’en pas douter votre
ferme volonté de relever le défi du développement agricole. Le programme de
développement élaboré par le gouvernement de la République du Mali accorde une
place prépondérante à l’appui au monde rural institué dans votre lettre de
cadrage et le lancement d’une étude de la loi agricole pour promouvoir entre
les acteurs une parfaite coopération en vue de la maîtrise de l’ensemble des
paramètres.
« Excellence Monsieur le Président de la République,
Djenné que vous aimez tant vous est reconnaissante de tous les efforts que vous
entreprenez, parmi lesquels la dotation d’un véhicule pour la brigade
territoriale de gendarmerie ; en effet la difficulté du terrain et la
position géographique du cercle de Djenné rendent la vie très difficile malgré
la détermination et la volonté de bien faire. A cela s’ajoute ce message de vos
amis les enfants : ils m’ont chargé d’être leur intermédiaire auprès de
votre Excellence pour qu’enfin Djenné puisse voir ses enfants emprunter le
chemin du lycée, qu’ils attendent impatiemment. C’est le plus beau cadeau
qu’ils attendent de votre Excellence. »
NOUVELLES DU PATRIMOINE DE DJENNE
Des baraques en tôle sur la place de
la mosquée !
Au
cours de l'assemblée générale de DJENNE PATRIMOINE (voir plus loin), les
adhérents se sont émus d'avoir constaté qu'on a commencé à édifier des baraques
en tôle sur la place devant la mosquée, à proximité du marché quotidien, pour
remplacer des abris en seko.[1]
Plusieurs adhérents sont intervenus pour dire que cette situation présente les
plus graves inconvénients. Car –indépendamment même de toute considération
esthétique– ce n'est évidemment pas en transformant Djenné en bidonville qu'on
préservera la source de revenus que son patrimoine représente pour la cité, et
notamment pour ses commerçants. Plusieurs adhérents ont signalé que, à leur
connaissance, l'administration n'a jamais autorisé les constructions en tôle.
Malheureusement, nous savons tous qu'elle a commencé à tolérer qu'on installe
un container près du bâtiment de l'OPAM, et puis des garages clos de grillage
et recouverts de tôles, puis une cabine téléphonique en tôle près du campement.
Et maintenant, va-t-elle se montrer impuissante à ramener à la raison ceux qui
prennent des initiatives condamnables sur la place de la mosquée elle-même ?
La gestion du patrimoine de Djenné souffre de la zizanie qui règne entre
l'administration, représentée par le préfet, et la mairie. Ainsi le premier a
autorisé l'installation de la cabine téléphonique en tôle près du campement, alors
que le maire l'avait refusée.
Mais la gestion du patrimoine de Djenné souffre aussi de l'incapacité de la
mairie à imposer le sens de l'intérêt commun à tous les habitants de Djenné :
il ne suffit plus de dire "nous sommes tous parents, ici, nous ne pouvons
pas imposer une décision impopulaire à nos parents", il faut faire
comprendre que l'intérêt commun doit primer sur les intérêts particuliers. Les
élus municipaux, et en premier lieu le maire, ne doivent pas se contenter de
profiter des petits avantages de leur situation et ne prendre aucune décision
dans l'intérêt commun si elle risque d'être impopulaire.
Pour se développer, Djenné, comme le Mali dans son ensemble, a besoin de plus
de démocratie, et donc d'abord d'une meilleure compréhension par les
populations de leur intérêt commun : cela passe par une pédagogie de tous les
instants, dont la tâche revient naturellement aux élus. Mais s'il se confirme
que les élus n'exercent pas leurs responsabilités, faudra-t-il que l'on
en revienne à une « administration de commandement » pour défendre le
patrimoine de Djenné ?
Une association comme DJENNE PATRIMOINE sera-t-elle contrainte, malgré la honte
qu'elle en éprouverait, d'alerter le ministère de la culture, l'UNESCO, toutes
les institutions étrangères et internationales qui se donnent pour mission de
protéger le patrimoine de l'humanité ? Nous voulons espérer que le sursaut se
produira à Djenné même !
Projet de formation des maçons
La mission culturelle avait sollicité, sur ce projet, le
laboratoire CRAterre-EAG, spécialisé dans la construction en terre à l’Ecole
d’architecture de Grenoble, à travers son Président, choisi comme consultant.
Les dossiers avaient été montés, et Thierry Joffroy, chercheur à CRAterre-EAG,
a fait une mission à Djenné à ce propos au mois d’avril dernier. Mais au moment
du décaissement, on a demandé à la Mission Culturelle le versement de sa
contribution. Face à la difficulté de réunir la somme demandée dans le délai
prévu, CRAterre-EAG s’est tout simplement désisté.
Amadou Camara, Mission culturelle de
Djenné
Reprise des travaux de réhabilitation de l’habitat
ancien typique
L’ambassade de la Hollande a octroyé un nouveau fonds à la ville de
Djenné pour une seconde phase de la réhabilitation des maisons présentant un intérêt
architectural. Cette seconde phase prévoit essentiellement le crépissage des
maisons réhabilitées au cours de la première phase (pour un coût moyen
d’environ 250.000 FCFA par maison), ainsi que la réhabilitation chaque année
d’une ou deux maisons supplémentaires.
Pour cette nouvelle phase, la Mission culturelle devient maître
d’ouvrage, mais n’exécute pas les travaux comme elle le faisait dans la
première phase. Un contrat a été signé entre l’Etat (ministère de la culture)
et un GIE dénommé Barey Ton de Djenné, présidé par M. Kouroumansé dit Bayéré.
Le comité de pilotage du projet de réhabilitation des maisons de Djenné a été
informé de la nouvelle procédure, et de la mise des fonds à la disposition du
Ministère de la culture.
Pour l’année 2005, 17 maisons ont déjà été identifiées, où les travaux de
crépissage ont commencé dès février.
Assainissement de la ville de Djenné
Le Ministère de la culture, à travers sa structure
déconcentrée, la mission culturelle, à entrepris de réaliser des caniveaux pour
l’évacuation des eaux de pluies dans la ville de Djenné. Cet important chantier
a été rendu possible grâce à un financement de la banque mondiale IDA (PDUD,
composante sites et monuments des cités historiques). Le fond alloué
l’exécution de ces travaux est de l’ordre de quatre cent millions FCFA. Les
travaux ont débuté le 24 avril 2005 et devaient durer six semaines.
Ainsi, après la restauration des maisons et monuments, la
Mission culturelle, qui était interpellée par rapport à l’assainissement de la ville, est intervenue d’abord, avec
l’appui financier et technique du partenaire hollandais, en proposant des
systèmes d’infiltration individuelle ; maintenant elle s’attaque au
problème des eaux pluviales.
Les alentours immédiats de la mosquée ne seront pas
concernés par ces travaux, car dans ce secteur la mission souhaite une
intervention globale, et non isolée, pour des raisons de préservation et de
conservation.
Amadou Camara, Mission culturelle de
Djenné
[Ajoutons que l’installation des systèmes d’infiltration d’eau, financée
par la KfW, a été arrêtée à cause du conflit entre la mairie et l’association
qui gère l’adduction d’eau.]
Ce festival et son exposition-vente ont été organisés, du 19 au 25
février 2005, par l’Association des jeunes pour le développement de Djenné,
dont la présidente est Mme Kadiatou Baye. Ce projet a reçu l’appui de DJENNE
PATRIMOINE sous forme d’une subvention de 50.000 FCFA et d’un prêt de
photographies. Malheureusement, ces dernières n’ont pas été correctement
exposées.
Cette année, alors que 5000 pèlerins sont partis du Mali, une vingtaine
étaient originaires de Djenné, parmi lesquels :
-
les
deux muezzin, Modi Sidibe et Alphamoye Nientao ;
-
Amadou
Soumaila Diallo avec sa femme ;
-
deux
vieilles femmes, Na Kayentao et Coumba Koïta ;
-
Koa
Gano, avocat à Bamako, parti en pèlerinage avec un de ses vieux parents ;
-
Mamadou
Kokeina, de Yoboucaïna, parti avec sa maman ;
-
Badji
Nientao, la femme marabout, partie avec son fils ;
-
Assoumane
Touré, qui est le père du gérant de la station service récemment ouverte à
Djenné
Voir plus loin deux témoignages recueillis à ce sujet.
Cette année, le crépissage de la mosquée a eu lieu le jeudi 24 février et
le jeudi 13 mars. La première date avait été fixée largement à l’avance pour
coïncider avec l’organisation du festival du Djenneri. Il est donc possible, si
on le veut bien, de faire de cette fête une manifestation qui attire du monde à
Djenné et contribue ainsi au développement économique de la ville ; en
même temps, les étrangers qui viendraient à Djenné à cette occasion pourraient
apprécier l’organisation collective qui permet le financement et la réalisation
de cette importante entreprise, organisation qui est décentralisée jusque dans
les quartiers.
On aura remarqué par ailleurs que, cette année, la totalité de la surface
a été crépie deux fois : les maçons avaient jugé qu’une seule application
ne suffirait pas. Le 24 février, les maçons des quartiers sud ont donc couvert
la totalité de la surface des façades extérieures, et le 13 mars les maçons
engagés par les quartiers nord ont repassé presque partout. Le 24 février,
chacun a pu voir le Ministre de la Culture, Cheick Oumar Sissoko, participer
personnellement au travail de transport du banco.
 |
 |
NOUVELLES DE DJENNE PATRIMOINE
Le montage des images prises par Mori Soumano et son équipe
lors du séjour culturel organisé par DJENNE PATRIMOINE pour ses membres
bienfaiteurs résidant hors du Mali, en 2000, avait été confié dès 2001 à Moussa
Ouane. Ce travail a connu des retards considérables, mais il est achevé :
une cassette de 16 minutes destinée à la vente a été remise au Président Papa
Cissé en avril 2005. Elle est en cours de multiplication sur DVD pour être
vendue au profit de l’association.
Contacts avec Acroterre et préparation d’un projet
A la suite de son voyage à Djenné en décembre 2004, au cours
duquel elle a notamment rencontré les maçons de cette ville, Evelyne Bertrand a
pris contact avec l’association Acroterre, spécialiste de construction en terre
et soucieuse de réalisations participatives.
ACROTERRE est une association sans but lucratif, créée en
1985, à l'initiative d'architectes et de techniciens, regroupant différents
partenaires spécialisés dans l'étude de projets et la mise en oeuvre des
matériaux locaux, associant leurs compétences professionnelles et leurs
motivations pour l'aide au développement.
Au départ, ACROTERRE intervenait comme une ONG d'appui
technique, spécialisée dans l'utilisation des matériaux locaux et plus
particulièrement le matériau terre. Depuis 1993 l'association, qui s'est
dotée de compétences dans le domaine des sciences sociales, de l'économie et du
développement, a diversifié ses activités (en conservant le thème central de
l'habitat et de la construction) et met en œuvre directement les projets avec
ses partenaires du Sud.
L’objectif d’ACROTERRE est de promouvoir et d’améliorer des
techniques traditionnelles de construction, pour réaliser des programmes
d’équipements publics (dispensaires, écoles, ….), ou d’habitat social, à
travers une démarche participative, ou de conservation du patrimoine
architectural, en répondant aux besoins des populations et des organismes de
développement.
Au Mali, ACROTERRE est déjà intervenue il y a près de vingt
ans en créant notamment le village SOS d’enfants de Sanankoroba, et plus
récemment, en 2003, en évaluant le
programme de construction de bâtiments publics en briques de terre comprimées
réalisé par l’AFVP (Association française des volontaires du progrès).
C’est à la suite de ces contacts que s’est précisé le projet
de construire une Maison du Patrimoine de Djenné, première étape d’un projet
complet de développement fondé sur l’artisanat d’art, et de redécouvrir à cette
occasion la technique de construction en djenne ferey qui n’existe dans
aucun autre pays au monde. Ce projet a été présenté au co-financement du
Ministère français des Affaires Etrangères.
Compte-rendu de l’assemblée générale du 22 mai 2005
Une assemblée générale de l’association s’est tenue le 22
mai 2005 en présence des membres et sympathisants suivants : Bamoye Maïga,
Alpha Sidiki Toure, Assouman Traore, Badara Dembele, Alphady Cisse, Hamma
Cisse, Bamoye Guitteye, Boubacar Koïta dit Tapo, Koniba Konate, Foourou Alpha
Cisse, Amadou Tahirou Bah, Amadou Sidibe, Boubacar Kouroumanse dit Bayere,
Ladji Kouroumanse. Elle a souhaité prompt rétablissement au Président Papa
Moussa Cissé, victime d’un malaise dans la soirée et empêché d’assister à
l’assemblée générale. Elle a examiné les comptes portant sur la période du 31
décembre 2001 au 21 mai 2005, présentés par le trésorier Amadou Tahirou Bah.
Sur l’ensemble de la période, les recettes se sont élevées à
2.300.000 FCFA, entièrement couvertes par des cotisations de membres
bienfaiteurs (et de minimes appuis venant d’autres associations lorsque nous
accueillons leurs membres à Djenné). Les dépenses se sont élevées à 1.893.300
FCFA qui se répartissent ainsi :
*dépenses de fonctionnement
-location du local : 198.000
-frais de déplacement du Président : 114.500
-frais de réception :
100.000
-photocopie, fax, papeterie : 68.010
-téléphone :
106.730
-location de la boite postale : 29.250
-réception de personnalités (MM. Muller, Dethier, Morel)
30.000
*appui à des activités culturelles
-frais d’expédition du bulletin :
655.560
-exposition des photographies de mosquées rurales : 307.250
-appui à un chercheur sur la décentralisation : 25.000
-appui à un artisan (bogolan) : 50.000
-appui au crépissage de la mosquée : 113.000
-appui au festival du Djenneri :
50.000
-appui à la préparation du projet de Maison du Patrimoine 46.000
La discussion de ces comptes a montré en particulier :
- que les recettes de l’association, comme son nombre de
membres bienfaiteurs, restent stables, ce qui traduit la faiblesse des efforts
de recrutement, alors que le nombre de visiteurs de Djenné ne cesse de
croître ; les activités de l’association ont donc besoin d’être
redynamisées ;
- que le bulletin « DJENNE PATRIMOINE
Informations » représente un poste très important, mais essentiel si
l’association veut garder le soutien de ses membres bienfaiteurs ;
- que le recours à la diffusion électronique de ce bulletin,
à partir de 2004, pour tous les membres bienfaiteurs, a permis de réduire
considérablement les dépenses d’affranchissement ;
- que le site internet de notre association www.djenne-patrimoine.asso.fr
est toujours supporté par un ressortissant de Djenné, M. Boubou Cissé, qui
était étudiant en France ces dernières années et qui, récemment embauché par
l’Institut de la Banque Mondiale, réside désormais à Washington ;
l’assemblée le félicite de ses succès professionnels et le remercie de son
soutien à ses activités ;
- que les membres de l’association n’étaient pas informés de
la contribution de l’association au financement du crépissage de la mosquée en
2002.
L’assemblée générale a également évoqué le projet de réforme
des statuts de l’association. Cette réforme vise à créer un poste de secrétaire
général qui sera spécifiquement chargé de l’animation de l’association. Ce
projet, étant entre les mains du Président, n’a pas pu être soumis au vote, il
le sera à la prochaine occasion.
L’assemblée générale a aussi été informée du projet monté
par Evelyne Bertrand, à la suite de ses nombreuses visites à Djenné : avec
l’association Acroterre (ONG regroupant des spécialistes de la construction en
terre) et l’association des maçons de Djenné, un projet de construction d’une
Maison du patrimoine de Djenné a été soumis à un co-financement du Ministère
français des affaires étrangères. Cette construction serait organisée comme un
chantier-école permettant de transmettre à la jeune génération les
connaissances des anciens en matière de construction en djenne ferey, et
de redécouvrir les aspects oubliés de cette technique unique au monde.
L’assemblée générale a demandé que le Ministère de la culture et le Ministère
du tourisme soient impliqués dans ce projet ; elle a tenu à remercier les
maçons, et spécialement M. Boubacar Touré et Boubacar Kouroumansé dit Bayéré,
pour leur concours largement bénévole à ce projet.
« Pour rien vous cacher, je suis étonné de la manière
dont vous traitez le problème de l'excision dans l’article "Une saison de
circoncisions et d'excisions" paru dans votre numéro 17. Je connais les
raisons d'ordre religieux, sociologique, le rôle de la pression sociale qui
poussent à l'excision, mais c'est avant tout une atteinte à l'intégrité
physique des fillettes.
« Si le Mali n'a pas interdit l'excision, il a signé
des textes qui la condamnent : la "convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes"
qui est entrée en vigueur le 13 janvier 1984 ; la "charte africaine des
droits de l'homme et des peuples" qui est entrée en vigueur le 21 octobre
1986 ; la "Charte Africaine sur les droits de l'enfant" qui a
été adoptée par la 26-ème Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
« S'il faut conserver le patrimoine de Djenné, je crois
que quand on parle de l'excision, il faut l'adapter en supprimant tout le côté
atteinte à l'intégrité physique des fillettes. Je ne connais pas la position de
DJENNE PATRIMOINE Patrimoine par rapport à l'excision, mais il est important
que le débat soit ouvert en son sein et que DJENNE PATRIMOINE Informations puisse
en donner les résultats. » écrit Jean-François Roux de l’Association
Vision du Monde. Cette lettre a été suivie d’une visite à Djenné pour
rencontrer des représentants de DJENNE PATRIMOINE.
Voici la teneur de la réponse qui a été faite
oralement :
Cher Monsieur, votre réaction ne nous surprend guère. Elle
est d’autant plus normale qu’elle
s’appuie sur les diverses
conventions internationales protégeant les femmes et les enfants. Notre
objectif est de montrer au monde que, malgré tout ce qu’on dit, cette pratique,
qui est un phénomène culturel profondément enraciné et qui s’appuie sur une
longue histoire, rappelée aujourd’hui par une prédication unanime, demeure encore
vivace dans notre milieu. Un tel phénomène n’est pas comme un programme
d’activité qu’on peut réviser à loisir et au moment voulu. Il s’agit alors de
conjuguer les efforts et de s’armer de patience afin de venir à bout de cette
pratique.
Amadou Tahirou Bah
_______________________________________________________
DOCUMENT
1
Deux témoignages sur le pèlerinage
Le pèlerinage raconté par Amadou Soumaïla Diallo
A. S. Diallo : Si vous avez la volonté d’accepter ce
sacrifice, car c’est un sacrifice, vous pouvez aller. C’est un sacrifice, car
vous pouvez aller et ne pas revenir. Il faut accepter le sacrifice, avoir
l’intention et les moyens, alors on peut partir en pèlerinage. C’est une
recommandation à tout musulman.
Donc certains n’ont pas les moyens. Pour moi, ce sont eux,
mes neveux, qui ont contribué à mon départ, qui ont rassemblé les fonds, les
moyens de nous rendre à la Mecque, moi et mon épouse. Chacun d’eux a apporté sa
petite pierre, c’est comme ça que nous sommes partis. Personnellement, moi, je n’avais
même pas un franc.
A.T. Bah : Il dit qu’il n’avait même pas un franc
là-dedans, mais en réalité nous sommes ses neveux et pratiquement c’est lui qui
nous a élevés, c’est lui qui nous a mis à l’école tous, nos papas ne nous ont
pas du tout aidés en cela, c’est lui qui nous a aidés, et de cette façon c’est
lui qui a contribué à son propre départ, c’est lui qui a fait de l’épargne,
c’est une sorte d’épargne
A.S. Diallo : Oui, c’est une épargne, mais sur le plan
pratique, en résumé succinct, ce sont mes neveux qui m’ont envoyés en
pèlerinage. On peut dire que cette dernière étape a été préparée depuis trente
ans.
Donc au mois de novembre, je suis allé à Bamako, il y a des
formulaires à remplir, il y a d’abord des examens médicaux (urines, selles,
examen médical général, des analyses, des prises de sang, tout ça, qui sont à
la charge du futur pèlerin, et dont on attend les résultats). Après on va à la
Maison du Hadj (maison du pèlerin) avec tous ces documents et résultats, on
trouve là-bas une équipe sanitaire, ils posent des questions, ils réexaminent
tout le dossier, et après cela ils vous autorisent à faire le pèlerinage. Il y
a aussi des vaccinations à faire, des vaccinations contre des maladies
endémiques, choléra etc. etc. Votre état de santé doit être bon, car en
Arabie Saoudite on ne veut pas recevoir des malades. C’est seulement lorsque
tout cela est fait que vous êtes inscrit. On établit votre passeport, vous avez
déjà payé les frais pour cela.
C’est alors que vous suivez la formation qui est organisée
au niveau de la Maison du Hadj à Bamako. Le matin, c’est l’enseignement
théorique, le soir c’est la pratique : on suppose qu’on est à la Mecque,
et on apprend ce qu’on doit faire.
Quand tout cela est fait, on est prêt à partir. Nous, nous
avons choisi la filière gouvernementale, donc pour notre voyage on a pris
l’avion vers le soir, et en passant par le Tchad directement on a atterri à
Médine, vers les deux heures du matin, c’était la première fois que le vol
était organisé de cette façon. Là-bas, il y a la douane, les services
sanitaires, qui nous ont examinés. Après ces formalités, on nous a mis
directement dans un bus qui nous a conduits à notre hôtel.
Le premier devoir du pèlerin, c’est de dire quarante
prières. Quarante, et il ne faut pas en manquer une ! On passe donc huit jours
à implorer le Tout Puissant, à demander Son pardon, à Lui demander de nous
protéger, aujourd’hui et demain… Ce sont les cinq prières quotidiennes
régulières, pendant huit jours. Tant qu’on n’a pas fini les quarante prières,
on ne peut pas bouger de Médine.
A Médine, la mosquée est très grande, et très propre !
Il parait qu’elle a une surface de vingt hectares, et qu’elle est entretenue
par le Maroc. Tout est propre, tout est nettoyé après la prière. Même les
toilettes de cette mosquée sont très vastes et très propres. La mosquée est
divisée en deux parties, une pour les hommes et une pour les femmes : vous
ne les voyez pas, il y a un mur haut à peu près comme celui-là (trois mètres
environ) qui sépare les hommes et les femmes. Et il y a du monde !
Dans la mosquée actuelle de Médine, il y a la maison du
Prophète et son jardin. Pour la prière, chacun veut être non loin de la tombe
du Prophète. Donc ce sont des bousculades. On va là-bas à la mosquée à cinq
heures du matin, on prie à dix heures et quelques, on revient, on prend notre
café, on passe tout notre temps à dire des prières, à midi on va encore à la
mosquée, on va prier le salifana (la prière de 14 h), après on revient,
on mange, on se prépare pour seize heures, dix-huit heures et vingt heures, les
trois. Donc on reste sur place pour les trois prières, et ensuite on rentre.
On est en groupes dans un local où nous sommes logés,
nourris et entretenus. Quand il y a trop de monde, les mets ne sont pas toujours très appétissants, donc on va
acheter ailleurs ; mais tout est bien préparé, il y a de l’ordre. Il n’y a
pas de mets extraordinaires, ce sont à peu près nos mets, le poulet, le bœuf,
le mouton, le poisson, seuls peut-être les condiments diffèrent. Quand on a de
l’argent, on vit bien : il ne faut pas se contenter du repas
gouvernemental, il faut acheter quelques suppléments. On est logés dans des
chambres de cinq ou six ; dans ces chambres, il y a tout, même des
toilettes bien faites, à Médine comme à la Mecque. Nous nous étions six
fonctionnaires, dont j’étais le doyen, donc tout le monde me respectait, je
n’achetais rien, je n’ai pas acheté un morceau de viande, ce sont les amis, les
Bana, les Debas, les autres qui ont payé tout ! Et même le haram,
je ne l’ai pas payé, c’est Debas qui en a acheté deux, un pour moi et un pour
lui.
On part ensemble à la mosquée, mais dans la mosquée on est
éparpillés. Il y a tellement de monde ! Certains jours, vous ne pouvez
même pas arriver à la grande mosquée, on ne peut pas, il y a trop de monde,
vous priez à côté !
Donc, quand on a fini le séjour à Médine –je vais vous
montrer la mosquée de Médine (il sort un petit tapis sur lequel elle est
représentée)– où on est resté huit jours, on va à la Mecque.
Vous êtes maintenant en haram, la tenue de pèlerinage
(faite de deux pagnes blancs sans couture). A la Mecque, il y a des hôtels un
peu partout, on mange bien, ce n’est pas très cher. Quand on arrive à le
Mecque, après avoir déposé les bagages, il faut aller à la mosquée,
immédiatement, pour faire les sept tours de la Kaaba. A la Mecque aussi, tout
est propre, les portes sont dorées, on peut prier même à l’étage, accessible
par ascenseur.
Là-bas, la race la plus importante, c’est la race blanche,
nous les Africains, les Noirs, on peut nous compter, par rapport au nombre de
la race blanche, des asiatiques. Et chacun arrive là-bas à l’heure, personne ne
veut venir en retard.
Il faut donc d’abord faire les sept tours. Il y a un endroit
où on court. Moi je n’ai pas pu passer en bas. En bas, si tu tombes, c’est
fini, tu seras piétiné, il y a trop de monde ! Je suis monté à l’étage, il
y a un ascenseur, il y avait une chaise roulante, il faut payer, appuyer sur un
bouton, en une minute tu es à l’étage, et là aussi on peut faire le tour de la
Kaaba.
Il y a un endroit là-bas où il faut courir, il s’appelle marwa.
On court pour imiter le Prophète. Tout ce qu’on fait là-bas, c’est l’imitation
du Prophète. Il y a assez de mosquées à la Mecque, assez de petites mosquées !
Le petit pèlerinage, ouma, finit là. Maintenant, à
l’approche de la fête, il y a le grand pèlerinage. Mais avant la fête on a loué
un véhicule pour aller voir là où le Prophète est passé, pour rejoindre Médine.
Et après on est allé à Arafat, on a même prié à la mosquée d’Arafat, et puis on
est allé très loin de Arafat, là où le Coran est descendu. Ensuite, on est
venus à Moudelfa, là où on lance les cailloux, ensuite on est venus à Mina…
Tout ça avant le pèlerinage, pour voir les lieux touristiques.
Donc pour le pèlerinage, on est repartis à Mina pour
commencer le pèlerinage là-bas. Après Mina, où on a fait deux jours, on est
partis à Arafat, revenus à Mina, pour lancer les cailloux. Là bas il y a sept
cailloux, vingt et un cailloux, et beaucoup de gens ; beaucoup sont
décédés là-bas ; et même notre ami, heureusement il a échappé de peu,
Bana ! il y a eu une bousculade ! à moi l’enseignant m’avait
recommandé « il ne faut pas aller là-bas ! ».
Avant qu’on aille à Mina, le gouvernement nous donne un
pécule de 700.000, 700 réals, vous avez payé le transport, donc maintenant on
vous donne quelque chose pour acheter le mouton, nous notre mouton nous a coûté
270 réals, un mouton assez gros. 10 réals valent à peu près 1500 FCFA.
Après on revient encore à la Mecque, on va faire le tour de
la Kaaba, le trajet de Safaa et Marwa, sept fois, Arafat aussi, … sept fois, et
on continue les prières. Il y a assez d’oiseaux de Fatimata, là aussi il faut
payer quelque chose pour les oiseaux, des pigeons.
Maintenant, à l’approche du départ, si vous partez demain
matin pour rejoindre votre pays, vous allez encore « donner au
revoir » à la grande mosquée : à ce moment on ne fait pas Safaa et
Marwa, on fait seulement sept fois le tour de la Kaaba, on prie, on fait des
bénédictions.
Ah, pendant le pèlerinage, on est à l’aise, on a l’intention
même de revenir, parce qu’on ne finit jamais là-bas de prier, et tout le monde
est occupé à la prière, et tout le monde est musulman. Tu ne penses à rien qu’à
Dieu et au Prophète, tu es à côté du Prophète, et tout est propre, et tout est
simple, alors que quand tu es là il y a assez de problèmes, donc tu oublies
tout ça ! Donc on a toujours l’intention de revenir là-bas.
Et puis quand on revient ici, c’est la fête, c’est la
joie ! Chacun à ce moment-là a encore apporté quelque chose, hein !
Moutons, bœufs, tout ça ! C’était la joie ! Et toute la ville était
là : l’imam était là, les grandes personnalités musulmanes de Djenné, tout
le monde était là ! C’est un jour exceptionnel, quand on revient de la
Mecque ! Tout le monde veut vous serrer la main, et on a bonne mine.
Amadou Soumaila Diallo
[Amadou Soumaïla Diallo a fréquenté l’école régionale
de Djenné entre 1939 et 1945, puis il est allé préparer le brevet élémentaire
au cours normal de Sévaré. Il a eu son premier poste d’enseignant dans la
fonction publique à Gao en 1952, d’où il a été muté à Djenné en 1957. Vers la
fin du régime de Modibo, il a été exilé à Néakou, dans le cercle de Niafounké,
avant de revenir à Niakongo dans le cercle de Mopti en 1969, puis à Djenné dès
1970 ; directeur de l’école B et créateur de l’école franco-arabe, il
restera à Djenné jusqu’à sa retraite en 1987 ; mais, sans abandonner
l’enseignement, il sera aussi élu député à l’Assemblée Nationale de 1982 à
1988. Il a créé le jumelage Vitré-Djenné en 1987]
Le pèlerinage raconté par Madame
Sirandou Bocoum
Le pèlerinage est l’un des cinq piliers de l’islam. Il
incombe à tous les musulmans qui en ont les moyens financiers et dont la
capacité physique leur permet d’accomplir le rite.
Tout musulman aimerait le faire car il lui offre
l’opportunité d’implorer le pardon de Dieu « le Très Haut, le
Miséricordieux » pour le mérite de Mohamed « Paix et salut sur
Lui » et de ses compagnons « Bénédiction de Dieu sur eux et Paix à
leur âme ». Mais seuls arrivent à l’accomplir ceux dont le pèlerinage est
inscrit dans le destin. Des musulmans très riches et bien portants ont toujours
remis à demain son accomplissement et ne sont jamais parvenus à le faire
jusqu’à la fin de leur vie. Par contre des musulmans vivant moyennement
l’accomplissent, bien qu’avec toutes les peines du monde. D’autres procèdent
par étapes : ils voyagent de ville en ville et de pays en pays, ils
s’arrêtent chaque fois qu’ils sont en difficulté financière, travaillent un ou
deux ans pour avancer, et ainsi jusqu’à ce qu’ils arrivent à destination.
D’autres n’y arrivent jamais parce qu’ils meurent avant
destination. On apprend ainsi que certains pèlerins, sitôt arrivés à la Mecque,
tombent malades et restent au lit pendant toute la période du rite, et c’est de
l’hôpital qu’on les ramène à l’aéroport pour le retour au pays d’origine. Ils
n’ont même pas eu la chance de voir la Kaaba, à plus forte raison de visiter la
Mosquée Raouda et le Mausolée où repose Mohamed « Paix et salut sur
Lui » et ses compagnons « Bénédictions de Dieu et Paix à leurs
âmes ». On nous dit que ces accidents arrivent à celui dont le pèlerinage
n’est pas inscrit dans le destin, ou parce qu’il a commis des péchés très
graves.
Puisque nul ne sait son destin, ni n’est sûr de n’avoir pas
commis une grosse erreur dans sa vie –qui l’amènerait à être privé de la chance
d’être sur les lieux saints, de mériter le pardon et d’être sauvegardé du
calvaire de l’enfer « que Dieu nous en garde ! » –, le futur
pèlerin est sujet à une grande appréhension.
La décision d’accomplir le pèlerinage vient spontanément,
car on ne peut y penser avant d’en avoir réuni les conditions. Les journées et
les nuits deviennent alors très longues, sitôt la décision prise, à cause de
l’empressement qu’on a de se trouver sur les lieux saints, et de la crainte de
ne pouvoir accomplir correctement le rite, et même de perdre la vie dans les
bousculades autour de la Kaaba, ou sur le mont Arafat, ou encore au moment
de lapider Satan.
Tous les malaises et même les maux qu’on ressentait
auparavant disparaissent le jour du voyage sans qu’on se rende compte comment
cela a pu arriver.
Les parents, les amis et les voisins assistent tous au
départ de pèlerin, lorsqu’il quitte son domicile pour l’aéroport de Hamdallaye.
Tous formulent leurs vœux de bon accomplissement du pèlerinage et, les larmes
aux yeux, souhaitent bon retour au pèlerin. Certains d’entre eux vous apportent
leur soutien financier. Les proches
parents et les enfants du futur pèlerin
tiennent tous à l’accompagner pour assister à son embarquement dans le
car pour l’aéroport international de Bamako-Sénou où il prendra l’avion.
Le pèlerin et ses accompagnants attendent parfois toute la
nuit, assis sur des chaises, son tour d’embarquement. A l’appel de son nom au
haut-parleur, la séparation entre le pèlerin et ses accompagnants occasionne
encore beaucoup de larmes, car chacun de son côté se demande s’il reverra celui
qu’il quitte. Mais certains pèlerins restent très sereins, car pour eux
l’essentiel est de bien accomplir le pèlerinage, et rien d’autre n’a plus
d’importance.
Les invocations et les implorations de Dieu « le Très
Haut exalté » commencent aussitôt que les pèlerins sont embarqués dans le
car jusqu’à l’aéroport de Bamako-Sénou, et continuent dans l’avion jusqu’à
Djedda et de là jusqu’à Médine.
Les pèlerins du premier convoi commencent par la visite des
lieux saints de Médine, et les derniers commencent par la Mecque, après avoir
fait leur bain de purification dès Djedda et s’être habillés là-bas de leur
tenue rituelle, s’être parfumés, avoir émis le vœu de la Oumra (le petit
pèlerinage), avoir imploré Dieu pour qu’il accepte leurs bonnes actions et leur
pardonne leurs erreurs. Les hommes peuvent formuler leur vœu à haute voix, les
femmes doivent le faire à voix basse. La tenue de l’homme consiste en un pagne,
si possible une houppelande ; la femme s’habille décemment comme elle
veut, elle ne porte aucune parure. Tous s’habillent de blanc de préférence.
La joie d’avoir l’occasion de visiter les lieux saints et la
crainte d’être victime des accidents mentionnés ci-dessus s’entremêlent dans le
for intérieur du pèlerin pendant tout le voyage. Mais la crainte disparaît
aussitôt qu’il se trouve sur les lieux, et laisse la place à une grande émotion
qui s’accompagne chez le pèlerin d’un total dévouement pour atteindre l’objectif
principal : la bonne exécution de tous les rites pour acquérir le pardon
des péchés commis.
A Djedda et à l’entrée de La Mecque et de Médine, la
vérification des pièces administratives prend beaucoup de temps.
A la grande mosquée de la Mecque, on commence par la
procession de circumambulation, sept fois, autour de la Kaaba, en commençant
par le niveau de la pierre noire sacrée, en glorifiant Dieu, « Alahou
Akbar », en l’invoquant et en implorant son pardon et sa protection contre
le châtiment de l’enfer, et en lui demandant le bien de ce monde et le bien
dans l’au-delà. Celui qui aura fait le plus de circumambulations autour de la
Kaaba aura le plus de mérite.
Au moment d’effectuer tous les rites du pèlerinage, il est
recommandé au pèlerin de ne pas heurter les autres, de ne causer aucun tort à
personne, de ne pas courir au moment de la circumambulation de la Kaaba.
Le pèlerin se dirige ensuite vers le monticule de Al Safa
tout en glorifiant, en invoquant Dieu « le Très Haut exalté » et en
implorant son pardon. Puis il descend du monticule et commence la procession de
la Oumra. A la fin du premier trajet, on arrive au monticule de Al
Marwa, toujours en invoquant, en glorifiant et en implorant Dieu. Le trajet
d’Al Safa à Al Marwa est celui qu’a effectué l’épouse d’Ibrahim dans un moment
d’embarras.
Une partie du trajet de Al Safa à Al Marwa s’effectue en
marche normale, et une autre en marche rapide, mais sans courir, dignement,
sans causer aucun tort à quelque autre pèlerin. Cependant, des pèlerins très
forts de constitution bousculent les autres, leur donnant des coups de coude
pour s’approcher de la pierre noire sacrée ; mais même s’ils y
parviennent, ils ont moins de mérite que celui qui a tout bonnement fait toutes
ses invocations en face de la pierre. D’autres, moins forts, perdent la vie
dans les bousculades, car ils tombent et sont piétinés. Si, en voulant obtenir
le pardon, on fait perdre la vie à un autre pèlerin, ou si on provoque quelque
chose qui entraîne perte de vie, on sort du cadre des recommandations du
Prophète « Paix et salut sur Lui » : la récompense de ceux-là
sera le supplice dans l’au-delà. Celui qui ne respecte pas les recommandations
du Prophète est loin d’être un ami du bien, il est banni par Lui.
A la fin des sept tours, le pèlerin fait deux rakat
de prière derrière la station d’Ibrahim si possible, sinon en n’importe quel
endroit de la sainte mosquée. Dès que le pèlerin aura terminé les sept trajets
de la procession entre Al Safa et Al Marwa, la Oumra est achevée, et le
pèlerin peut retourner à sa vie normale licite (porter d’autres habits par
exemple).
Après le trajet d’Al Safa à Al Marwa, le pèlerin va vers les
puits de Zam-Zam, surmonté de bornes-fontaines pour se désaltérer, se laver et
faire ses ablutions. Ce puits s’est creusé à l’endroit où Ismail a donné des
coups de pied quand il est venu au monde : l’eau de ce puits a servi pour
la toilette du nouveau-né.
A la Mecque, il y a plusieurs mosquées, et on y prie à la
même heure, mais le pèlerin doit être le plus souvent, sinon à toutes les
heures de prière (il y en a cinq dans la journée, comme on sait), à la Sainte
Mosquée, celle dans laquelle se trouve la Kaaba. Or, pour accéder à cette
mosquée, il faut venir bien avant les heures de prière, ou même n’en sortir que
pour les besoins vitaux.
En pratique, le pèlerin doit se lever au plus tard à trois
heures du matin, pour avoir accès aux toilettes et faire ses ablutions ;
sinon, il sera obligé de faire la queue et ne pourra jamais accéder à la mosquée
pour la prière de l’aube. A Médine, le problème ne se pose pas, car dans la
mosquée elle-même il y a suffisamment de toilettes et de douches.
Evidemment, la ville ne dort pas pendant tout le temps du
pèlerinage. Les enfants jouent dans les rues à deux heures du matin, les
magasins sont ouverts à tout moment, le jour et la nuit, les commerçants et les
clients vaquent paisiblement à leurs affaires et personne n’est inquiété :
nuit et jour, les rues regorgent de monde.
La veille du huitième jour, après la prière du soir (Icha),
les pèlerins s’embarquent pour Mina, ils y passent la journée du huitième
jour ; c’est à Mina, avant de partir à Arafat, que le pèlerin fait son
bain de purification tout en formulant le vœu du hadj (là encore, en
silence pour les femmes). Le neuvième jour après la prière de l’aube (Fayr),
ils partent pour Arafat où ils resteront toute la journée jusqu’au coucher du
soleil. Ce jour là, exceptionnellement, les pèlerins ne prieront pas la prière
du crépuscule (Maghrib) à l’heure indiquée, ils attendront d’être
arrivés à Muzdalifah, comme l’a fait Mohammed « Paix et salut sur
Lui ». Le trajet de la Mecque à Mina, de Mina à Arafat, de Arafat à
Muzdalifah et de Muzdalifah à Mina est celui que le Prophète « Paix et salut
sur Lui » a fait lors de son déménagement de la Mecque à Médine :
c’est pourquoi il faut faire exactement comme il a fait.
La journée passée à Arafat est un jour de prières,
d’invocations et d’implorations, qui seront plus intenses aux dernières heures
avant le coucher du soleil. On raconte que c’est au sommet du mont Arafat que
Adam et Eve se sont retrouvés après la punition céleste. Quand Eve, la
première, a vu Adam, elle s’est assise et a fait semblant de ne l’avoir pas
remarqué. Adam l’a vue, il est venu à elle et lui a demandé où elle était
allée. Eve répondit qu’elle n’avait pas bougé depuis qu’ils s’étaient perdus.
Adam constata pourtant que les semelles des chaussures d’Eve étaient toutes
usées à force de marcher à la recherche d’Adam. De nos jours, on dit que les
femmes imitent Eve : même quand elles sont folles d’amour pour un homme,
elles n’ont pas le courage de l’avouer et attendent toujours que l’homme fasse
le premier pas. J’ai ajouté cette petite anecdote pour détendre le
lecteur !
Eve a été victime des malices de Satan et elle a obligé Adam
à agir contre les recommandations de Dieu. Ils ont été renvoyés du jardin
d’Eden et se sont perdus pendant beaucoup d’années.
A Muzdalifah, on fait la prière du crépuscule (Maghrib)
et la dernière du soir (celle de Icha), puis on se couche sur sa natte à
même le sol, sans oreiller, sans couverture, en s’imposant de ne pas se gratter
de peur de créer des écorchures qui saigneraient, en s’abstenant de se laver
les dents de peur de faire saigner les gencives : en somme, il s’agit
d’éviter tout ce qui pourrait faire saigner. C’est aussi à Muzdalifah qu’on
ramasse des petits cailloux avec lesquels on lapidera Satan pendant le séjour à
Mina.
Après la prière de l’aube, les pèlerins quittent Muzdalifah
pour Mina, où ils resteront trois jours. Au moment de lapider Satan, ils
glorifient et implorent Dieu, et demandent refuge auprès de Lui pour être
épargnés des malices du démon et être sauvegardés des tortures de l’enfer. Le
pèlerin qui pense n’avoir pas assez de force pour la lapidation a le droit de
déléguer une autre personne pour l’accomplissement de ce rite. C’est à Mina que
les hommes se rasent la tête et que les femmes se coupent une mèche, longue
d’une phalange de doigt, à la tresse de leurs cheveux. Ils peuvent alors porter
leurs habits civils et vivre une vie normale pendant le séjour à Mina.
D’ailleurs, le matin du dixième jour est celui d’un jour de fête, et on peut
porter de beaux habits et se parfumer, ce qui n’était pas permis pendant le hadj.
C’est le jour de l’immolation des moutons : les femmes ne vont pas à
l’endroit où cela se fait, les hommes sont délégués pour le faire. Le pèlerin
qui n’a pas les moyens de payer un mouton observera le jeûne pendant les trois
jours du séjour à Mina, et pendant sept autres jours à son retour en famille.
De Mina, les pèlerins retournent à la Mecque, et, pour dire
au revoir à la sainte mosquée, font à nouveaux les circumambulations autour de
la Kaaba, ainsi que le parcours de Al Safa à Al Marwa, de la même manière
qu’ils l’avaient fait au départ.
Ceux qui n’ont pas commencé leur circuit par Médine quittent
la Mecque pour Médine ; ceux qui ont commencé par Médine ont terminé et
seront conduits à l’aéroport de Djedda pour le retour au pays. Il est
recommandé de séjourner huit jours à Médine, afin de pouvoir y faire quarante
prières à Rawda, la sainte mosquée dans laquelle repose notre Prophète
« Paix et salut sur Lui » et ses compagnons « Bénédiction de
Dieu sur eux », soit les cinq prières obligatoires de chaque jour pendant
huit jours. Celui qui aura satisfait à cette prescription peut espérer le
pardon de ses péchés, car c’est là que repose le plus méritant des musulmans,
et on ne peut accéder à la grâce de Dieu que par son canal, puisque c’est Lui
qui sera le médiateur entre les musulmans et Dieu le jour du jugement dernier.
A Médine, il n’y a pas de bousculade, les hommes et les
femmes sont dans des compartiments différents : au moment de visiter le
mausolée, les femmes viennent quand les hommes sortent. Le pèlerin doit faire
des bénédictions pour Mohammed « Paix et salut sur Lui » et ses
compagnons. Seidima Boubacar et Seidima Oumarou « Bénédiction de Dieu sur
eux » sont couchés à côté de Lui. Le pèlerin implore le pardon, sollicite
le bien de ce monde et celui de l’au-delà pour lui, pour ses enfants, ses
proches et pour toute la communauté musulmane. Un peu plus loin repose Seidima
Ousmane, il faut donc y aller, et faire les mêmes bénédictions, implorations et
invocations, visiter la première mosquée de Mohammed « Paix et salut sur Lui »
à Médine, visiter le cimetière où repose Hamza « Bénédiction de Dieu sur
Lui », le cousin du Prophète « Paix et salut sur Lui », et
beaucoup d’autres lieux.
La visite du mausolée donne à réfléchir. Toutes ces foules,
provenant de toutes les contrées de la terre, sont venues faire des
bénédictions pour une personne qui n’est pourtant plus de ce monde. Cette
personne, plus aimée de Dieu que tout au monde, cette personne pour l’amour de
laquelle Dieu a fait toutes ses créations, cette personne la plus importante
ici-bas et dans l’au-delà, cette personne n’a pas échappé à la mort : et
donc personne n’y échappera. Cette visite vous donne ainsi la ferme conviction
que tout disparaîtra un jour, et vous exhorte à la patience et à la
persévérance dans la pratique des recommandations de l’Islam, dans l’espoir
d’être au côté du plus aimé de Dieu qui nous a tracé la bonne voie pour accéder
au paradis et avoir une vie meilleure dans l’au-delà. Il est dit dans le Coran
que le musulman doit essayer d’imiter la conduite du Prophète « Paix et
salut sur Lui ». Il est vrai qu’aucune personne ne peut faire exactement
comme Lui, mais il est recommandé de le tenter, afin d’éviter les grosses
erreurs. Dieu est clément et miséricordieux.
Tout au long du pèlerinage, on ne pense qu’à la bonne
exécution de ses rites, afin d’être pardonné des erreurs commises. C’est
pourquoi, à la sainte mosquée de la Mecque comme à celle de Médine, les
pèlerins versent beaucoup de larmes de regret et de crainte, parce qu’ils se
demandent si les erreurs qu’ils ont commises seront pardonnées, et si les
tortures de l’enfer leur seront épargnées. Au moment de quitter la sainte
mosquée de la Mecque et celle de Médine, on a l’impression qu’on laisse quelque
chose derrière soi : on souhaiterait rester ici, sur les lieux saints,
pour toute sa vie, pour faire encore plus d’invocations, d’implorations, de
bénédictions, de prières.
Au retour en famille, les parents et amis sont très heureux
de vous retrouver : c’est la fête, beaucoup de plats ont été préparés par
eux et vous attendent, on mange, on rit, on cause, on vous pose mille
questions. Pour le restant de sa vie, le pèlerin n’oubliera jamais ce voyage,
et au moment de faire ses prières il reverra chaque fois, comme dans un film,
la Kaaba et le Mausolée où reposent Mohammed « Paix et salut sur
Lui » et ses compagnons « Bénédiction de Dieu sur eux ».
Revenu du pèlerinage, le pèlerin est tenu en grande
considération par la communauté musulmane : pour l’honorer, on l’appelle El
Hadji (Hadja pour la femme). Il doit désormais veiller à tout ce
qu’il fait, éviter tout ce qui pourrait ternir son image de Hadji, et
respecter scrupuleusement tous les interdits de l’islam. Que Dieu nous guide
dans la bonne voie ! Je souhaite qu’Il accorde à tous les musulmans
l’occasion de visiter les lieux saints.
Madame
Sirandou Boucoum
[Originaire de Djenné, je fus recrutée à l'école
en octobre 1954 à Djenné où j'ai poursuivi mes études primaires jusqu'en 1961.
Après ma réussite au Certificat de fin d’études primaires élémentaires, je
fus orientée vers le lycée de jeunes filles, actuel lycée Bâ Aminata. Apres
avoir obtenu le DEF (diplôme d'études fondamentales), j’ai été admise à l’école
normale secondaire de Badala, c'était d'ailleurs la première promotion
de cette école. En septembre 1967, ayant réussi au diplôme de fin d'étude
à l'école normale, je fus mise à la disposition de la région de Gao et affectée
à Ansongo comme enseignante de second cycle chargée de l’enseignement
de l’anglais et du français. L’année suivante 1968 -1969 j‘ai été nommée à
Diré dans région de Tombouctou. En octobre 1969, mutée à Djenné, je m’y installai
pour de bon et poursuivis mes activités d’enseignante. Depuis1973 j’ai entrepris
des activités politiques pour prouver à la femme de Djenné que sa place n’est
pas seulement à la cuisine, et qu’elle devait être présente lors des prises
de décisions pour son développement. Cet objectif n’a été atteint qu’au prix
de dures épreuves. En 1992 je fus nommée Directrice du second cycle de Djenné.
En 1999 je fus élue conseillère communale et 2ème adjointe au Maire. Depuis les élections de
2004, où j’ai été réélue conseillère communale mais plus membre du bureau
communal, j’ai repris ma fonction de Directrice de second cycle, cette fois
au quartier Kanafa à Djenné. Je suis mariée et mère de 5 enfants dont un commerçant,
un étudiant, un jeune diplômé en mécanique auto, une ménagère mariée avec
4 enfants, et une fille maîtresse d’anglais comme sa mère.]
______________________________________________________
DOCUMENT
2
Bénédictions et
amulettes :
quelques remarques
sur la connaissance des marabouts à
Djenné
Geert Mommersteeg
« Que Dieu
lui donne une longue vie ! » « Que Dieu donne de la force au
lait de sa mère ! » « Que Dieu le fasse solide de sorte qu’il
rejoigne nos rangs ! » « Que Dieu lui fasse vivre la vie d’un
musulman ! » « Que Dieu lui donne une bonne vie tant qu’il
demeurera dans notre ville et qu’Il lui donne une bonne vie lorsqu’il
s’établira ailleurs ! ».
Lorsqu’il a sept
jours, l’enfant est béni. Dès qu’il a annoncé le nom du nouveau-né, le marabout
demande à Dieu de lui assurer longue vie, bonne santé et force. La ville dans
laquelle l’enfant est accueilli de cette façon est la ville de Djenné, cette
ville dont la fameuse mosquée et les nombreuses écoles coraniques reflètent
encore les jours glorieux du passé. A la fin des années 80 –la période où j’ai
fait mes recherches ethnologiques à Djenné– la ville comptait quelques 35
écoles pour l’éducation coranique élémentaire et une douzaine d’école pour
l’enseignement secondaire où le droit, la grammaire de l’arabe, la rhétorique
et la littérature, la théologie, les traditions du Prophète et l’exégèse du
Coran étaient enseignés.[2]
Les maîtres de ces écoles coranique
traditionnelles sont appelés alfa (de
l’arabe al-faqîh) en songhaï, ou môdibo (de l’arabe mu’addib) en fulfulde. En français, la langue du colonisateur, les
maîtres sont appelés marabouts, terme qui est employés dans toute l’Afrique de
l’Ouest musulmane. « Les marabouts, » comme mon assistant de recherche Boubakar
Kouroumansé me l’a dit une fois, « enseignent comment suivre Dieu, et les
marabouts savent comment demander à Dieu ». De cette façon concise, il
faisait référence aux deux types de connaissances que les marabouts possèdent.
Une distinction est faite entre la connaissance qu’on appelle
« publique » et la connaissance « secrète ».[3]
La connaissance publique est associée à la pratique de l’éducation dans les écoles
coraniques. Les jeunes enfants sont confiés à un alfa qui leur apprendra à réciter le Coran, tandis que les élèves
plus avancés poursuivent chez lui leur formation islamique. Guidés par leur alfa ils font
connaissance avec les auteurs classiques du droit islamique, de la grammaire et
de la littérature arabes, de la théologie, des traditions du Prophète et de
l'exégèse du Coran. Les connaissances secrètes sont appliquées dans le
« maraboutage », ce complexe de pratiques magico-religieuses où la
production d’amulettes et la divination sont les plus significatives.
Les marabouts jouent un rôle
important dans la vie de chaque individu à Djenné. Ceci apparaît
particulièrement évident aux étapes critiques de la vie : la naissance, la
circoncision, le mariage et la mort. A la cérémonie au cours de laquelle le
nouveau-né est nommé, c’est un marabout qui annonce le nom de l’enfant et le
bénit. Au moment de la circoncision, les jeunes garçons reçoivent des amulettes
pour les protéger contre le Mal et contre les dangers. Lorsque les garçons
retournent dans leurs familles, après une quinzaine de jours de réclusion, un
marabout est là pour prononcer des bénédictions sur eux. Le mariage est
contracté devant le marabout, et, finalement, c’est encore un marabout qui
conduit la dernière prière sur le défunt et dirige la lecture du Coran ou du Dala’il al-Khairat –un panégyrique du
Prophète Muhammad– pendant les condoléances, pour faciliter la vie ultérieure
du défunt.
Le
bien-être individuel, cependant, n’est pas pris en charge seulement aux étapes
critiques de la vie. Dans la vie de tous les jours, les marabouts rendent aussi
toute une variété de services pour assurer la santé à une personne, pour lui
offrir la sécurité, pour lui garantir le bien-être spirituel et matériel. Par
le moyen de la divination, de prières surérogatoires, et par la production
d’amulettes, ils peuvent prendre contact avec les pouvoirs cachés du monde
surnaturel et les utiliser pour le bénéfice de leurs clients.
Les bénédictions sont partout
présentes dans la vie sociale à Djenné. Sans cesse, Dieu est appelé à prendre
soin de Ses serviteurs. « Que Dieu nous sauve ! ». « Que
Dieu nous protège pendant notre voyage ! ». « Que Dieu
l’approuve !». « Que Dieu nous donne la force ! ».
« Que Dieu protège notre ville ! », etc. Ces bénédictions, et
bien d’autres, peuvent être entendues dans des occasions spéciales, mais aussi
dans la vie de tous les jours : car chacun peut solliciter Dieu, et la requête
de chacun peut être satisfaite par Lui.
Dieu,
cependant, a quatre vingt dix neuf noms, ceux qu’on appelle « les Plus
Beaux Noms de Dieu ». Certains de ces noms sont plus puissants que d’autres.
Présenter une requête particulière à Dieu en employant un nom doté de puissance
apportera une résultat rapide et certain. En outre, partout dans Son Saint
Coran, Dieu à parlé en utilisant des mots puissants. S’ils sont employés à bon
escient, les pouvoirs inhérents à ces mots peuvent être utilisés pour toutes sortes
de fins. Ces mots sont aussi utilisés dans les amulettes.
Des
versets coraniques, des sections, ou même un seul mot, une sourate courte
entière, un nom de Dieu, tous peuvent être utilisés et en réalité le sont.
L’usage des amulettes dérive de la croyance dans le pouvoir des inscriptions
qu’elles contiennent. C’est le pouvoir inhérent à ces mots qui protégera ou
aidera celui qui les porte.
Ainsi,
ou inscrits sur un bout de papier, cousu dans du tissu ou du cuir (tira en songhaï) ou dissous dans
une potion d’« eau sainte » (nesi en songhaï), les pouvoirs portés
par les mots du Livre Saint peuvent être appliqués à différentes intentions
curatives, protectrices ou causatives. Cependant, ni les noms particuliers ou
passages spécifiques du Coran, ni les techniques souvent compliquées pour les
employer ne sont des connaissances communes. Ce sont au contraire des secrets,
et c’est la connaissance de ces secrets qui fait la spécialité des marabouts.
Cette connaissance leur permet de demander à Dieu de donner à un commerçant le
succès dans ses affaires, d’accorder à une femme l’enfant qu’elle désire depuis
longtemps, de guérir tel autre d’une maladie, ou de rendre une femme amoureuse
de l’homme qui la désire.
Depuis
toujours, l’usage d’amulettes a été l’objet d’un débat à l’intérieur de
l’islam, et dans la littérature sur ce sujet plusieurs opinions se
dessinent : d’un côté, les savants classiques déclarent que toute pratique
magique corrompt la foi islamique et que, par conséquent, il est défendu aux fidèles
de s’y aventurer ; de l’autre, ceux qui défendent l’utilisation du Coran
dans la confection des amulettes, interprètent les textes écrits dans ces
dernières comme autant d’invocations de Dieu, comme autant de prières de
demande.
C’est surtout cette dernière opinion
qui ressort de la terminologie utilisée à Djenné. Les amulettes sont définies
comme « demandes à Dieu » (Yer Koy narey en songhaï). C’est en
effet ce que font les marabouts qui écrivent ces amulettes : ils demandent
à Dieu Sa protection pour leurs clients, ou la prospérité, ou la réalisation
d’un but spécifique.
L’expérience suivante au cours de
notre travail de terrain, il y a plus de quinze ans, a été un incident
révélateur dans ce contexte.[4]
Pendant l’une de nos visites hebdomadaires à un marabout, il m’a été demandé de
lire une lettre qui lui était adressée. Il me donna la lettre, qu’il avait
reçue le jour même, et je commençai à lire les quelques lignes en français.
Chaque fois que j’avais lu quelques mots, je faisais une courte pause pour permettre
à Boubakar de traduire en songhaï. La lettre était envoyée par un homme de
Bamako et contenait une demande d’aide au marabout, car l’expéditeur désirait
obtenir un emploi dans une entreprise donnée. Littéralement, l’homme demandait
au marabout de « prier » pour qu’il obtienne le poste. Lorsque je lus
sa demande, à haute voix, Boubakar, hésitant légèrement, traduisit le mot
français « prier » par le songhaï « dyingar », le mot qu’on emploie pour dire le « salât » (la prière
rituelle qui doit être pratiquée cinq fois par jour). A ce moment, le marabout éclata de
rire et dit : « Dyingar ?
Je suppose qu’il veut dire gara ! ».
Gara est le
terme songhaï pour ce qu’on appelle en arabe ducâ’, une prière de requête, ou une invocation
personnelle. La différence entre dyingar
et gara est essentielle. Comme une
suite à l’incident au cours duquel le marabout juxtaposa et distingua les deux
termes, Boubakar et moi-même (d’abord ensemble, ensuite avec certains
marabouts) avons discuté cette question en grand détail. Dans ces discussions,
il a été fait plus d’une fois allusion à un verset du Coran :
« Appelez Moi et Je vous répondrai » (40:62) ou au hadith
« Les prières de demande sont les armes du croyant ». Ces paroles,
dirent mes interlocuteurs, signifient qu’il est possible d’obtenir certaines
choses en les demandant à Dieu.
Le processus de
confection d’une amulette en détail[5]
Le
processus de confection d’une amulette est souvent fort complexe. Les sciences
ésotériques, qui concernent entre autres la connaissance du sens caché et des
pouvoirs des mots et des lettres, de la numérologie et des carrés magiques, ont
chacune son application spécifique. Une fois, pendant mes recherches à
Djenné, j’ai eu la chance de pouvoir suivre
les diverses étapes de la confection d’une amulette. Un homme avait jeté son
dévolu sur une femme, mais cette femme, en dépit de ses avances, continuait à
le repousser ; il avait donc fait appel à un marabout pour obtenir de ce
dernier une amulette qui le rendrait capable de posséder cette femme en
particulier.
Afin d’accomplir le requête de son client le marabout a
commencé par ouvrir son exemplaire du Coran. Les mots du Coran sont le
fondement des amulettes islamiques. Pour l’amulette que nous examinons, le
marabout a pris une section de la sourate 12, verset 30 : « il
l’a rendue éperdument amoureuse de lui ».[6]
Le passage de la sourate « Youssouf » d’où provient ce verset raconte
comment Joseph, servi lui-même par son extrême beauté, rendit la femme de son
maître égyptien éperdument amoureuse de lui. Les mots conviennent donc bien
pour une amulette qui a pour but d’apporter à son propriétaire l’amour et
l’affection d’une femme.
Une
fois que le marabout a décidé quelle citation du Coran il veut utiliser, il
calcule la valeur numérique de ces mots. Chaque lettre de l’alphabet arabe a sa
propre valeur numérique. Ainsi donc, après quelques calculs, le marabout trouve
que la valeur numérique du passage de la sourate « Youssouf » est
1957. Cette valeur lui permettra, comme nous allons le voir, de déterminer le
contenu et la forme exacts que doivent prendre les diverses composantes dans le
processus de fabrication de l’amulette. Cependant, avant tout, le marabout doit
aussi fixer, par divers calculs, la date qui conviendra pour écrire effectivement
l’amulette et pour invoquer les esprits.
C’est que, pour tout acte de « maraboutage », il y a le moment
voulu : plus exactement, il y a un temps pour le « bon travail »
et un temps pour le « méchant travail ».[7]
Chacune des douze heures du jour et chacune des douze heures de la nuit a un
caractère différent. On les appelle les « heures des planètes ».
Chacune des sept « planètes » (le soleil, la lune, et les planètes
Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne) exerce une influence spéciale à un
moment particulier du jour, ou de la nuit. Pour s’assurer des influences
astrologiques voulues, le marabout détermine, sur la base de la valeur
numérique de la citation choisie, à quelle heure et sous le signe de quelle
planète il devra écrire l’amulette.
La valeur numérique du texte
coranique est ici 1957 ; divisée par 12, il reste 1 : ainsi
l’écriture doit être faite pendant la première heure du jour. Or, le jour –un
mercredi– où le marabout faisait le travail que je rapporte ici, cette heure
était déjà dépassée. Le marabout consulte donc une table des heures des
planètes. Il y trouve que la cinquième heure et la douzième heure du jeudi sont
placées sous le même signe que la
première heure du mercredi : le signe de Mercure. Ainsi, il repousse l’écriture
à la cinquième heure du lendemain, et prévoit de commencer les invocations à la
douzième heure, puisque l’écriture et l’invocation doivent être placées dans
des heures de la même planète.
Lorsque l’heure favorable est venue,
le marabout trace et écrit sur un morceau de papier tout ce qui fera la force
de l’amulette. Les inscriptions sont divisées en trois parties : des
signes mystérieux, un ‘carré magique’, et un texte en arabe.
Au coin
en haut à droite du papier (format environ 10 x 15 cm.) le marabout écrit d’abord
sept signes mystérieux. Ces signes, ensemble, forment ‘le nom
suprême’ de Dieu (al-ism al-a`zam).[8] Sous ces sept signes, le marabout écrit « Au nom de
Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant : c’est Lui que nous appelons à
l’aide », puis une bénédiction pour le Prophète : « Que Dieu
bénisse notre Seigneur le Prophète et Sa famille ».
Au centre du
papier de l’amulette, est alors dessiné un carré divisé en neuf sections. Huit
d’entre elles contiennent des chiffres, celle du centre contient un texte.
C’est là que le marabout écrit le passage de la sourate
« Youssouf » : « il l’a rendue éperdument amoureuse
de lui », avec le nom de son client et le nom de la femme dont le cœur
doit être gagné. Le nom de la femme est écrit en dessous de la citation du
Coran, celui de l’homme au-dessus, et sens dessus dessous. De la sorte, nous
dit-on, les deux noms « s’attirent » mutuellement. En dessus, ou
plutôt « sous » le nom de l’homme, le marabout écrit le nom de Dieu,
et sous le nom de la femme il écrit celui de l’ange Djibril.
Les nombres qui figurent dans le carré sont tous dans un
certain rapport les uns par rapport aux autres. Ils sont tous déduits de la
valeur numérique du texte coranique. Les huit cases sont remplies de la façon
suivante :
|
489 |
1305 |
163 |
|
1142 |
|
815 |
|
326 |
652 |
979 |
Construit
de cette façon, le carré dispose les nombres de telle sorte que les lignes et
colonnes ont toujours le même total à savoir 1957, la valeur numérique de la
citation choisie. Il y a donc une relation étroite entre les nombres et le
texte. Le marabout explique qu’écrire un tel carré équivaut à écrire la
citation du Coran 1957 fois. Mais utiliser un tel carré n’est pas seulement
plus facile et plus rapide. Des carrés tels que celui-là sont également très
faciles à lire pour les esprits qui vont être invoqués afin que soit réalisée
la requête qui est formulée dans l’amulette. Les esprits peuvent lire les
carrés d’un seul coup d’œil ! Et immédiatement, ils comprennent ce qui est
demandé ! La construction d’un carré numérique peut donc être considérée
comme une façon condensée d’écrire la demande.
Après avoir construit le carré
numérique, le marabout écrit autour de ce carré le texte suivant :
« Croyez [en Dieu], oh serviteurs de ce saint verset. Que Dieu vous
bénisse. Vous devez obéir ! Vite ! Vite ! Par la vertu des
droits de ce verset sur vous et par les pouvoirs qu’il a sur vous, garantissez
l’amour de (le nom de la femme) pour (le nom de l’homme) sur l’heure ! De
telle sorte qu’elle ne soit pas capable de rester loin de lui une seule heure
et même moins que cela ! ». Le marabout demande, ou mieux ordonne,
aux esprits attachés au texte coranique inscrit sur l’amulette-papier,
d’accomplir ce qui est demandé. Plus tard, durant l’invocation, lorsqu’il
s’adressera lui-même directement au monde des esprits, il prononcera cette
phrase. Car, comme on le verra en détail plus loin, chaque verset, et même
chaque mot du Coran a ses propres esprits pour l’accompagner.
Le marabout termine en écrivant au
bas de l’amulette-papier une autre bénédiction pour le Prophète (« Que
Dieu bénisse notre Seigneur Muhammad, Son Prophète, et sa famille et ses
compagnons ! »). Voici l’amulette achevée : [9]
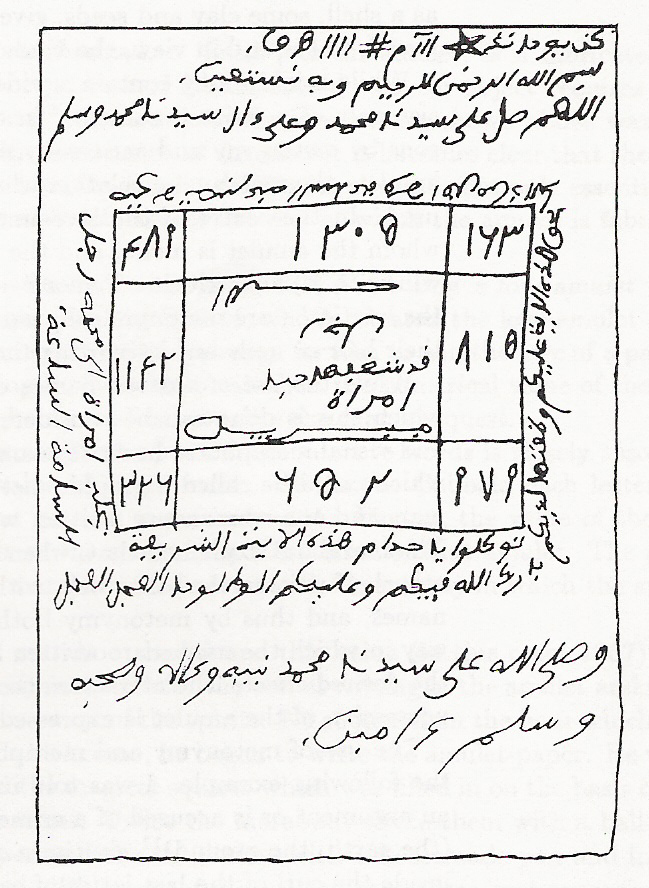 |
Immédiatement, le marabout fait deux
copies de ce document : l’une sur une autre feuille de papier avec un
stylo à bille, et l’autre, avec une plume de fabrication locale et avec de
l’encre, sur une planchette de bois. Alors que l’une des feuilles est mise de
côté pour être utilisée dans le rituel d’invocation –et c’est celle qui servira d’amulette en fin de compte– l’autre doit être placée en un certain
endroit. Ici il y a quatre possibilités, chacune associée avec un des quatre
éléments : l’eau (le papier est mis dans une boite, une bouteille ou
récipient équivalent, et plongé dans l’eau), la terre (il sera donc enseveli
dans un trou ou dans le sol), l’air (il sera suspendu à un arbre élevé) et le
feu (on l’enterrera à un endroit où l’on fait souvent du feu, par exemple une
cuisine, ou on l’écrira sur une feuille de métal qui sera placée près d’un feu
ou d’un fourneau à charbon). Le lieu qui convient est déterminé à partir de la
valeur numérique du texte coranique. Il est important de déposer la copie au bon
endroit, car c’est là que les esprits vont envoyer leurs assistants pour la
chercher. Dans le cas présent, c’est l’élément « eau » qui a été
déduit de la valeur numérique. Ainsi, peu de temps avant qu’il ne commence
l’invocation, le marabout a mis le papier dans un petit sachet en plastique et
l’a plongé dans l’eau au bord du bras d’eau, juste à la limite de la ville.
Quant à
la copie sur une planchette de bois, lorsqu’elle est terminée, le marabout la
lave et recueille dans un récipient l’eau dans laquelle les écritures ont été
dissoutes. Le liquide est donné au client, qui devra, régulièrement, en
frictionner son visage et sa tête, ou en boire une petite quantité.
L’utilisation de l’eau qui a servi à tout effacer dérive, comme le recours aux
amulettes, de la croyance en le pouvoir des textes du Coran et des autres
inscriptions qu’elles contiennent. En utilisant l’eau et l’amulette, on
renforce l’une par l’autre : non seulement l’eau renforce le pouvoir de
l’amulette, mais en même temps elle attache ce pouvoir à l’individu. Le client,
qu’il veuille porter l’amulette ou simplement la garder à la maison, peut
internaliser le pouvoir de ses inscriptions en buvant l’eau ou même en s’en
frictionnant le corps.
Lorsque
la douzième heure du jeudi est venue, celle qui est placée –comme l’heure à laquelle le marabout a fait
les écritures– sous le signe de Mercure, il commence les invocations. C’est le
moment d’en appeler aux esprits pour qu’ils accomplissent ce qui a été demandé
dans l’amulette.
Il y a deux sortes d’esprits, comme
le marabout l’explique : les djinns et les anges. Les djinns se
trouvent partout sur la terre et dans les eaux. Quant à leur caractère, il
ressemble à celui de l’homme : certains se conduisent bien, d’autres se
conduisent mal. Les anges, quant à eux, ne font jamais aucun mal, leur
comportement est exemplaire. Ils sont les créatures les plus proches de Dieu.
Ils vivent dispersés dans les sept ciels. Dans notre cas le marabout s’adresse
lui-même à un groupe d’esprits : ceux qui sont associés au texte coranique
inscrit sur de l’amulette-papier.
Avant qu’il ne puisse les invoquer,
il doit accomplir un certain nombre de rites. D’abord, le marabout allume un
feu de charbon de bois dans un petit fourneau. Il prend ensuite
l’amulette-papier, jette un petit morceau d’encens dans le charbon
incandescent, et tient le papier dans la fumée pendant un certain temps. La
fumée est la nourriture des esprits. Comme le marabout l’explique :
« vous ne pouvez pas inviter quelqu’un sans lui donner un repas ». En
rassasiant les esprits, le marabout s’assure de leur concours. Le type de
parfum à utiliser dépend, lui aussi, de la valeur numérique du texte coranique
de l’amulette. Pendant les préparatifs de l’invocation, le marabout a
vérifié quelle odeur est celle qui convient. Lorsque l’amulette-papier a été
encensée avec les fumées odorantes, le marabout la plie en trois, enroule un
fil tout autour et l’attache de telle sorte que le papier plié pende à environ
un demi mètre au-dessus du feu de charbon de bois. De temps à autre, il jettera
de petits morceaux de résine dans le feu.
Avant l’invocation proprement dite,
le marabout se tourne en direction de la Mecque, et prie deux ruku.[10]
Après cette prière à Dieu, il s’assied sur sa natte en face du fourneau et s’adresse
à « l’esprit de la place », celui qui occupe cet endroit : il
est nécessaire de l’informer de l’arrivée d’autres esprits. Par trois fois, il
demande au djinn ou bien de donner
son accord, ou bien de quitter l’endroit pour un moment. Le marabout utilise
ici une formule spéciale formée de mots
étranges. « Des mots magiques », dit-il, « des mots dont
personne ne sait le sens ». Ensuite, il utilise des incantations
similaires pour demander à celui qui, ce jour-là de la semaine, est le roi des djinns, la permission de procéder à
l’invocation. A sept anges et à sept djinns,
Dieu a en effet donné la responsabilité de tout ce qui se passe sur la
terre : chaque couple exerce cette responsabilité un jour de la semaine.
Rien ne peut être fait par un autre djinn, qu’il soit bon ou mauvais,
sans le consentement de l’esprit qui règne ce jour-là. Ainsi, pour procéder
exactement dans l’ordre qui convient, il est nécessaire de s’assurer que
« l’esprit du jour » accepte que le travail soit fait. Le marabout
l’appelle par sept fois.
Cela fait, le marabout prend son
chapelet (tasbiha) et commence à
invoquer les esprits qui sont considérés comme responsables de la réalisation
de la requête inscrite sur l’amulette. Mille neuf cent cinquante sept fois, il
récite « il l’a rendue éperdument amoureuse de lui ». Faisant glisser les
boules de son chapelet sur ses doigts, il marmonne les mots du Livre Saint.
Après le septième, le cinquantième, le neuf centième (et après, à chaque
centième fois), soulignant ainsi les sept unités, cinq dizaines, et les
centaines de neuf à dix neuf qui permettent de parvenir à la valeur numérique
1957, il prononce les mots qui sont écrits tout autour du carré numérique de
l’amulette-papier. Il est demandé aux esprits qui « suivent » le texte
coranique d’accomplir que Mademoiselle Unetelle ouvre son cœur au client du
marabout.
Comme on l’a mentionné plus haut,
chaque partie du Coran, et même chacun de ses mots, a ses propres esprits. Une
fois, pendant l’invocation, le marabout appelle deux de ces esprits par leur
nom propre. Après la millième récitation du texte coranique, il s’adresse
directement à un djinn et à un ange.
Leurs noms, trouvés et notés pendant les préparatifs, sont déduits de la valeur
numérique des mots auxquels ils sont si étroitement associés. Les noms des djinns se signalent par le suffixe –taysu. La valeur numérique de –taysu est 319. En retranchant ce nombre
de 1957, on obtient 1638. Les lettres qui correspondent à 1638 sont,
respectivement, 1000=ghain, 600=kha’, 30=lam, 8=ha’. Et donc le djinn de la partie citée de la sourate
12, verset 30, répond au nom de Ghakhalahataysu.
Utilisant la même méthode, mais partant du suffixe –halil, le marabout a trouvé que le nom de l’ange en question est Ghazawahalil. Ce djinn et cet ange sont les plus importants esprits associés à la
partie choisie du texte coranique. Ils commandent les autres anges et djinns. Et, comme ils sont les chefs, le marabout prononce leurs noms
après la millième récitation. Il demande au djinn Ghakhalahataysu de faire advenir le but désiré à cause de l’ange Ghazawahalil. De cette façon, le
résultat escompté sera certainement obtenu. Car, comme le marabout l’explique,
lorsque le nom de l’ange concerné est mentionné, il est impossible au djinn de laisser la requête de côté. Il
ne peut pas rester oisif et il doit mettre ses assistants au travail.
Pendant l’invocation,
l’amulette-papier se balance tranquillement dans la chaleur qui monte du
charbon rougeoyant. Vers la fin de la récitation, elle a assez de vitesse pour
tourner autour de son axe pendant un certain temps. C’est, pour le marabout, le
signe que sa requête a été entendue. Un djinn
est présent. Mais le marabout ne remarque pas seulement la présence de cet
esprit dans l’amulette tournoyante, il la ressent aussi lui-même. Comme il le
déclare : « C’est comme si j’étais soudain tout froid. Et ensuite, je
me sens toujours très fatigué ».
Une
heure environ après que le marabout eut commencé l’invocation, lorsqu’il eut
compté un grain de son chapelet pour la 1957-ème fois et dit un nombre égal de
fois « il l’a rendue éperdument amoureuse de lui », il s’adresse
lui-même une fois de plus aux esprits auxquels il a présenté cette requête, et
prononce une bénédiction pour eux. « Puisse Dieu les bénir ! ».
L’amulette-papier
est détachée et, avec le fil attaché autour d’elle, elle est remise au client
qui devra la faire coudre à l’intérieur d’une petite poche en cuir. Assuré du
support d’une amulette et d’une eau contenant les mots sacrés, l’homme peut
continuer son aventure amoureuse.
Comme
on a pu le voir ci-dessus, l’ensemble du processus de fabrication d’une
amulette est déterminé par le texte coranique. Le contenu de presque tous les
éléments dépend des mots pris dans le Saint Livre. A part quelques formules
standard, tant dans l’écriture (le plus haut nom, l’invocation et les
bénédictions) que dans l’invocation (la prière, les invocations, les
incantations, les bénédictions), toutes les variables sont déterminées par la
citation du Coran. Ce n’est pas seulement, comme c’est évident, dans le contenu
littéral de l’amulette et des récitations qu’on retrouve ces mots, mais ils
sont à la racine d’une considérable variété d’éléments du processus de
fabrication, comme par exemple : le moment qui convient, l’endroit où placer
la copie, le type de parfum à brûler pendant l’invocation, le nombre de
récitations, et même les noms des esprits. Par le biais de sa valeur numérique,
le texte coranique détermine la manière exacte dont la fabrication doit être
effectuée ; c’est que l’efficacité attribuée à l’amulette provient
exclusivement du pouvoir inhérent aux mots du Coran eux-mêmes, aux paroles de
Dieu.
Les domaines de la connaissance des
marabouts couvrent toute la gamme des besoins des hommes et de leurs questions,
aussi bien ceux qui concernent des problèmes existentiels que les simples
incertitudes du quotidien ; depuis le bien-être spirituel et la perspective
d’une vie future où toutes les bonnes actions seront récompensées, jusqu’au
bien-être concret de la vie actuelle dans ses aspects de bonne santé, de longue
vie et de prospérité. Outre que les marabouts « enseignent comment suivre
Dieu », ils « savent comment demander à Dieu », et ainsi ils
jouent un rôle essentiel dans la vie des habitants de Djenné.
Bibliographie
Geert Mommersteeg : « He has smitten her to
the heart with love », The Fabrication of an Islamic Love-Amulet in West
Africa, Anthropos 83, 1988:501-510
Geert
Mommersteeg : Allah’s Words as Amulet, Etnofoor III (1), 1990:63-76
Geert
Mommersteeg : Qur’anic Teachers and Magico-religious Specialists in Djenné
[1]
Natte grossière en paille tressée
[2]
Sur ce point, voir aussi R.-C. Gatti : Les écoles coraniques de Djenné, problèmes et perspectives, DJENNE PATRIMOINE Informations, n° 9, juillet 2000, p. 19-36
[3]
Sur ce point, voir G. Mommersteeg : « Le domaine du marabout : maîtres coraniques et spécialistes magico-religieux à Djenné (Mali) », DJENNE PATRIMOINE Informations, n° 8, janvier 2000, p. 13-18 Retour au texte
[4]
Le travail sur le terrain à Djenné eut
lieu de novembre 1985 jusqu'en octobre 1986 et de juin 1987 jusqu'en janvier
1988. Il a été subventionné par la Fondation néerlandaise
pour le développement de la recherche tropicale (WOTRO) (W52-368).
Je remercie les nombreux marabouts pour toute l'assistance qu'ils ont
bien voulue m'accorder pendant mes recherches à Djenné;
je remercie également et particulièrement mon assistant
dans la recherche, M. Boubakar Kouroumansé.
[5]
Les données sur lesquelles la description ci-dessous est fondée ont été recueillies à Djenné entre avril et septembre 1986.
[6]
Le Coran, traduction de D. Masson, Folio classique, Paris, 2001 Retour au texte
[7]
Celui qui causera une perte.
[8]
Sur ce point, voir G. Mommersteeg : « Djenné demande de la pluie : prières et rituels pour obtenir la pluie dans une ville sahélienne », DJENNE PATRIMOINE Informations, n° 16, printemps 2004, p. 11-14
[10]
Chacune des cinq prières que le musulman doit
faire dans la journée est composée d'un certain nombre de
ruku, au minimum deux. Un rak'ah
est donc l'ensemble des révérences, génuflexions,
prosternations et des récitations qui y sont associées et
qui constituent une unité de culte.
|